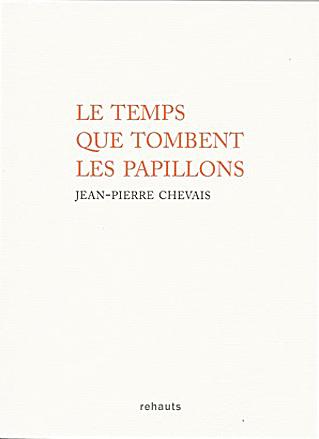 Convenablement programmée, alimentée par des données en masse suffisante, une machine peut produire des similis poèmes. Dira-t-on pour autant qu’il y a des robots poètes, comme il y a des robots joueurs d’échecs et de go ? Non. Un poète est apte, comme tout être humain, à faire des multiplicités d’autres choses que des poèmes. Et ces autres choses, telles qu’il les ressent, sont une des bases de son écriture. Le robot, d’une part est spécialisé dans un domaine bien défini, d’autre part, il ne ressent rien. Le temps que retombent les papillons, de Jean-Pierre Chevais, n’a rien à voir avec la robotique. L’ouvrage, composé de sept séquences de longueur inégale, précédées d’un avant-poème, fait largement part à l’intuition.
Convenablement programmée, alimentée par des données en masse suffisante, une machine peut produire des similis poèmes. Dira-t-on pour autant qu’il y a des robots poètes, comme il y a des robots joueurs d’échecs et de go ? Non. Un poète est apte, comme tout être humain, à faire des multiplicités d’autres choses que des poèmes. Et ces autres choses, telles qu’il les ressent, sont une des bases de son écriture. Le robot, d’une part est spécialisé dans un domaine bien défini, d’autre part, il ne ressent rien. Le temps que retombent les papillons, de Jean-Pierre Chevais, n’a rien à voir avec la robotique. L’ouvrage, composé de sept séquences de longueur inégale, précédées d’un avant-poème, fait largement part à l’intuition.
De quels papillons s’agit-il ? Pas de ceux, allant de fleur en fleur, dont le langage courant a fait le symbole de l’inconstance amoureuse. A rapprocher le titre du livre de sa page 27, les papillons sont clairement des mots, LES mots : « inger / christensen elle / quand la poussière / se lève un peu / elle dit que c’est / l’envol des pa / pillons du monde / moi quand je / souffle sur les mots / ça ne tient pas ça / bat des ailes / c’est bien la preuve ». Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Dans le poème préliminaire, les mots sont des légumes : « Maman a / vant elle / pelait les mots / une pelure par / mot ». C’est après la mort de la mère que « les papillons a / lors ont / commencé ». N’empêche que les mots ne sont pas toujours des papillons : « les mots ils / cognent / fendent cassent ». Parfois, c’est le poète qui, de ses bras, fait des ailes et s’envole, les mots ne suivent pas, il ne peut pas les abandonner, redescend.
L’indécision gouverne le rapport du poète à ses mots. Aux premières pages, il garde confiance : « sûr / je trouverai » écrit-il à la destinatrice de ses confidences, dont il cherche à écrire le nom. Un peu plus loin, il l’a perdu – comme, d’ailleurs, il avait déjà oublié le sien. Ne lui reste que l’initiale. Or, ce n’est pas uniquement un individu, une femme, qu’il faut nommer, ce sont les mots eux-mêmes, pour savoir ce qu’ils désignent. Faute de précision, le doute s’installe. Souvenons nous que Précis d’indécision est le titre d’un ouvrage antérieur de Jean-Pierre Chevais (cf. Les Lettres Françaises de septembre 2009).
Sauf erreur, c’est la première fois qu’un de ses livres pratique en son entier l’enjambement des vers par les mots, sans même un trait d’union. Rien que la respiration du lecteur.
Outre Inger Christensen, d’autres écrivains sont nommés : Charles Ferdinand Ramuz, Carlos Levi, Mahmoud Darwich (c’est nous qui mettons des majuscules) ou évoqués par allusions. Le célèbre « je préférerais pas » introduit le personnage d’Herman Melville, qui, lui sait ce qu’il ne veut pas, c’est à dire tout : « je préférerais pas / qu’on m’ap / pelle bartle / by ». Ce serait en effet une erreur. Jean-Pierre Chevais accueille, essaie, par exemple, d’ajouter des herbes aux mots afin de leur donner un peu de poids.
Une seule lettre substituée à une autre et tout change, ainsi « à la longue » engendre « ça fait / drôle / à / la langue / ces mots / qui / parfois / remontent ». L’ironie est partout perceptible, elle est le voile pudique d’une désespérance qui en vient, aux dernières pages, à disloquer les vocables de manière imprononçable : « J’a / i pas les m /ots / on m / e dit / ça », « il est t / ard dé / jà j / e / tombe / avec la / dernière a / ile ». Rassurons-nous. Si l’auteur en peine déclare : « j’ / aurais pas / dû / faire / papillon », il n’y a aucun risque qu’il en déduise « j’aurais dû faire / robot ».
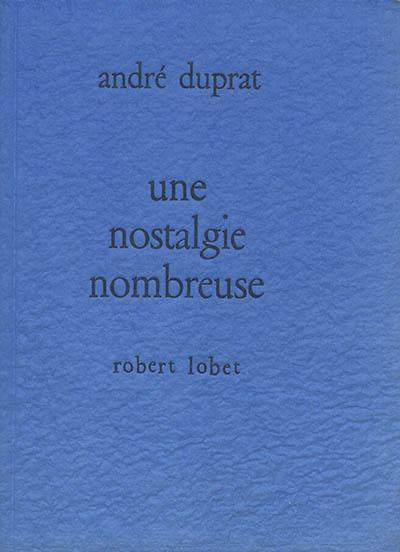
Le manuscrit d’Une nostalgie nombreuse a reçu une bourse de la SGDL en 2014, soit cinquante-deux ans après que l’Algérie ait conquis son indépendance. Quel sens comporte pour l’auteur le fait de revenir après plus d’un demi-siècle sur le sort des Pieds-Noirs ? Cette dénomination, il n’en affuble pas Hélène. La jeune fille qu’elle était alors se distinguait par son « murmure de traverse », qui prendra corps dans « une fraternité de parole ». En France, où elle est devenue infirmière, la fraternité perdure dans les gestes : «Tu conjugues Alger / entourant et soignant l’algérien arrivé d’Algérie ». Cette conjugaison en silence, il appartient au poète d’en faire parole. L’écriture d’André Duprat est claire, précise, joue volontiers avec les mots pour faire craquer les expressions toutes faites. Loin de viser à la complicité avec le lecteur, elle a pour but de le précipiter dans l’inattendu, d’éveiller sa conscience.Des encres de l’artiste Robert Lobet parsèment le texte. Elles aussi conjuguent Alger, dans la lumière.
Brigitte Gyr se souvient d’une enfance perdue, sur un tout autre mode, puisque, dans Le vide notre demeure, c’est elle-même qui se donne parole. Elle n’exprime pas une nostalgie, elle constate : « Un fil nous relie / au moi absent / de temps défendus ». Ces trois vers, les premiers du livre, ne pourraient pas émaner d’un robot. Nul fil ne le connecte tant au passé qu’au futur. Il réagit au présent, non en fonction d’un autrefois ou d’un naguère disparus, non plus que d’un avenir incertain.
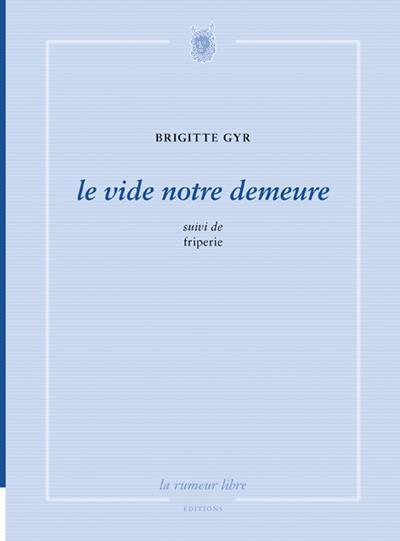
Sans les autres, le soi ne saurait être complet. Quand Brigitte Gyr évoque le décor et les évènements de ses jeunes années, le sort qui leur est advenu ne lui est pas personnel. Toute une époque – pas toujours heureuse, parfois traversée de catastrophes, tel un incendie – s’est dépouillée de sens. Dès lors, « gens et bêtes sont pris de vertige ». Ce n’est pas moi, c’est nous qui nous retrouvons « enfouis / dans le non-lieu où / réside / l’ombre de nos rêves ». Notre aujourd’hui se caractérise par « la menace de la cendre / l’engloutissement de / la pensée / happée par / la jouissance du vide ». Lequel vide est, en fait, « comblé de déjections », il y traîne des paquets de linge sale, des coquilles sanglantes, des débris abjects. Certaines pages sont d’un pessimisme achevé : « même la transgression a / perdu son sens ».
Comment résister ? Une ironie, fût-elle désabusée, se fait jour : « l’approximation mentale / du chantier de la mort / est une tâche ardue / une vie n’y suffit pas ». Par endroits, elle invite le lecteur à la remémoration en insérant trois points entre crochets. Le vide notre demeure soulève en dernière page « un espoir léger d’alliance » teinté de volontarisme, « pour nous, l’origine d’un avenir ». Il a son pendant à la fin de Friperie, seconde partie du livre, dédiée à Christian Boltanski et qui l’achève sur une injonction : « Bâtir un lit de poussière y / enterrer le vide / faire œuvre régénératrice ».
Françoise Hàn
Jean-Pierre Chevais, Le temps que tombent les papillons Editions Rehauts, 82 pages, 13 euros. rehauts.fr André Duprat, encres de Robert Lobet, Une nostalgie nombreuse Editions Jacques Brémond, 62 pages, 18 euros. Brigitte Gyr, Le vide notre demeure, suivi de Friperie La rumeur libre, 76 pages, 15 euros.
