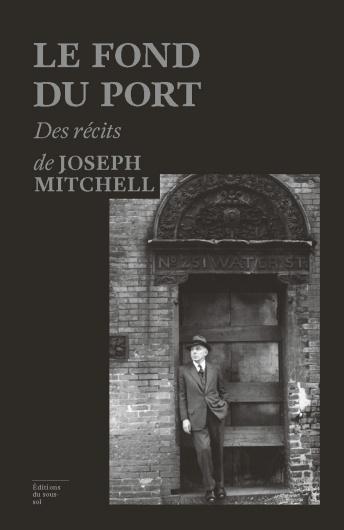 Depuis sa création, en 1925, le New Yorker s’est acquis la réputation indisputée – et justifiée – d’être le plus littéraire des magazines américains. On sait qu’il était le fief des plus grands nouvellistes du siècle passé, de Salinger aux trois « John » – Cheever, O’Hara, Updike – en passant par Nabokov ou, plus récemment, Ann Beattie.
Depuis sa création, en 1925, le New Yorker s’est acquis la réputation indisputée – et justifiée – d’être le plus littéraire des magazines américains. On sait qu’il était le fief des plus grands nouvellistes du siècle passé, de Salinger aux trois « John » – Cheever, O’Hara, Updike – en passant par Nabokov ou, plus récemment, Ann Beattie.
On sait aussi que le New Yorker ne publie pas essentiellement de la fiction, mais que toutes les textes qui y paraissent – du moins quand il sont signés par des collaborateurs réguliers -, nouvelles, récits ou reportages, sont marqués du sceau de l’authentique littérature, ce serpent de mer qu’on n’arrive jamais à définir, mais qui, pourtant, existe.
Du coup, on en arrive à lire des auteurs uniquement parce qu’ils portent le label « New Yorker ». Et on est rarement déçu. Joseph Mitchell (1908-1996) et A. J. (pour Abbott Joseph) Liebling (1904-1963), par exemple. Tous deux étaient officiellement « reporters » au New Yorker, tous deux y avaient un bureau, tous deux écrivaient ce que les Américains appellent de la « non-fiction » et que les Français ne lisent pas. Ils se connaissaient bien, forcément, et devaient fréquenter les mêmes bars de Broadway.
On les découvre peu à peu chez nous : Mitchell parce qu’il a fini par devenir une légende américaine, adulé par des admirateurs célèbres, et qu’on ne peut plus l’ignorer totalement, et Liebling parce que la France était son pays d’adoption, et qu’il aimait Paris et ses restaurants autant que New York et ses combats de boxe.
Joseph Mitchell, d’abord. Il passa cinquante-huit ans au New Yorker. Dont trente-et-un (1965-1996) sans y publier aucun article. Pourtant, il était présent tous les jours, « se rendait tous les matins à son bureau, accrochait à la patère manteau et chapeau, assemblait ses notes et tapait à la machine, mais pourtant ne publiait rien… », ainsi que l’écrit son biographe. Le personnage, cet écrivain muré dans le silence, a quelque chose de romanesque. Il fait évidemment penser au Bartleby de Melville, ce qui est pour beaucoup dans la fascination qu’il suscite. Mais s’il est redécouvert aujourd’hui (et si une biographie lui a été consacrée), c’est aussi parce qu’il incarne un Manhattan disparu, celui qu’il a découvert en 1929, venu de sa Caroline du nord natale.
Ses articles sont des reportages-portraits – qui se donnent pour réels, mais sont souvent imaginaires – mettant en scène des personnages connus dans le Manhattan qu’il voyait fondre sous ses yeux, peu à peu remplacé par le New York que l’on connaît. Ils ont été rassemblés de son vivant dans quelques recueils, dont Le Fond du port (1960), qui paraît aujourd’hui en France. Ces six longs récits (parus dans le New Yorker entre 1944 et 1959) parlent de l’eau qui entoure Manhattan, du port et de ses restaurants, des pêcheurs d’huîtres, des capitaines de chalutiers, des vieux Noirs, comme des fantômes d’un autre temps, de Staten Island.
Quand leurs portraits sont publiés, ils incarnent un monde déjà enfoui. Mitchell est comme l’explorateur d’un paysage humain qui tombe en poussière, aussi fragile que des ailes de papillon, et qu’il met sur le papier avec une extraordinaire minutie. Il accumule les termes techniques surannés, donne la parole à ses personnages avec une rare empathie, les fait parler de leur passé qui, pour certains, remonte aux années 1900, et même au-delà. Ce sont les fantômes de l’Amérique de Mark Twain qui, sous nos yeux, sortent de leur suaire, et se racontent, avant de se dissoudre dans la mort et l’oubli.
L’écriture de Joseph Mitchell – surtout dans les longues phrases sinueuses de Street Life (éditions Trente-trois morceaux, 2016) où il esquisse son autobiographie new-yorkaise – rappelle celle de James Agee, quand celui-ci, dans Louons maintenant les grands hommes, un des plus grands livres américains du XXe siècle, portait témoignage sur une population et un mode de vie – celui des petits paysans blancs d’Alabama – en cours d’effacement. Joseph Mitchell n’est pas indigne d’Agee, et c’est assez pour qu’on puisse prédire qu’il sera un jour un classique américain indiscuté.
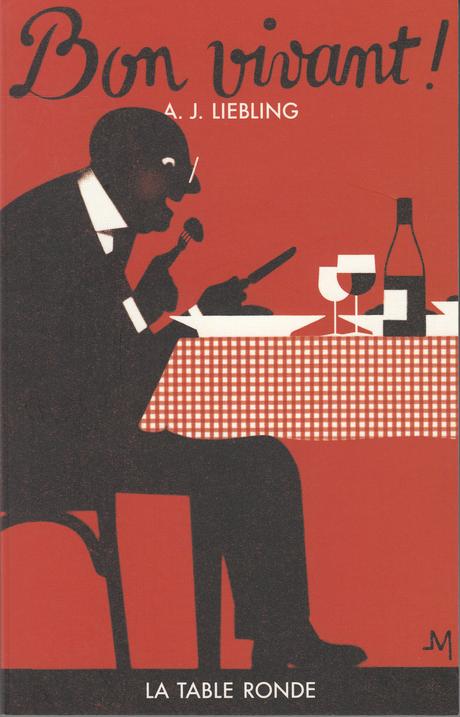
Between Meals ne raconte pas Manhattan, mais Paris, vu à travers ses restaurants, entre les années vingt et le début des années soixante. C’est un livre assez étonnant, une autobiographie gastronomique, dans laquelle l’écrivain se livre à des réflexions sur le temps qui passe et témoigne, comme Mitchell, sur un monde disparu.
En ce qui concerne les années vingt, Liebling est un anti-Hemingway, et Bon vivant ! l’envers de Paris est une fête : le jeune New Yorkais ne fréquente pas La Rotonde, ni les milieux artistes de Montparnasse, mais les meublés d’étudiants et les restaurants à prix fixe du Quartier Latin ou de la rue des Beaux-Arts. Plus tard, lors de l’un de ses nombreux séjours en France, il émigre sur la Rive Droite, vers le square Louvois, près de l’ancienne Bibliothèque Nationale, et découvre des restaurants gastronomiques dissimulés derrière des vitrines poussiéreuses dignes du Paris tortueux de Balzac. Puis la lumière baisse, c’est le Paris des premiers mois de la guerre, quand on n’y croit pas encore vraiment, mais qu’on a peur, et qu’un certain monde s’étourdit dans la gaieté factice des dernières fêtes, puis le Paris de l’après-guerre, un Paris grisâtre et en butte au rationnement.
Liebling, quand il écrit ce livre (ou, plutôt, rassemble les morceaux qui le composent) vit dans la nostalgie, mais c’est un nostalgique gai. Son récit s’ouvre en fanfare sur un portrait savoureux de son ami Yves Mirande, dramaturge fêté dans les années trente, aujourd’hui injustement oublié, qui a laissé une oeuvre de cinéaste et de scénariste parmi les plus personnelles et les plus brillantes de son époque, et il donne envie de revoir les films de Mirande, de relire ses excellents Souvenirs. Liebling parle admirablement de cuisine et de vins, évoque un côte-rôtie avec le même naturel et la même justesse qu’il évoque Dickens ou Kipling (le bon vin et la bonne littérature sont affaires de civilisation, et Bon vivant ! est une leçon de civilisation), et sème son récit de remarques parfois hilarantes : « Quand Henry Miller écrit sur des fêtards aussi entrelacés que les fils d’une tapisserie humaine, c’est avec un enthousiasme solennel. (Arrivé à Paris à trente-neuf ans, il décrit la noce comme un gamin découvrant sur le tard le banana split.) » On ne saurait mieux dire, et mieux juger les pesants ébats de La Crucifixion en rose !
Liebling a publié beaucoup plus de livres que Mitchell. Mais si l’oeuvre de l’un est maintenant quasiment complète en France (ne manquent chez nous que deux recueils de récits de l’auteur du Fond du port), celle de l’autre, pourtant francophile, est encore un continent inconnu. Espérons que Bon vivant ! n’est que le début de son exploration.
Christophe Mercier
Joseph Mitchell, Le Fond du port Traduit de l'américain par Lazare Bitoun Editions du sous-sol, 250 pages, 22 € A.J. Liebling, Bon vivant ! Traduit de l’américain par Jean-Christophe Napias La Table Ronde, 250 pages, 17,4 €
