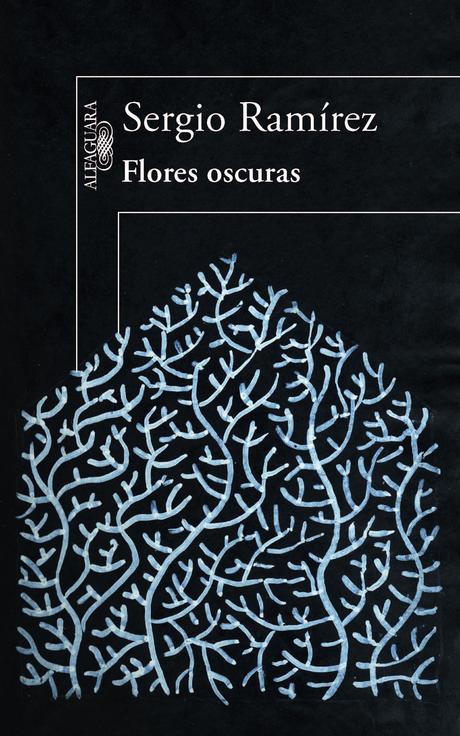 Né au Nicaragua en 1942, Sergio Ramírez est une des grandes figures du monde politique et littéraire de son pays. Homme politique, Il s’est engagé – aux côtés de Daniel Ortega, leader du FSLN, Front Sandiniste de Libération Nationale – dans la révolution sandiniste qui a mis fin en 1979 à la dictature d’Anastasio Somoza, et a été vice-président du Nicaragua entre 1984 et 1990.
Né au Nicaragua en 1942, Sergio Ramírez est une des grandes figures du monde politique et littéraire de son pays. Homme politique, Il s’est engagé – aux côtés de Daniel Ortega, leader du FSLN, Front Sandiniste de Libération Nationale – dans la révolution sandiniste qui a mis fin en 1979 à la dictature d’Anastasio Somoza, et a été vice-président du Nicaragua entre 1984 et 1990.
Avocat de formation, Sergio Ramírez a également été professeur des universités du Maryland et de Berlin, et il a été élu, en 1968 et 1976, secrétaire général de la Confédération des universités d’Amérique centrale. Journaliste, il est chroniqueur dans plusieurs journaux hispanophones, dont les quotidiens El País (Espagne), El Tiempo (Colombie), La Jornada (Mexique), El Nacional (Venezuela), La Prensa (Nicaragua), Prensa libre (Guatemala) et La Opinión (Californie).
Romancier, essayiste, mémorialiste et poète, son œuvre littéraire importante et abondante a été couronnée de nombreux prix : Prix Dashiell Hammett pour Castigo divino en 1988, roman qui sera publié en français aux éditions Denoël en 1994, sous le titre Châtiment divin ; Prix Laure Bataillon du meilleur roman étranger traduit en français pour Un baile de mascaras (Le Bal des masques, éditions Payot et Rivages, 1998) ; Prix du roman Alfaguara et Prix latino-américain du roman Jose Maria Arguedas pour Margarita está linda la mar ; Prix latino-américain des lettres Jose Donoso pour l’ensemble de son œuvre littéraire (Chile, 2011) et Prix international Carlos Fuentes à la création littéraire en espagnol (Mexico, 2014). Ont également été publiés en français, son roman El cielo llora por mí (2009) sous le titre Il pleut sur Managua (éditions Métailié, 2011) ainsi que son ouvrage Adiós muchachos (1999) sous le titre Adiós Muchachos ! Mémoires de la révolution sandiniste, (éditions Syllepse, 2004). Sergio Ramírez a, par ailleurs, reçu le Prix Cervantes 2017, en novembre dernier, pour sa capacité à refléter « la vivacité de la vie quotidienne en faisant de la réalité une œuvre d’art ».
Le texte que nous publions ici, intitulé Le Bus jaune, est inédit en français et traduit par nos soins. Il fait partie du recueil Flores oscuras (Fleurs obscures) publié en 2013 aux éditions Alfaguara. Les personnages mis en scène dans chacune des douze nouvelles de l’ouvrage doivent affronter leurs propres conflits internes et leurs secrets qu’ils leurs appartient ou non de révéler.
Marc Sagaert
Le Bus jaune
Pour Edgardo Rodríguez Juliá
Le jeune homme auquel cette histoire fait référence a disparu, à deux heure de l’après-midi, un dimanche de Pâques. Une fois la déferlante franchie, il se laissa balancer au rythme des vagues face au ciel, paraissant y prendre plaisir. La dernière image que l’on vit de lui est cette main tendue, que l’on aurait bien pu prendre pour un signe joyeux à son épouse qui se baignait, l’eau aux chevilles, protégeant ses cinq mois de grossesse, jusqu’à ce que les reflets du soleil, une intense trainée d’écailles argentées sur l’onde en mouvement, ne permettent plus de le voir. C’est à ce moment-là que le courant le saisit de ses griffes invisibles, mais quelques minutes passèrent, peut-être trois, avant qu’une quelconque inquiétude ne s’immisce dans l’esprit de sa femme. Un farceur. Voilà ce qu’il était. Il était certainement en train de revenir en nageant sous l’eau, se cachant, et il serait bientôt de nouveau à ses côtés, secouant la tête, dans une explosion d’écume qui viendrait l’éclabousser complètement.
Rien de cela n’arriva. Elle le cherchait en redressant la tête à se faire mal aux tendons du cou, mais par-delà la crête lointaine de la dernière vague, il n’y avait rien d’autre qu’un va-et-vient désolé et ensuite il ne lui fut plus possible de voir quoi que ce soit, parce que le soleil dans un scintillement d’étincelles aveuglait ses pupilles enflammées. Ce fut d’abord l’incrédulité, puis l’incertitude, un vide dans l’estomac, l’angoisse étranglée dans la gorge, l’effort désespéré pour se remplir la tête du mot mensonge, mensonge, mensonge, en essayant de contenir la peur qui cependant débordait soudain comme le liquide qui s’échappe par les brèches d’un vase cassé.
Elle ne s’en était pas rendu compte mais les passagers du bus jaune l’entouraient, frissonnants, mouillés, les jambes pleines de sable. Certains avaient une bouteille de bière à la main, et ceux qui avaient bu du rhum dans des verres en plastiques étaient déjà ivres. Juan de Díos, qui avait convaincu le couple de faire la promenade, mettait ses mains en visière pour essayer de mieux voir la distance soudain sombre comme à la tombée du jour, alors que la haut, le soleil était toujours indifféremment ardant.
Ni Juan de Díos ni les autres ne lui parlaient, ou était-ce qu’elle n’écoutait pas les voix. Au loin, elle avait entendu crier un noyé, un noyé, un noyé, cris d’un autre monde duquel une membrane trouble la séparait. Il a été emporté par le courant, cria quelqu’un d’autre, comme en sourdine, et derrière cette membrane elle vit l’estampille de centaines de baigneurs qui couraient hors de l’eau comme si le courant allaient aussi les emporter, et elle vit les deux sauveteurs de la Croix rouge qui s’étaient jetés à l’eau et nageaient rapidement pour arriver à l’endroit où le jeune homme avait disparu en levant la main.
C’est comme si il m’avait dit adieu, pensa-t-elle. Elle secoua la tête pour se sortir cette idée de l’esprit et de nouveau mensonge, mensonge, mensonge, et la peur s’écoulant sans bruit par les fentes du verre brisé. Mais, comme si tout à coup la membrane tourbe se déchirait, elle s’entendit crier mensonge, mensonge, mensonge et elle entendit ses gémissements bouillonner dans sa gorge tandis qu’elle sentait que la chaleur des bras brûlés de soleil de plusieurs personnes ayant fait le voyage avec elle dans le bus, la retenaient avec une énergie affectueuse parce qu’elle voulait s’échapper, sans savoir vraiment où elle voulait aller. Se mettre à l’eau, suivre les secouristes, les rattraper, revenir tous ensemble le rapportant sain et sauf à la côte, tu m’as fait une de ces frayeurs, ne me fais plus jamais ça s’il te plait, rappelle-toi que j’aurais bien pu perdre l’enfant, et tu en aurais été le seul coupable. L’enfant, ils voulaient l’appeler Félix, comme lui. Elle l’appelait le junior quand elle lui parlait pour l’habituer à sa voix, et elle demandait au jeune homme de le faire également, elle lui prenait la tête et l’approchait de la peau tendue de son ventre dénudé pour que sa voix parvienne au plus près de l’enfant, hello petit ours brun, tu seras un charmeur comme ton papa. Ils savaient déjà, grâce aux ultrasons, que ce ne serait pas une fille, auquel cas, ils l’auraient appelé Cindy, comme elle.
Quelqu’un qu’elle ne connaît pas, un nageur quelconque plus tout jeune, se trouvant parmi les passager du bus jaune, dit à un pécheur à la peau noircie par le soleil, vêtu d’un seul short en haillons : que ce courant est comme un fouet en liberté, si on se laisse porter sans opposer de résistance, il vous rend sain et sauf à la rive. Il le dit avec le calme de la sagesse, et elle, à l’entendre, aimerait courir en direction de la rive, même s’il est clair que ses pieds ne vont lui obéir et que les femmes converties pour elle en protectrices, l’empêcheraient de le faire, car son ventre de cinq mois ne le permettrait pas. Le pêcheur à la peau noirâtre, regarde d’abord le nageur avec une certaine condescendance devant la fausse sagesse de ce dernier, porte le regard vers la mer et ensuite hoche la tête sans dire un mot, mais elle ne le voit pas parce qu’à ce moment, elle-même baisse la tête et se frotte les yeux avec force.
Les secouristes reviennent et une foule coure jusqu’à eux et les entoure. Juan de Díos et deux ou trois personnes du groupe de l’autobus jaune vont aux nouvelles. Deux policiers arrivent sur une même moto. L’un d’eux est une femme, assez grosse, montée en croupe. Les pantalons de son uniforme sont trop étroits pour elle. Tous deux descendent de moto et se frayent un chemin afin de parler aux secouristes. Ils écoutent un instant puis regardent dans la direction de la femme, entourée, protégée et qui attend. Après un moment de délibération, c’est la policière qui s’avance d’un pas tranquille accompagnée de Juan de Díos et de deux ou trois personnes du groupe.
L’anxiété de la femme est comme les ténèbres dans laquelle on ne peut avancer, un cachot dont la policière a peut-être la clé. Cependant bien qu’elle le veuille, elle n’entend pas ce qu’on lui dit, comme si on lui parlait une langue étrangère que les femmes qui l’entourent traduisent aimablement pour elle : ils vont trouver un bateau, les pêcheurs de la coopérative disent qu’ils peuvent prêter un des leurs mais qu’il faut mettre de l’essence, ils ont fait une collecte entre tous les passagers du bus, et comme l’assure Juan de Díos, quand ils auront rempli le réservoir du moteur, ils pourront y aller. Les sauveteurs de la Croix rouge iront avec le motocycliste, c’est tout ce qu’ils peuvent faire pour le moment. Si elle veut attendre au poste de police, aucun souci, il n’est pas loin d’ici (…).
Non, elle ne bougera pas d’ici, elle veut rester où elle est. Pourquoi faire ?, semble lui demander du regard la policière. Je vais attendre, lui répond-elle, également du regard. Vous pourriez attendre sous l’abri de la côte, lui propose la policière, ainsi vous n’aurez pas à rester en plein soleil, ce n’est pas bon pour votre bébé. Non, intervient une des accompagnantes solidaires, la plus vieille de toutes, qui pourrait être sa mère et se plait à jouer un peu ce rôle, il y a trop de gens ivres et la musique est à plein volume.
Elle s’aperçoit enfin du bruit parvenant de l’abri et qui ne s’est pas tu. Les baigneurs sont retournés en groupe se mettre à l’eau et s’ébattent entre les vagues, il y a un moment déjà. D’autres ouvrent leur thermos à la recherche de boissons, prennent le soleil étendus sur le sable, se promènent en couple, les enfants montent sur les chevaux qu’ils ont loués. Que le jeune homme ait disparu au large paraît un fait passé, quelque chose d’oublié.
Tu ne veux pas que l’on aille te chercher une chaise ?, lui demande la femme qui s’est positionnée dans le rôle de la mère. Non, répond la femme. Quoiqu’il en soit, une petite chaise de plastique blanc est apportée. Et sa propriétaire lui fait par ailleurs cadeau d’une bouteille de soda avec une paille qu’elle refuse d’un merci à peine audible. Elles l’aident à s’assoir et les pieds de la chaise s’enfoncent dans le sable (…) Elle a les yeux enflammés et rougis comme si elle avait pleuré, mais en réalité elle n’a pas versé une seule larme malgré ses sanglots.
Attendre. Il faut attendre Il n’y a qu’à attendre. L’attendre. C’est un bon nageur, il peut le supporter. Ou flotter sur le dos pour ne pas perdre ses forces avant que l’on vienne le chercher. Quand ils le ramèneront, ils rentreront tôt avec le bus jaune, tout le monde ayant envie de s’en aller après cet incident. Une insolation, c’est tout ce qu’il va gagner, la peau en feu, une grande brûlure. Quand ils retourneront à Managua il faudra aller chercher une pommade pour la peau, des pastilles pour le coup de chaud. Elle croyait en tout cela, parce qu’elle se le disait à elle-même ; si l’une des femmes qui l’entourent lui avait parlé pour la consoler de l’insolation, de la peau brulée, de la pommade, des pastilles, elle aurait de nouveau recommencé à sangloter (…)
Sergio Ramírez
