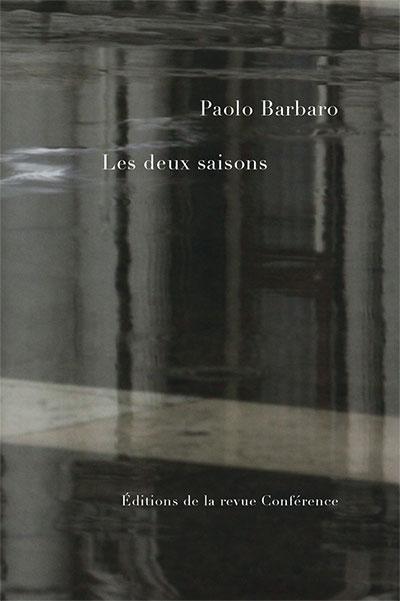 La disparition du romancier et ingénieur Paolo Barbaro est passée presque inaperçue en France, il y a quatre ans. Il s’agit pourtant d’un des écrivains italiens les plus originaux de l’après-guerre et d’un des défenseurs les plus ardents de Venise, où il a situé la plupart de ses romans et où il a pour ainsi dire toujours vécu. Presque intégralement traduite en français, son œuvre n’est pas seulement centrée sur sa ville, mais, plus largement, aborde la question de la destruction de la planète et celle de la migration des hommes.
La disparition du romancier et ingénieur Paolo Barbaro est passée presque inaperçue en France, il y a quatre ans. Il s’agit pourtant d’un des écrivains italiens les plus originaux de l’après-guerre et d’un des défenseurs les plus ardents de Venise, où il a situé la plupart de ses romans et où il a pour ainsi dire toujours vécu. Presque intégralement traduite en français, son œuvre n’est pas seulement centrée sur sa ville, mais, plus largement, aborde la question de la destruction de la planète et celle de la migration des hommes.
L’Afrique, la Patagonie ont également inspiré cet écrivain qui ne correspond pas à l’idée préconçue que l’on pourrait se faire d’un érudit vénitien, amoureux de palais, de ruelles et de canaux, rêvant avec un désespoir nostalgique à une splendeur passée et fragile. Militant actif de la cause écologique, il s’est, précisément, servi de son expérience vénitienne pour réfléchir sur ce que l’homme doit faire pour résister à la lente dégradation du monde, sur le plan humain, urbanistique, économique, hygiénique. Ses livres, élégants et sophistiqués sans être artificiels, ont souvent des structures complexes qui font alterner une voix intime et réflexive, et une description imaginaire ou objective de relations et de situations romanesques.
Paolo Barbaro laissait en mourant deux manuscrits de factures différentes qui sont ici réunis en un seul volume, par cohérence thématique, quoique le lien ne soit pas immédiatement évident. La première partie est un bref roman qui raconte la liaison éphémère d’un assureur quadragénaire marié et père de famille avec une femme mûre, en instance de divorce. Il vit à Trieste, sur le continent, et deux fois par semaine se rend pour des raisons professionnelles à Venise, avec des collègues. Par hasard, se perdant dans les calli de la Sérénissime, il parle avec une inconnue qui le remet sur le bon chemin et qu’il retrouve quelques minutes plus tard sur un vaporetto. Ils se plaisent. Elle lui donne incidemment son adresse. Il s’y rendra et ils deviennent, le plus naturellement du monde, amants, sans se poser la question de l’avenir, et lui se posant à peine celle de la trahison de sa femme, de l’adultère.
Leurs retrouvailles sensuelles, régulières confirment leur entente, presque muette. Ils se promènent ensemble dans la lagune. Ils ont un même regard esthétique sur le monde. Et cette situation clandestine, sans être morbide ni perverse, donne lieu à de très belles pages sur Venise, que l’auteur connaît comme sa poche, mais qui jamais ne le laisse blasé. Ce constant émerveillement pour l’architecture et les lumières fait de cette première partie un document extraordinairement précieux pour les amoureux de Venise. Auteur d’un Petit guide sentimental de Venise, Paolo Barbaro est un des meilleurs connaisseurs de sa ville. Et il y a quelque chose de paradoxalement insolite à lire ses promenades dans ce décor qui a si souvent occasionné des stéréotypes pour tant de livres médiocres au pittoresque facile. On se promène avec lui dans une Venise intérieure, telle que l’a décrite Thomas Mann, telle que l’ont connue Henry James, Marcel Proust, Ruskin et D’Annunzio.
C’est au moment où il est muté à Venise et peut s’y installer totalement que son personnage va rompre avec sa maîtresse elle-même déménageant pour Milan. Et vainement il tentera d’en retrouver les traces.
Ce roman sur une double vie serait, bien sûr, somme toute assez ordinaire s’il n’était situé à Venise et n’était accompagné de rêveries qui dépassent le destin des personnages. La ville elle-même, inévitablement, devient une protagoniste, comme une ombre tour à tour bienveillante et menaçante, protégée et menacée, comme le sont ses palais et ses cimetières. La mort est là, ce n’est pas une grande découverte, dans chacun des recoins des campi et des ponts, des églises et des musées. Mais une mort qui peut être triomphante, impériale presque joyeuse.
Paolo Barbaro rappelle qu’avant que l’île de San Michele ne serve de cimetière exclusif de Venise, les morts étaient enterrés un peu partout et s’accumulaient tant qu’il fallait régulièrement les alléger de leurs ossements que l’on transportait sur une île, celle de Sant’Ariano, où ils étaient tellement entassés qu’ils avaient fini par former une véritable colline qui parfois, les soirs d’été, prenait feu, dans un grand ballet de feux follets enflammés par l’excès de phosphore…
La réflexion sur la mort habite toute la narration de ce récit d’adultère. Le narrateur là-dessus ne se fait pas d’illusion. « Contre la mort, contre la fin sans issue, contre les gondoles noires et les ponts solitaires, nous avons les brèves ressources de l’amour — sa magie incertaine. Mais si l’amour, au fond, n’était qu’une toute petite partie du jeu, une partie inévitable, s’il n’était que cela, notre tentative éperdue de tenir à distance notre peur récurrente d’être seuls au monde, et de toute façon, seuls ou non, de devoir déménager, de devoir descendre au plus vite ? »
La deuxième partie poursuit ces réflexions, mais de manière plus directe et subjective. L’auteur tient un journal où il consigne son angoisse de la grande vieillesse. L’excellente postface d’Ilaria Crotti le présente comme un De Senectute. Sans doute y a-t-il beaucoup de sagesse dans cette attente de la mort, avec quelques réminiscences sensuelles d’amours de jeunesse, et avec des scènes assez saisissantes où l’auteur, tout en prenant conscience de sa perte d’autonomie qui désormais l’empêche de se promener comme bon lui semble dans sa ville, retrouve une énergie intérieure. Immobilisé sur les Zattere, à cause d’une avanie de l’ambulance qui le transporte et qui est forcée de s’arrêter à quai, il observe autour de lui quelques étudiants auxquels, parce que désormais très vieux et infirme, il est devenu invisible.
Encore vivant pourtant, il jette sur le monde qui l’abandonne un dernier regard que nous pouvons partager au-delà de sa mort. Venise que la présence des paquebots, l’été, monstrueuses villes flottantes qui font dangereusement monter les eaux et ébranlent par leurs effrayantes vibrations les fragiles fondations des palais séculaires, fragilise encore plus que la pollution des eaux, en a-t-elle encore pour longtemps ? Paolo Barbaro tourne alors, tel Leopardi, les yeux vers les étoiles et la Lune dont il sait que peu à peu son orbite l’éloigne de la Terre (deux kilomètres, dit-il depuis sa naissance) et qui peut-être ne sera plus dans quelques millénaires l’observatrice et l’interlocutrice de rêveurs comme lui.
René de Ceccatty
Les deux saisons, de Paolo Barbaro Traduit de l’italien par Christophe Carraud Editions de la revue Conférence, 248 p., 20 €
