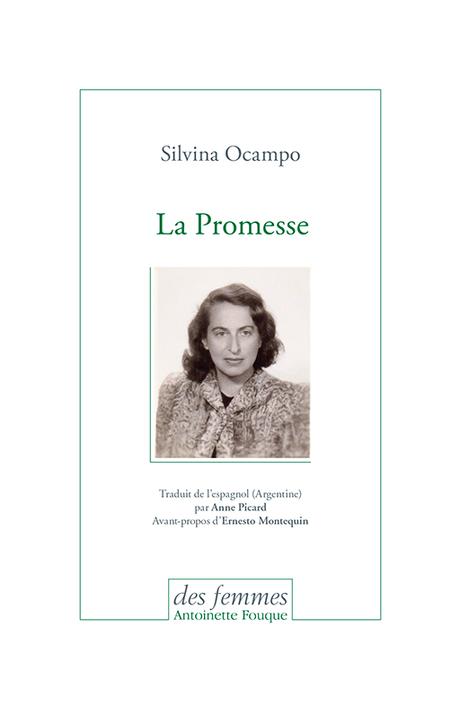 Silvina Ocampo (1903-1993) est une des grandes figures de la littérature argentine. Elle a d’abord étudié la peinture et le dessin à Paris avec Giorgio De Chirico, avant de se consacrer à l’écriture. Entourée de figures littéraires imposantes, son mari, Adolfo Bioy Casares, son ami Jorge Luis Borges et sa sœur aînée, Victoria Ocampo, fondatrice de la célèbre revue Sur, elle cultive indépendance et discrétion. « J’écris, confie-t-elle à Maria Moreno en 2005, parce que je n’aime pas parler, pour donner un témoignage de plus à la vie ou pour lutter contre cet excès de matière qui a tendance à nous enfermer. »
Silvina Ocampo (1903-1993) est une des grandes figures de la littérature argentine. Elle a d’abord étudié la peinture et le dessin à Paris avec Giorgio De Chirico, avant de se consacrer à l’écriture. Entourée de figures littéraires imposantes, son mari, Adolfo Bioy Casares, son ami Jorge Luis Borges et sa sœur aînée, Victoria Ocampo, fondatrice de la célèbre revue Sur, elle cultive indépendance et discrétion. « J’écris, confie-t-elle à Maria Moreno en 2005, parce que je n’aime pas parler, pour donner un témoignage de plus à la vie ou pour lutter contre cet excès de matière qui a tendance à nous enfermer. »
Ses nouvelles, fantastiques et policières, sont empreintes parfois d’une certaine cruauté, parce qu’elles sont, comme elle le dira elle-même, « tout droit sorties de la réalité ». Auteure d’une œuvre poétique délicate qui lui valut à deux reprises le prix national de poésie, elle écrit également des contes pour enfants, une pièce de théâtre, différents essais et trois romans. Elle excelle dans les petites formes, qu’elle affectionne, dans cette brièveté qu’elle revendique comme une impatience.
Son recueil de nouvelles Faits divers de la terre et du ciel est paru en français chez Gallimard, en 1974, dans la collection « Du monde entier » avec une préface de Jorge Luis Borges et une introduction d’Italo Calvino. Ceux qui aiment haïssent, écrit avec Adolfo Bioy Casares, est sorti aux éditions Christian Bourgois en 1989. Mémoires secrètes d’une poupée, chez Gallimard en 2012. Les excellentes Éditions des Femmes-Antoinette Fouque ont publié il y a quelques mois la Promesse – bientôt disponible également en audio-livre, grâce à la lecture de Florence Delay –, et s’apprêtent à éditer Sentinelles de la nuit.
Commencé en 1960, la Promesse a été repris par intermittence et terminé entre 1988 et 1989, alors que la romancière était déjà gagnée par la maladie. Des dires de l’auteure, ce « roman fantasmagorique » est « ce qu’elle a écrit de mieux ». Cette sorte d’autobiographie posthume est en tout cas un petit bijou et une manière de testament, qui, comme l’écrit Ernesto Montequin dans sa préface, « anticipe en même temps, avec une ironie tragique, la fin qui, dix ans plus tard, allait réunir dans un destin similaire la protagoniste et son auteure ».
Après être tombée d’un bateau où elle voyageait, la narratrice flotte à la dérive. La protagoniste raconte, comme si la promesse qu’elle a faite de dire sans cesse les choses, interminablement, était susceptible de repousser l’échéance d’une fin certaine : « Comme Schéhérazade avec le roi Shahryar, d’une certaine manière, j’ai raconté des histoires à la mort pour qu’elle me gracie moi et mes images, des histoires dont on aurait dit qu’elles n’allaient jamais s’achever. » Alors que « le goût de l’écume est un goût de nuage », elle raconte et raconte encore. Et le temps s’étire en cadence, nouvelle métrique de l’instant. Elle retrouve le temps de l’enfance, « un temps à double largeur, comme les tissus d’ameublement ».
Dans le désordre de son esprit capricieux, la narratrice « commence une liste de personnes et à les décrire ». Que les récits de ce « dictionnaire de souvenirs » fassent quelques lignes ou quelques pages, les descriptions sont minutieuses, presque biographiques. Elles composent un chœur d’une trentaine de voix, le plus souvent autonomes. Ou bien qui filent au contraire la même histoire, tout au long du roman. Parce que « les souvenirs sont récurrents », certaines scènes se répètent. Des phrases se doublent, à l’identique ou presque, une ou deux fois dans le roman.
On y rencontre des arbres : « Un lilas de Perse aux fleurs violettes, comme des marguerites parfumées. » Un araucaria qui occupe la pensée. Un mollé d’Amérique. Un pacará. Des grillons qui chantent à crever les tympans. Des quadrupèdes qui ressemblent étrangement à des humains : « Zébu : taureau sacré originaire de l’Inde. Bos indicus. Gris: monsieur Arévalo ; Mouton de Somalie : tête noire, corps blanc : ma grand-mère ; Singe titi : houppe noire: docteur Ernesto; (…) Faisan argenté: ma maîtresse d’école »…
On y rencontre « une multitude de personnes qui perturbent la mémoire ». Comme ce Raul Ciro, rêvé jeune animal à la bouche sensuelle et à la peau cuivrée, dont « la bouche sombre qui a l’air d’un rein ou d’un bigoudi en mousse » est malheureusement bien réelle. Comme cette Gabriela, de jour « petite fille joyeuse, parfois insouciante, curieuse, indépendante », de nuit « sensible, soucieuse et angoissée ».
Une remontée dans les souvenirs, une galerie de portraits hauts en couleur et savamment croqués, d’une délicieuse cruauté : Aldo Bindo, petit homme sans âge « dont les éternuements (sont) contagieux même par téléphone » ; Aldo Fabrici, « tout voûté, les bras formant une anse de chaque côté du corps comme s’il transportait des arrosoirs, des seaux ou des outils de jardin » ; Cenaro Apparu, qui a une tête de lièvre et « dont le nom (porte) à confusion »; Ani Vlis, qui « ne (mérite) pas d’être aussi laide » ; Sara Conte, qui « offre à ses victimes » des cadeaux « insupportablement coûteux » : Malvina, « qui meurt deux jours avant son mariage » ; Gilberta Valle,« au visage d’hirondelle de mer », qui « a quatre-vingts ans et deux de plus qu’elle n’avoue pas » et qui finit volée, tuée avec une hache et découpée en petits morceaux…
« Je ne crois pas à l’apparence horrible des hommes, dit la narratrice, ni aux plus mauvais, ni aux plus injustes. Il y a des moments où une lumière parfaite les illumine et ils préfèrent mourir au pied de l’innocence ou de l’intelligence. » Mais elle précise aussi : « Dans chaque être se trouvent l’enfer et le ciel. L’enfer se voit plus clairement. »
Marc Sagaert
Silvina Ocampo, La Promesse Traduit de l'espagnol par Anne Picard Editions des Femmes/Antoinette Fouque, 132 pages, 13 €
