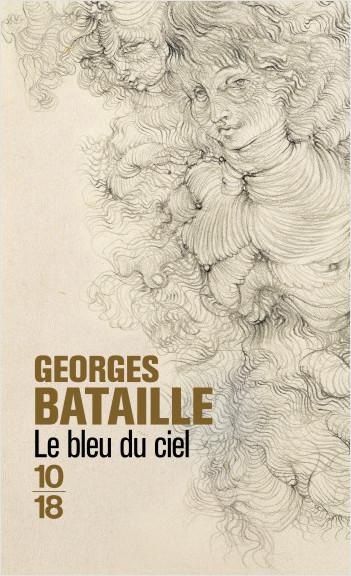 Georges Bataille achève d’écrire Le Bleu du ciel en mai 1935. Puis, il le jette dans un coin et l’oublie. Vingt-deux ans plus tard, en 1957, sur l’insistance de ses amis, il le laisse publier chez Pauvert. Dix ans seront nécessaires pour épuiser un tirage de 3 000 exemplaires. Aujourd’hui, ce livre longtemps méconnu, est considéré comme « un livre clé de notre modernité » (Philippe Sollers) J’ai acheté Le Bleu du ciel l’année même de sa publication. Depuis, il ne m’a jamais quitté. J’en possède plusieurs exemplaires, dans des éditions différentes — car depuis qu’il est sorti du purgatoire, les éditions se sont multipliées. Lire et relire Le Bleu du ciel dans de multiples éditions, qu’est-ce que cela pouvait bien signifier ? Ou plutôt, formulé autrement : quelle sorte d’engagement chacune de ces lectures déclenchait- elle chez le lecteur que j’étais ?
Georges Bataille achève d’écrire Le Bleu du ciel en mai 1935. Puis, il le jette dans un coin et l’oublie. Vingt-deux ans plus tard, en 1957, sur l’insistance de ses amis, il le laisse publier chez Pauvert. Dix ans seront nécessaires pour épuiser un tirage de 3 000 exemplaires. Aujourd’hui, ce livre longtemps méconnu, est considéré comme « un livre clé de notre modernité » (Philippe Sollers) J’ai acheté Le Bleu du ciel l’année même de sa publication. Depuis, il ne m’a jamais quitté. J’en possède plusieurs exemplaires, dans des éditions différentes — car depuis qu’il est sorti du purgatoire, les éditions se sont multipliées. Lire et relire Le Bleu du ciel dans de multiples éditions, qu’est-ce que cela pouvait bien signifier ? Ou plutôt, formulé autrement : quelle sorte d’engagement chacune de ces lectures déclenchait- elle chez le lecteur que j’étais ?
Reprenons la chronologie. 1935 : Le Bleu du ciel est terminé. 1957 : il est publié. La même année, je l’achète, le lis, en suis bouleversé. Les années suivantes, chaque fois que je relis Le Bleu de ciel, à l’occasion de ses rééditions, un même sentiment me cloue littéralement à même les mots. Un sentiment d’imminence, d’urgence panique, qui m’arrache à l’instant historique auquel le livre a été écrit pour me plonger jusqu’à la suffocation dans cet instant, également historique, auquel je le lis : 1960 (la guerre d’Algérie), 1968, 1974, 1983, etc. Il est vrai que Le Bleu du ciel porte la marque des circonstances dans lesquelles il a été écrit. Circonstances historiques, bien sûr, mais aussi circonstances personnelles, les unes et les autres inextricablement mêlées. 1934, en effet, est pour Bataille une année sombre. Pour l’Europe, c’est l’année de tous les dangers. À Paris, c’est le 6 février, la manifestation des ligues (Action française, Croix de feu, etc.) autour du Palais-Bourbon : 15 morts, 2 000 blessés. À Vienne, c’est le 25 juillet, l’assassinat du chancelier Dollfuss. En Allemagne, en Italie, c’est la marée montante du fascisme sous ses aspects les plus spectaculaires. Le 30 juin, la Nuit des longs couteaux a donné le ton. Trotski est expulsé de France. Le roi Alexandre de Yougoslavie est assassiné à Marseille. Etc., etc.
Bataille, qui a publié l’année précédente un long article consacré à « La structure psychologique du fascisme », est en pleine crise morale. Trois femmes hantent Le Bleu du ciel. Trois femmes que le récit rassemble autour du personnage de Troppmann. Par ordre d’apparition Dorothea, Lazare, Xénie. Sous le raccourci phonétique de Dirty, Dorothea ouvre le récit : « Dans un bouge de quartier de Londres, dans un lieu hétéroclite des plus sales, au sous-sol, Dirty était ivre. » Elle est là aussi dans la dernière scène, sur le quai de la gare de Francfort. « Elle disparut avec le train », note Troppmann avant d’assister au spectacle obscène d’un défilé de jeunes nazis : « devant eux, leur chef, un gosse d’une maigreur de dégénéré, avec le visage hargneux d’un poisson, marquait la mesure avec une longue canne de tambour-major. » Je rappelle que nous sommes en 1934. Quelques pages plus haut, Dorothea, dans les bras de Troppmann, lui avait demandé : « Il y aura bientôt la guerre, n’est-ce-pas ? » Elle portait alors une robe de soie d’un rouge vif, « du rouge des drapeaux à croix gammée » précise Bataille. De Lazare, qui intervient en second lieu dans le récit, on pourrait dire qu’elle est l’exacte antithèse de Dorothea. Autant la beauté de celle-ci est à la mesure de son indécence, autant Lazare concentre en elle tout ce qui peut éloigner Troppmann d’une femme. Bataille n’y va pas par quatre chemins : « laide et visiblement sale (…) elle était étrange, assez ridicule même (…) Sans chapeau, ses cheveux courts, raides et mal peignés, lui donnaient ses ailes de corbeau de chaque côté du visage (…) Lazare me répugnait physiquement. » Mais Lazare est une militante. Gagnée aux principes de communisme — mais d’un communisme bien différent du communisme officiel de Moscou — si elle se retrouve à Barcelone, c’est pour agir. Vers la fin du livre, tandis que des gens armés courent sur la Rambla, elle propose de s’emparer d’une prison. Troppmann-Bataille parle de « l’avidité maladive qui la poussait à donner sa vie et son sang pour la cause des déshérités ». Visiblement, Troppmann est fasciné par Lazare, « comme si ma chance, dit-il, exigeait qu’un oiseau de malheur m’accompagnât dans cette circonstance. »
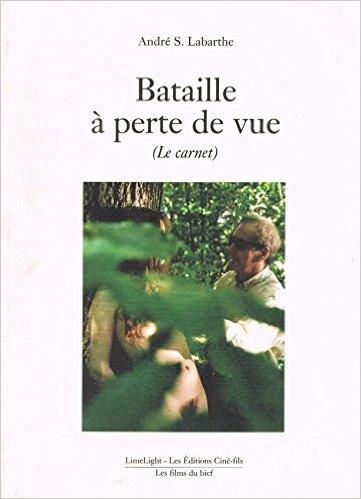
Au fond, ce livre, je n’ai pas envie de l’adapter au sens habituel du mot. Je n’ai pas envie non plus de le transposer à l’époque contemporaine en changeant décors et costumes. Je voudrais l’immerger dans l’époque, le voir s’y dissoudre, comme un morceau de sucre dans un verre d’eau, et imprégner le regard même que nous portons sur le monde qui nous entoure. La caméra qui va descendre dans les rues de Barcelone n’a aucune chance de rencontrer — à moins d’en reconstituer le décor — « les terrasses des cafés rentrées, les rideaux de fer des magasins à moitié tirés » dont parle Bataille. Il n’est pas question, non plus, de ressusciter les fantômes d’une époque révolue. La planète, hélas ! ne manque pas de théâtres d’opérations où l’on peut à chaque instant retrouver ces « rideaux de fer des magasins à moitié rentrés » et voir à l’oeuvre, comme l’écrit Bataille « la marée montante du meurtre ».
André S. Labarthe
Cet article a paru pour la première fois, au mois de mars 2004, dans le numéro 1 des Lettres Françaises. Nous le republions ici en hommage à André S. Labarthe, disparu le 5 mars 2018.
