 II y aura eu, oui, au futur antérieur, la Malédiction du bagne. Certes, ce titre prend acte d’une vérité, Genet n’achèvera jamais la pièce. Mais il évoque aussi pour moi, dans la mémoire endeuillée que je garde de mon amitié pour Jean Genet, une sorte de tragédie, le mal du contretemps, du retard, de l’anachronie, de la nostalgie. Le temps a passé, il a manqué, il aura été manqué. Si c’est une figure du mal (mais le mal, la malédiction est la bénédiction de Genet), tel manque doit être ressenti comme un manquement, il y va donc de la honte, de la honte déclarée, revendiquée, avouée. En tous les sens de ce mot, Genet regrette d’avoir manqué le bagne, et le bagne lui manque. Comme une gloire. Un sacre. On l’en a privé. Après que cette institution fut abolie, en juin 1938, par le président de la République, Genet se plaint, sur le ton de l’expatrié. Le bagne ne lui signifiait pas l’expatriation, comme chacun le croit, mais le rapatriement : « Un décret ne permet plus le départ pour Cayenne. Les relégués demeurent jusqu’à la fin de leurs jours dans les massives centrales. Aboli la chance, l’espoir de la belle. Ils mourront dans la nostalgie de cette patrie qui est leur vraie patrie, qu’ils n’ont jamais vue, et qu’on leur refuse. »
II y aura eu, oui, au futur antérieur, la Malédiction du bagne. Certes, ce titre prend acte d’une vérité, Genet n’achèvera jamais la pièce. Mais il évoque aussi pour moi, dans la mémoire endeuillée que je garde de mon amitié pour Jean Genet, une sorte de tragédie, le mal du contretemps, du retard, de l’anachronie, de la nostalgie. Le temps a passé, il a manqué, il aura été manqué. Si c’est une figure du mal (mais le mal, la malédiction est la bénédiction de Genet), tel manque doit être ressenti comme un manquement, il y va donc de la honte, de la honte déclarée, revendiquée, avouée. En tous les sens de ce mot, Genet regrette d’avoir manqué le bagne, et le bagne lui manque. Comme une gloire. Un sacre. On l’en a privé. Après que cette institution fut abolie, en juin 1938, par le président de la République, Genet se plaint, sur le ton de l’expatrié. Le bagne ne lui signifiait pas l’expatriation, comme chacun le croit, mais le rapatriement : « Un décret ne permet plus le départ pour Cayenne. Les relégués demeurent jusqu’à la fin de leurs jours dans les massives centrales. Aboli la chance, l’espoir de la belle. Ils mourront dans la nostalgie de cette patrie qui est leur vraie patrie, qu’ils n’ont jamais vue, et qu’on leur refuse. »
Le Journal du voleur s’emporte encore dans cette surenchère hyperbolique propre à Genet : le meilleur est le pire, le bienfait fait mal, le châtiment est châtié, châtré même par la loi qui en exempte. L’abolition du bagne signe le « châtiment du châtiment » : « Cependant que j’écris ce livre, les derniers forçats rentrent en France. Les journaux nous l’annoncent. L’héritier des rois éprouve un vide pareil si la République le prive du sacre… En moi-même, la destruction du bagne correspond à une sorte de châtiment du châtiment : on me châtre, on m’opère de l’infamie… en moi-même et pour moi seul, je recompose un bagne, plus méchant que celui de la Guyane. » Ce qui reste de la pièce l’atteste sans doute de façon éclatante.
Moi aussi, oserai-je l’avouer sans jouir d’une honte inavouable, j’aurai manqué, jusqu’à ce jour, le bagne de Genet. II m’aura manqué, je l’aurai manqué. Je n’aurais même rien su de ce manque si un beau jour mes amis Antoine Bourseiller, puis Albert Dichy ne m’avaient révélé la puissance spectrale, l’immense histoire cachée, le rôle central, obsédant, organisateur que le bagne, le Bagne, le bagne dans le bagne, joua dans la vie de Genet et dans ses projets d’écriture pour le théâtre et le cinéma. Ma honte devra désormais hanter tous les souvenirs que je garde de ce que j’ai eu la chance de partager dans l’amitié qui me lia à Genet continûment jusqu’à sa mort, depuis 1965 ou 1966.
Ces dates ne sont pas insignifiantes. Je savais alors les ravages qui avaient suivi le suicide d’Abdallah, son ami depuis sept ans, en 1964. Je savais aussi que, deux ans avant sa propre tentative de suicide, Genet, lorsque je le rencontrai pour la première fois, disait avoir renoncé à écrire et brûlé des manuscrits. Mais ce que j’ignorais alors, c’est que parmi les textes incinérés se trouvaient – une valise entière – les dernières versions du Bagne. D’elles, on ne saura jamais rien. Or voici la dernière chance du Bagne, la bénédiction dans la malédiction, cette oeuvre en pièces : à partir de différents fragments de versions antérieures, publiées ou communiquées ici ou là (Corvin et Dichy en retracent remarquablement l’histoire), Antoine Bourseiller aura pris, de la façon la mieux calculée, les risques à la fois archéologique et théâtral de rendre un corps, de reconstituer un « corpus » et de remettre en place l’oeuvre. Debout, monumentale. Écrite et théâtrale. Autre calcul du risque : quand, à l’occasion de cette création mondiale au Théâtre national de Nice, il m’a généreusement proposé d’écrire sur Genet une ou deux pages de « rêverie » (ce fut son mot, à la lettre, dans une lettre), je ne sais pas si Bourseiller faisait, à dessein ou non, allusion à telle phrase que je découvre aujourd’hui. Des personnages de la pièce, Genet écrivit un jour, en effet, qu’ils sont « prisonniers de cet univers clos : ma rêverie et ce bagne ».
La Mort, les Mères. Si j’avoue ma honte, c’est surtout pour avoir ignoré l’existence du Bagne quand, à travers toute l’œuvre de Genet, j’écrivis Glas, en 1973-1974. Les mères, la mort, fils continus et entrelacés de ce livre, auraient dû en devenir le sous-titre. Or, j’apprends deux choses aujourd’hui même. Le grand oeuvre – dont rêvait Genet qui en esquissa la structure – aurait eu pour titre la Mort. Il aurait dû inclure, entre autres pièces, le Bagne, second volet : après les Paravents et avant les Fous (pièce ébauchée en 1958). D’autre part, Genet voulait inscrire les Paravents et le Bagne dans un cycle des Mères. La mort, ici, ce n’est pas seulement la mort, la mort sans phrase. Ce nom désigne aussi une poétique ou une esthétique du théâtre. Genet s’en est souvent expliqué. II n’a pas seulement dit, de façon générale, que ses pièces étaient destinées aux morts (je crois que c’était au moment des Paravents). Il précise que si le Bagne correspondait à son « désir secret de le vivre », il figurait aussi le paradigme de l’oeuvre d’art. Il la voulait « close, monolithique, sans prolongement dans l’univers social, morte enfin ». Ce qui, sans doute, on le vérifiera, semble exclure tout « réalisme » au sens courant, mais l’arbitraire du « poème » nommé le Bagne vérifie aussi, dans ce que Genet appelle la cohérence, une réalité plus réelle que la réalité, une vérité essentielle ou plutôt une nécessité inflexible.
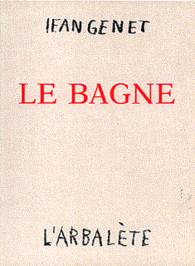
Les mères, ici, dans le Bagne, ce ne sont pas seulement les mères. Pour être bref et économe, je propose au spectateur de suivre à la trace au moins deux pistes colorées. De rouge et de rose. Le sang rouge de la Veuve, la guillotine (il inonde toute la pièce), et le sang rouge de la menstruation, donc de la fécondité, qui fait de la femme une mère. Là même où, Genet le dit, « les Nègres sont la Femme absente de ce bagne ». Un seul exemple, écoutez Ferrand : « Je l’ai voulue rouge (la guillotine), et c’est moi qui l’ai barbouillée pour qu’elle ait même dans la nuit sa ration de sang. Sur le sang, je pourrais vous parler longtemps. Le sang (…). Comme une femme, une fois par mois, je lâche les écluses : le sang inonde des linges. Une fois par mois je suis intouchable. Je dispose de la mort. Et c’est par là que je suis femelle. Rosiers ! »
Le vocable Rose ou rose (nom commun, nom propre, adjectif) assiège, tout au long de son oeuvre, le lexique de Genet. Bien au-delà du Miracle de la rose. « Warda » en arabe veut dire « rose ». Or, comme son nom propre, nom commun et adjectif, indécidablement, « Rose », au lever de rideau comme au lever de soleil, c’est le premier mot des Paravents – dont la mère est un des principaux personnages et Warda une putain. Saïd : « Rose ! (un temps). Je vous dis rose ! Le ciel est déjà rose. Dans une demi-heure le soleil sera levé… » Puis si vous entrez dans le Bagne, bien avant ce dialogue inouï entre la Lune et le Soleil, vous entendrez tout à l’heure Komac, « surveillant le désert » au lever du soleil, s’exclamer « d’une voix sourde » : « Mes camarades, le rose vient d’éclater ! »… Le Soleil dira plus tard du jour qu’il est « un mâle tout entier dans sa solitaire et stérile érection ». Et la Lune : « Je suis toute la féminité absente, laissée sur les anciens rivages, dit la nuit. »
Jacques Derrida
Jean Genet, Le Bagne. Mis en scène par Antoine Bourseiller Théâtre national de Nice. Du 5 au 15 mai 2004.
