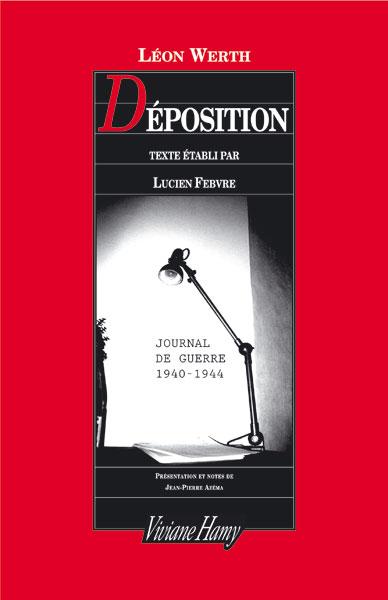 Céline : « Amplificateur éructant. En proie aux mots. Bagout de camelot littéraire, qui semble aux petits-bourgeois puissant et pathétique. » Maurras : « L’indigence mentale de Maurras fut toujours évidente, sauf pour quelques cuistres frottés de bachot. On peut même reconnaître un imbécile à ce qu’il ne sait pas que Maurras est un imbécile. » Henry de Montherlant : « On ne saisit Montherlant que si on se souvient que, dans les petits cirques, le même artiste est à la fois acrobate et paillasse. Paul Morand : « cette scorie d’après la guerre de 1914, ce faux-semblant à facettes, ce néant pailleté. » Drieu La Rochelle : « puceau exhibitionniste », « ‘Sciences Po’ jouant à l’affranchi. » Ramon Fernandez : « Les idées, toutes idées passent sur lui, comme des semelles sur un paillasson. »
Céline : « Amplificateur éructant. En proie aux mots. Bagout de camelot littéraire, qui semble aux petits-bourgeois puissant et pathétique. » Maurras : « L’indigence mentale de Maurras fut toujours évidente, sauf pour quelques cuistres frottés de bachot. On peut même reconnaître un imbécile à ce qu’il ne sait pas que Maurras est un imbécile. » Henry de Montherlant : « On ne saisit Montherlant que si on se souvient que, dans les petits cirques, le même artiste est à la fois acrobate et paillasse. Paul Morand : « cette scorie d’après la guerre de 1914, ce faux-semblant à facettes, ce néant pailleté. » Drieu La Rochelle : « puceau exhibitionniste », « ‘Sciences Po’ jouant à l’affranchi. » Ramon Fernandez : « Les idées, toutes idées passent sur lui, comme des semelles sur un paillasson. »
Le journal de guerre de Léon Werth, que l’écrivain publia en 1948 sous le titre Déposition, est riche d’appréciations plaisantes sur les intellectuels collaborationnistes… Toutefois, ce ne serait pas lui faire justice que de le réduire à un pourvoyeur d’invectives bien lancées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Werth, à cause d’une lointaine ascendance juive et de solides idées de gauche, avait été obligé de se retirer dans le Jura, à Saint-Amour. Son témoignage remarquablement lucide sur les années 1940-44 montre qu’il était possible de se faire une idée claire des événements de cette période en dépit d’un certain isolement et des mensonges de la propagande. Dans ces pages, Werth, qui avait aussi été journaliste, est particulièrement révolté par la compromission d’un grand nombre d’intellectuels français de l’époque (dont certains jouissent encore aujourd’hui de quelque prestige).
Ce qui le scandalise par dessus tout chez ces écrivains, c’est leur rapport aux mots. Par exemple, sans même évoquer les répugnantes pages des Pleins Pouvoirs de Giraudoux, il lui reproche de n’avoir « jamais eu l’idée que les mots eussent la moindre signification » : « Ces perpétuels décalages, ces mots qui ne sont jamais le mot juste, donnent au lecteur faible l’illusion de ce que le journaliste appelle une scintillation. En réalité, il trébuche à chaque pas sur le sens des mots et il se fait une élégance de l’à-peu-près. » Inversement, il ne fait pas allusion à l’engagement de François Mauriac dans la Résistance, c’est en lisant Souffrances et bonheur du chrétien qu’il note : « Le style est parfait. Le mot juste est toujours cherché et toujours trouvé. Cela est honnête, cela donne prise à l’objection. »
Le « mot juste », voici la préoccupation de Werth. Ce n’est pas la préoccupation d’un esthète détaché des événements. Au contraire : Werth déplore dans un essai de Paul Valéry que « la peur du trivial et l’amour du pur cristal conduisent à d’étranges aberrations et condamnent au plus vague formalisme un esprit qui ne cherche que finesse et précision. »
Werth considère les mots comme des outils pour saisir et exprimer la réalité. Afin de former « les idées de propagande, les idées de dictateurs plébéiens et des maréchaux gâteux », qui ne sont que distorsion de la réalité et de la vérité, il faut préalablement briser les outils. En entendant à la radio de Vichy une diatribe du journaliste pro-allemand Hérold-Paquis, Werth note : « On dirait l’agitation d’un singe, d’un singe qui casse des mots. »
A force de priver les mots de leur poids, de leur substance, il est possible de gloser dans un détachement parfait : « Il n’imagine pas qu’il puisse exister des rapports entre les mots et les choses », dit Werth de Fernandez, « mais il sait qu’il y a des rapports entre les mots et qu’à condition de les alléger de leur sens (comme on jette du lest) il est bien peu de mots qui ne puissent glisser le long d’autres mots. »
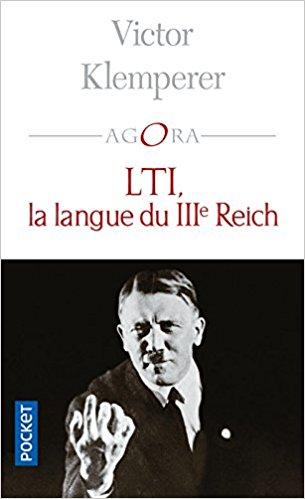
La destruction de la logique découle de ce dévoiement du langage : « Les mots n’ont pas pour [Jacques Chevalier] plus de sens qu’ils n’en ont pour un dément. Ils se coagulent par les bords gluants de leurs arêtes. Ils prennent leur place dans la phrase, comme des voyageurs prennent leur place dans un wagon. »
Werth montre également que l’éducation, la culture, l’érudition ne sont pas des remparts sûrs contre ce phénomène ; que les professionnels du langage peuvent se retrancher derrière leur « métier », leur savoir-faire, leur technique, et produire n’importe quel discours selon les exigences du moment et du commanditaire, à la manière du bon élève capable de disserter pour ou contre l’argument, de l’avocat capable de prononcer tour à tour le plaidoyer et le réquisitoire.
Werth va plus loin encore et décèle une manière inédite de mentir : « Naguère, les politiciens transposaient sur un plan logique leurs fluctuations, les centraient sur un scénario aux clartés d’anecdotes, les classaient dans la catégorie du pour et du contre, utilisaient, selon l’heure, le pour et le contre, l’affirmation et la négation. Aujourd’hui, l’affirmation et la négation, le pour et le contre, ils les utilisent, les contractent et les unifient dans le même instant. »
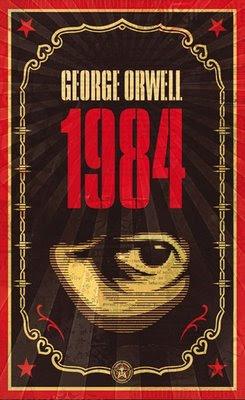
D’abord, ce langage « sans cœur », sans « tripes », permet « d’éviter les chocs du réel » par un « état de somnambulisme » susceptible de « conduire aux thèses les plus absurdes et à la trahison même. » Cette déconnexion totale entre les idées et la réalité ouvre la porte à la vénalité. Les idées sont monnayables et, dans ce commerce, Vichy ou Hitler sont des clients comme les autres : « Pour le polémiste, les idées sont marchandise. Il les évalue selon la clientèle qu’elles peuvent attirer, selon le prix qu’il peut en demander. Il n’y voit point de mal. Il est innocent. »
Poussant son raisonnement jusqu’au bout, Werth, dans une page admirable, avance une hypothèse psychologique glaçante : il existerait des esprits « atteints d’une sorte de frigidité devant toute idée ou passion qui dépasse leur peau, leur corps ou leur argent, l’argent étant la seule abstraction à laquelle ils se haussent. D’autres sont ainsi devant les femmes. Ils font, par imitation, les gestes de l’amour, ils imitent admirablement la passion mais ne l’éprouvent pas. Leur frigidité intérieure les pousse de femme en femme. Ils n’en préfèrent aucune. Il arrive qu’ils en souffrent. A proprement parler, ils ne sont pas plus infidèles aux femmes que les premiers aux idées. Ils ne se détachent pas, ne pouvant s’attacher. Il y a les robots de l’idée, comme il y a les robots de l’amour. »
Reste la question des châtiments. Werth se la pose souvent au cours de son journal. « Quel sera le sort de ces peintres, sculpteurs et musiciens qui banquetaient en Allemagne, dans le même temps que les Allemands fusillaient un Jacques Decour ? » Jugeant en son âme et conscience que les collaborateurs ont agi « par préméditation », Werth estime que leur peine ne doit pas être « inférieure à celle dont on punit les déserteurs. »
A la fin de la guerre, Hérold-Paquis, Brasillach, Luchaire, et de Brinon sont passés par les armes. Drieu devance la sentence en se tirant un coup de revolver. Fernandez a la bonne idée de mourir quelques jours avant la Libération. Rebatet, Béraud, Bonnard, Pierre-Antoine Cousteau, Alphonse de Chateaubriant sont condamnés à mort, puis graciés. Maurras, Chardonne, Abel Hermant et Céline font un peu de prison. Morand s’exile courageusement, le temps de se faire oublier. Le reste endure gravement l’indignité nationale.
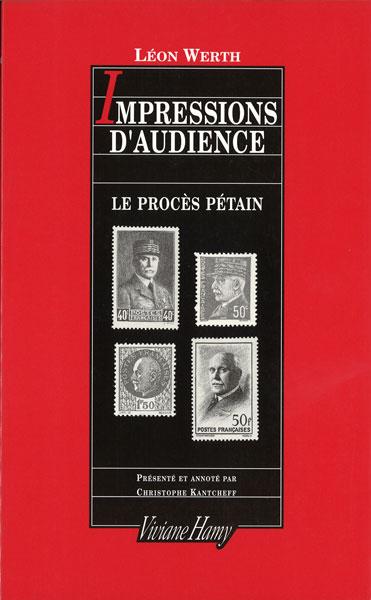
Werth avait personnellement une conception bien différente des idées, qu’il avait exprimée dans son journal en juillet 1944. Un an plus tard, contrairement à Laval, il n’en avait pas changé : « Il y a des instants où nulle idée n’est inoffensive, où la plus pauvre entraîne avec elle des lambeaux de réalité et de chair, des lambeaux d’homme. On croyait avoir joué avec des jetons. C’est soi-même, c’est son âme qu’on jouait. »
Le livre de Werth appartient évidemment à une autre période ; mais les fleuves de l’histoire remontent vite à leur source… Aujourd’hui que les ignominies pseudo-littéraires de Céline ou Maurras trouvent regain d’intérêt, il ne nous a pas semblé vain de rappeler cela.
Sébastien Banse
Léon Werth, Déposition. Journal 1940-44 Editions Viviane Hamy, 2000, 736 pages, 24,5 €
Share this...

