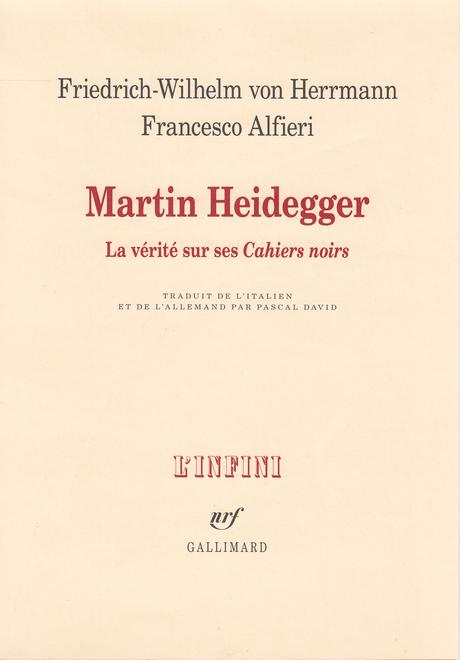 Dans une lettre à Elisabeth Blochmann, en décembre 1932, Martin Heidegger écrivait que plus il s’absorbait dans son travail, plus il était chaque fois ramené de gré ou de force « au grandiose commencement qui eut lieu chez les Grecs ». Il confiait même à sa correspondante qu’il en venait souvent à se demander si le plus essentiel ne serait pas de se consacrer exclusivement « à œuvrer en sorte que ce monde se dresse à nouveau sous nos yeux non comme l’héritage à paresseusement recevoir, mais comme grandeur commotionnante à prendre en exemple ». C’est en somme ce qu’il appelait « le commencement de la philosophie occidentale », chez Anaximandre et Parménide, dont il avait fait l’objet de son cours de l’année 1932, à la veille de tous les dangers, de toutes les catastrophes, à la veille d’un autre commencement dans lequel il allait se fourvoyer lamentablement… Une autre de ses correspondantes, qui avait même été son amoureuse, finirait par l’appeler « Heidegger le renard », un renard si dépourvu de ruse que non seulement il ne cessait de se faire prendre au piège « mais qu’il ne savait même plus faire la différence entre ce qui était un piège et ce qui ne l’était pas », disait Hannah Arendt en 1953. Mais est-ce à dire que Martin Heidegger n’était pas intelligent ? et que celui qu’on dit être le plus grand philosophe du XXe siècle n’a vraiment pas brillé par son intelligence ?
Dans une lettre à Elisabeth Blochmann, en décembre 1932, Martin Heidegger écrivait que plus il s’absorbait dans son travail, plus il était chaque fois ramené de gré ou de force « au grandiose commencement qui eut lieu chez les Grecs ». Il confiait même à sa correspondante qu’il en venait souvent à se demander si le plus essentiel ne serait pas de se consacrer exclusivement « à œuvrer en sorte que ce monde se dresse à nouveau sous nos yeux non comme l’héritage à paresseusement recevoir, mais comme grandeur commotionnante à prendre en exemple ». C’est en somme ce qu’il appelait « le commencement de la philosophie occidentale », chez Anaximandre et Parménide, dont il avait fait l’objet de son cours de l’année 1932, à la veille de tous les dangers, de toutes les catastrophes, à la veille d’un autre commencement dans lequel il allait se fourvoyer lamentablement… Une autre de ses correspondantes, qui avait même été son amoureuse, finirait par l’appeler « Heidegger le renard », un renard si dépourvu de ruse que non seulement il ne cessait de se faire prendre au piège « mais qu’il ne savait même plus faire la différence entre ce qui était un piège et ce qui ne l’était pas », disait Hannah Arendt en 1953. Mais est-ce à dire que Martin Heidegger n’était pas intelligent ? et que celui qu’on dit être le plus grand philosophe du XXe siècle n’a vraiment pas brillé par son intelligence ?
Il faut dire que c’est un mot – « intelligence », « intelligere » – qui parle plutôt latin, comme le rappelait François Fédier dans un hommage au grand heideggérien Jean Beaufret, qu’il avait publié à l’été 2005 dans le numéro 91 de la revue L’Infini. En effet, le mot parle latin et dit (selon Fédier) « la très précieuse et rare capacité de savoir, entre les multiples options qui s’offrent, se décider pour celle (…) qui va vous mettre face à ce qui est ». C’est pourtant bien ce que Martin Heidegger aura voulu : porter le regard au cœur de « ce qui est », « soutenir la vue de ce qui est », mais en pensant que ça n’était possible qu’en insistant sur l’origine, c’est-à-dire en faisant retour aux Grecs, aux présocratiques, au Poème de Parménide, à la plus ancienne parole de la pensée occidentale du dénommé Anaximandre, qui aurait vécu entre la fin du VIIe et le milieu du VIe siècle, dans l’île de Samos – qui dit : « D’où les choses ont leur naissance, vers là aussi elles doivent sombrer en perdition, selon la nécessité ; car elles doivent expier et être jugées pour leur injustice, selon l’ordre du temps. »
C’est ainsi que l’avait traduite le jeune Nietzsche, en 1873, dans son ouvrage La Philosophie à l’époque tragique des Grecs, livre qui ne fut publié que trente ans plus tard, en 1903, après la mort de Nietzsche… Avec la philosophie grecque, il s’agira pour Heidegger d’entrer dans la dimension de la présence-absence, celle où nous sommes vraiment en face de quelque chose, disait-il ; et avec la pensée de Nietzsche lui-même, dont il s’occupera ensuite (notamment avant et pendant la Seconde Guerre mondiale), Heidegger essaiera de penser le nihilisme qui ne l’épargnera pas lui-même, d’autant que philosophie et vérité ont partie liée. Mais plus encore que la philosophie, plus encore que la vérité elle-même, Heidegger a voulu penser la question de l’être, qui est pour lui la question essentielle, bien plus encore que l’existence qui n’est elle-même qu’un mode de l’être… Mais qu’est-ce que l’être ? Qu’est-ce qu’il en est de l’être dont il dit ici, dans Le commencement de la philosophie occidentale, qu’il faut un élan original pour le trouver ? Il dit même qu’il y faut « cet élan original qui le recherche entièrement pour lui-même »…
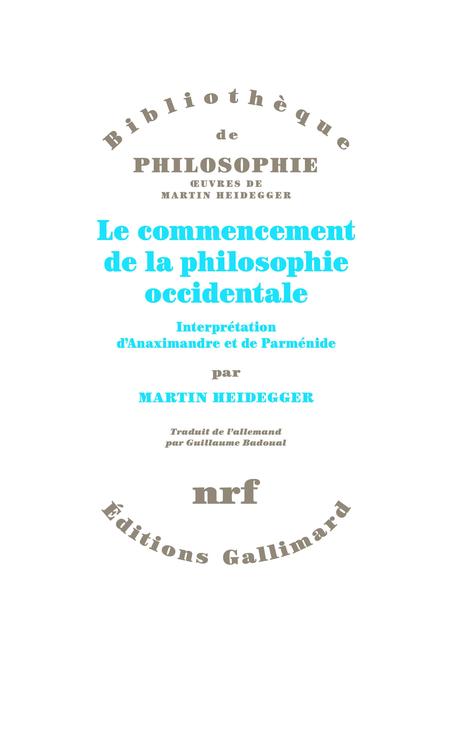
« Comment faire l’expérience de la dignité ? » dit Heidegger lui-même dans ce cours de 1932 ; et là est sans aucun doute toute la question (le concernant). Heidegger soutient que la « dignité » existe, qu’elle peut se voir à même quelque chose, à même quelqu’un, au contact de n’importe quel « être » que ce soit… Mais qui est Heidegger ? Est-il celui qui s’oublie dans son propre questionnement, et qui se prend en effet à son propre piège – est-il bien Heidegger le renard ? En septembre 1969, lors du dernier séminaire du Thor, chez René Char, dans la belle Provence de Paul Cézanne, le philosophe allemand expliqua à son assemblée que les Grecs sont l’humanité qui vécut immédiatement dans l’ouverture des phénomènes – par l’expresse capacité ek-statique de se laisser adresser la parole par les phénomènes… En revanche, l’homme moderne, l’homme cartésien – qui veut se rendre maître et possesseur de la Nature – ne s’adresse la parole qu’à lui-même… Telle est la grande question posée par Heidegger : la question de l’homme moderne, précisément, et la critique qu’il en fait, au risque d’être totalement incompris…
C’est ce que nous disent aujourd’hui Friedrich-Wilhelm von Herrmann et Francesco Alfieri dans un livre intitulé « Martin Heidegger. La vérité sur ses Cahiers noirs », qui paraît dans la collection L’Infini de Philippe Sollers, aux éditions Gallimard, un ouvrage qui entend amener son lecteur à faire une lecture sérieuse et rigoureuse des « carnets » de Heidegger. Car il faut sortir de la lecture instrumentale qui a été faite de ces Cahiers noirs, disent les deux auteurs – dont l’un, Friedrich-Wilhem von Herrmann fut le dernier assistant personnel de Heidegger et le principal collaborateur de l’Edition intégrale de l’œuvre du philosophe… Martin Heidegger fut et restera un grand penseur auquel on ne peut se confronter que philosophiquement et non en termes politiques et idéologiques (disent-ils). Il faut donc en revenir à Heidegger de manière responsable et sans faire prévaloir les interprétations faciles, dont celle de l’ « antisémitisme inscrit dans l’histoire de l’être » et a fortiori « métaphysique » développée notamment en Italie (ce qui ne doit pas nous dissuader de lire le livre de Donatella Di Cesare).
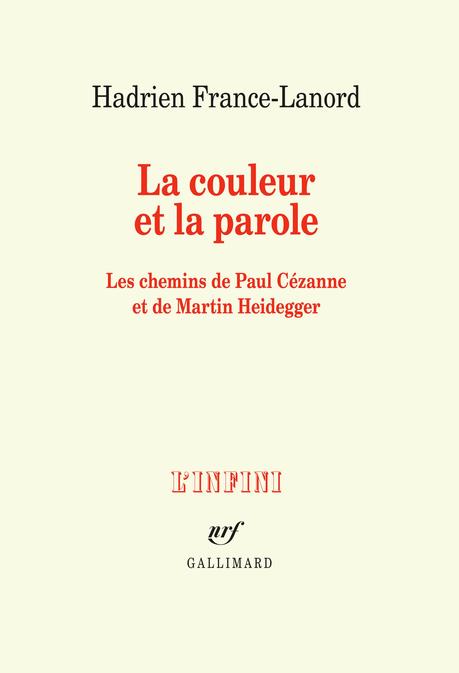
Ce que voudrait le philosophe de la Forêt Noire, c’est qu’on en revienne à un questionnement essentiel au sein d’une « solitude » inhérente à la « nécessité de l’être ». C’est pour lui quelque chose de parfaitement évident. C’est même quelque chose de très simple : les dieux, les hommes, la terre et le ciel, c’est tout ce qu’il nous faut savoir. Dès lors, un nouveau « commencement » serait possible. Commencer, c’est se découvrir ; et la découverte est l’alétheia, la vérité qui s’institue d’un coup, « d’un éclair », dans la présence. Il n’y a pas d’autre point de départ, dit Heidegger. C’est ce qu’il appelle « l’homme tourné vers l’avenir » qui se tient dans la vérité de l’être. C’est un processus d’une vaste ampleur au regard duquel toute « histoire mondiale », selon l’histoire contemporaine, reste un jeu d’enfant (dit-il).
Heidegger n’a sans doute jamais pensé qu’on pourrait l’accuser un jour d’antisémitisme, car son propos est en effet ailleurs ; et on le voit bien encore aujourd’hui dans un livre qui vient tout juste de sortir en librairie, « La couleur et la parole. Les chemins de Paul Cézanne et de Martin Heidegger », du professeur Hadrien France-Lanord, l’essai d’une sorte de glissement géologique de la Forêt Noire à la Provence, au pays de René Char, à la lisière des lavandes. Avant même les « Séminaires du Thor », qui se tenaient le matin dans ce beau village à l’hôtel des Chasselas, à la fin des années 1960, en présence de René Char, Jean Beaufret, Frédéric de Towarnicki, et de quelques autres (dont Roger Laporte et le jeune Giorgio Agamben), Heidegger s’était rendu plusieurs fois à Aix, dès 1952, pour faire des conférences et pour y voir la montagne Sainte-Victoire. A son retour, il aurait déclaré : « Ces journées passées dans le pays de Cézanne valent autant qu’une bibliothèque entière de philosophie»… Plus tard, dans les années 1970, peu avant sa mort, il écrira plusieurs versions d’un poème intitulé « Cézanne ». Heidegger a fini par se voir en jardinier Vallier, en Homme assis, en Grand Baigneur, en tout cas dans la couleur et son pur laissez-être. C’est peut-être, finalement, ce qui le rend impardonnable.
Didier Pinaud
Martin Heidegger, Le commencement de la philosophie occidentale. Interprétation d’Anaximandre et de Parménide Gallimard, 352 pages, 32 € Friedrich-Wilhelm von Herrmann et Francesco Alfieri, Martin Heidegger. La vérité sur ses Cahiers noirs L’infini / Gallimard, 496 pages, 36,50 € Hadrien France-Lanord, La couleur et la parole. Les chemins de Cézanne et de Martin Heidegger L’Infini/Gallimard, 288 pages, 23,50 €
Share this...

