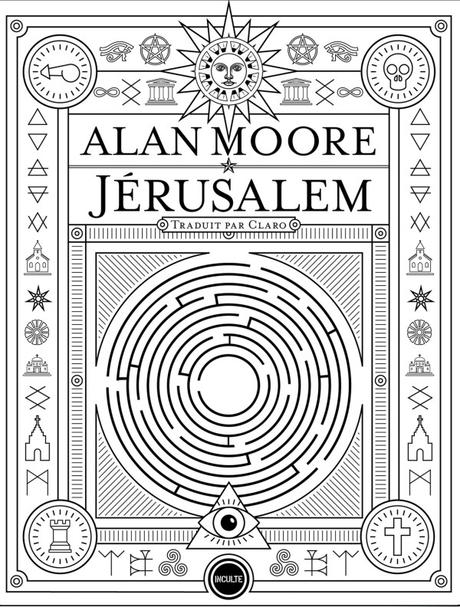 Qu’attend-on d’une œuvre littéraire ? La réponse à cette question pourrait à elle seule balayer plus de la moitié de la production éditoriale française. Nettoyage de printemps, critérium de diamant, plus tranchant que le rasoir d’Ockham, dont Jérusalem d’Alan Moore, paru il y a quelques temps déjà aux éditions Inculte, nous donne quelque idée. Une grande œuvre doit résister, en même temps qu’elle doit plaire. Elle doit séduire quand on l’effleure et donner la migraine au dissécateur. Une seule lecture ne peut pas l’épuiser. Et lorsqu’il s’agit d’un ouvrage de 1300 pages comme celui-là, aussi dense, aussi fou, il faut que le plaisir du lecteur soit égal au courage qu’il aura de le relire. Ce n’est pas une mince affaire ! Pari gagné.
Qu’attend-on d’une œuvre littéraire ? La réponse à cette question pourrait à elle seule balayer plus de la moitié de la production éditoriale française. Nettoyage de printemps, critérium de diamant, plus tranchant que le rasoir d’Ockham, dont Jérusalem d’Alan Moore, paru il y a quelques temps déjà aux éditions Inculte, nous donne quelque idée. Une grande œuvre doit résister, en même temps qu’elle doit plaire. Elle doit séduire quand on l’effleure et donner la migraine au dissécateur. Une seule lecture ne peut pas l’épuiser. Et lorsqu’il s’agit d’un ouvrage de 1300 pages comme celui-là, aussi dense, aussi fou, il faut que le plaisir du lecteur soit égal au courage qu’il aura de le relire. Ce n’est pas une mince affaire ! Pari gagné.
Jérusalem est donc le deuxième roman d’Alan Moore, que l’on connaît surtout pour ses comics et les adaptations cinématographiques de certains d’entre eux – notamment From Hell, La Ligue des gentlemen extraordinaires et V pour Vendetta. Le volume est traduit de l’anglais par l’écrivain Claro, dont il faut saluer le travail titanesque tant l’ampleur, l’érudition et la complexité de l’œuvre sont grandes. Il fallait à tout le moins déployer une théorie de la traduction en acte pour s’atteler à un tel ouvrage. Je recommande à qui voudrait se familiariser avec la méthode de Claro de consulter son « blog du traducteur ».
Comment résumer Jérusalem ? Par où aborder cette gigantesque fresque épique, lyrique, romanesque, fantastique, métaphysique, populaire, savante, politique, géographique, poétique… ? Les adjectifs ne manquent pas. Disons d’abord que Jérusalem est l’histoire d’une ville : Northampton, située à une centaine de kilomètres au Nord de Londres, et de ses habitants, petits ou grands. Moore y naquit. Il fait de cette ville de cœur le véritable centre de l’Angleterre. Et il n’a peut-être pas tort. Au IXe siècle, un moine anglais reçut de Dieu le commandement de ramener une sainte croix de Palestine et de la ficher au centre de son pays ; c’est à Northampton, alors Hamtun, qu’il s’arrêta. Le livre d’Alan Moore fait roman de tous les personnages historiques qui, par un étrange hasard objectif, ont côtoyé Northampton ou ses alentours. Dans le désordre : le théologien Philip Doddridge, le psalmiste John Newton, Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, le prédicateur John Bunyan, Cromwell, les poètes William Blake et John Clare, Charlie Chaplin, James Joyce et sa fille Lucia, Samuel Beckett et tant d’autres. Moore n’en parle pas, mais est-ce encore un hasard si, alors que Jérusalem multiplie les allusions à cette grande œuvre de la pop culture qu’est la série Doctor Who, on s’aperçoit après quelques recherches que Matt Smith, l’interprète du 11e Docteur, est né à Northampton ? On voit donc de quelle longue et riche tradition Moore est porteur. Chacun de ses personnages fait partie de l’histoire de Jérusalem. Je ne dis pas cela en l’air : on assistera au fil de la lecture au commerce charnel que noueront Lucia Joyce et John Clare, au coucher de Cromwell, la veille d’une bataille décisive, à une saynète rassemblant Clare, Becket et Beckett…
Pour Moore, une ville est la somme de tous ses habitants qu’elle connut, de leurs rêves, de leurs désirs, du passé, du présent comme de l’avenir. Ces rencontres temporelles carnavalesques et improbables, timey wimey comme dirait le Docteur, sont rendues possible par la conception du temps que Moore met en œuvre dans Jérusalem. Extrapolant des théories scientifiques qui, je l’avoue, me dépasse en même temps qu’elles me fascinent, Moore considère le temps comme une dimension physique à part entière, visible, presque gélatineuse, qui se manifeste à l’homme en lui donnant l’illusion de la durée. Dans cet univers, c’est la mort qui permet à l’homme d’échapper au piège optique de la 3 Dimensions, piège dans lequel ne tombent pas les pigeons par exemple, ou épisodiquement certains marginaux, drogués, alcooliques, déjà « hors du temps ». Une fois « morts », leur esprit peut vagabonder dans cette nouvelle dimension en creusant dans le temps, en retournant les angles. Un angle étant un point dans lequel les différentes dimensions se rejoignent. « C’est la direction qu’ici en haut on appelle la durance ou la quandeur de quelque chose, et qui n’a pas de fin. Bon, si le chemin qu’on prend là c’est toutes les pièces différentes de ta parcelle d’Andrew’s Road, alors ça veut dire que dans ce sens, dans la tardance, c’est tous les moments différents de cette pièce », comme l’explique Phyllis Painter au petit Mick Warren, provisoirement décédé. Vues de loin, les choses apparaissent alors comme étirées, déformées, plus ou moins transparentes selon l’empreinte plus ou moins durable qu’elles ont laissée dans cette dimension temporelle. Par exemple, une réalité aussi éthérée que les nuages, vue par Michael : « Ce n’était pas des nuages, bien qu’ils fussent de tailles tout aussi variées et tout aussi gracieux et lents dans leurs mouvements. Ils ressemblaient davantage, pensa-t-il, au dessin industriel qu’aurait fait quelqu’un de nuages. » Cette théorie a un corollaire, qui soulève de nombreuses questions : si le temps est une dimension dans laquelle on peut marcher aussi bien que la longueur, la largeur ou la profondeur, tout est-il déjà « arrivé » ? Le temps est un bloc constitué, immuable. Constitué par ses angles.
Les angles. Moore joue sur l’homophonie angel / angle, ce qui place d’emblée l’enjeu de Jérusalem dans le langage. Dans le roman, les angles sont personnifiés par les anges de Mansoul qui jouent au billard avec les destinées, bâtissant peu à peu une Jérusalem à la fois céleste et temporelle au-dessus de Northampton, et particulièrement du quartier réprouvé des Borough. Ces anges, que certaines religions prennent pour des êtres d’origine divine, veillent à chaque instant que soit accompli le temps, pour son intégrité-même, dans une vision téléologique qu’on sent incertaine, angoissée, chez Alan Moore. Man-soul, l’âme de l’homme, bien sûr, mais aussi une référence à l’allégorie religieuse de Bunyan développée dans The Holly War (1682). « Bien sûr nous marchons parmi vous, enfoncés jusqu’à la taille dans votre politique et votre mythologie. Nous pataugeons dans les pétales rose nougat de votre Commonwealth en pleine désintégration. Nous marchons telle une marée noire sur Washington. Nous jonglons avec les satellites et Francis Bacon. Nous sommes les bâtisseurs. Nous construisons Allen Ginsberg et la cathédrale de Niemeyer à Brasilia. Nous élevons le mur de Berlin. Des nuages passent devant le soleil. Nous sommes avec vous maintenant. » Cette guerre sainte est menée pour émanciper l’âme humaine au travers du temps, quoi que l’issue de cette guerre soit incertaine, nous le verrons. Elle se mène en tout cas par les angles, les coins, les marges. C’est autour de ces marges que va s’enraciner l’intrigue du roman.
Parmi tous les marginaux dont nous suivons les tribulations, clochards, poètes, drogués, prostituées, anciens esclaves, activistes, fous, on s’attache en particulier au destin de la famille Vernall-Warren. La famille Vernall compte beaucoup de détraqués en tout genre et n’a pas bonne réputation dans le quartier déjà malfamé des Borough. C’est qu’en réalité, depuis des siècles, la tâche leur est dévolue dans les plans des Bâtisseurs de s’occuper des coins, d’entretenir les marges, qui sont toujours des points de passage, on le répète, entre une dimension à une autre, un événement à un autre. Elle est enveloppée d’un mystère, même dans « l’au-delà ». May Warren revêt l’antique tunique des matrones qui présidaient aux naissances et aux décès selon les anciennes coutumes ; Snowy Vernall, lui, se balade sur les toits, d’où il entrevoit l’avenir… Et il y a Alma, double agaçant de l’auteur, artiste chichonnée qui jouera un rôle capital dans cette « guerre sainte » en portant témoignage, par l’intermédiaire de son exposition, de l’extraordinaire richesse fantasmatique des Borough.
La première partie du livre, « Les Borough », plantent le décor de Northampton et alternent, chapitre par chapitre, les narrateurs pour nous rendre familiers les personnages, petits ou grands, de cette histoire. On devine petit à petit que quelque chose cloche dans la chronologie et qu’ils n’ont probablement pas tous vécu à la même époque. La seconde partie, « Mansoul », raconte l’arrivée dans la quatrième dimension du petit Michael Warren, suspendu entre la vie et la mort après s’être étouffé avec une pastille. Guidé par ses amis du « Gang des Enfantômes », il va comprendre au fur et à mesure de ses aventures racontées façon Club des 5 ou Peter Pan, qu’il est capital qu’il se souvienne de sa virée à travers Mansoul pour qu’il puisse plus tard la rapporter à sa sœur, Alma. Alma, inspirée par l’histoire de son frère, sera ainsi à même d’immortaliser les Borough lors d’une exposition, dans la troisième partie, « L’Enquête Vernall ». Cette troisième partie, imitant l’ingéniosité artistique d’Alma, met en œuvre une prodigieuse variété de formes littéraires : théâtre, poésie, stream of consciousness, prose non ponctuée, écriture phonétique, points de vue alternés, anticipation… Sommet littéraire de Jérusalem, « L’Enquête Vernall » est aussi la partie la plus complexe et la plus riche en questionnements. La marche de Snowy Vernall et de la petite May Warren vers la fin des temps est sans doute l’un des plus beaux morceaux de bravoure qu’il m’ait été donné de lire. L’un des plus vertigineux, en tout cas, comme la sensation de regarder un film de sciences fictions en accéléré.
On écrira longtemps sur ce livre et dans tous les sens, des thèses croulantes ou des essais pointus. Ce n’est ni mon rôle, ni mon ambition ici. Il y a toutefois deux aspects du livre sur lesquels je voudrais attirer l’attention du lecteur. Je veux d’abord parler du langage d’Alan Moore et de la qualité de la traduction de Claro. Ce langage est à l’image du monde qu’il décrit : il possède plusieurs dimensions, réfractions et facettes. C’est évidemment dans le chapitre « Battre la campagne » (3e partie) que l’art du poète est le plus saillant. Nous sommes dans la tête de Lucia Joyce, la fille de James, internée à l’asile psychiatrique de Northampton. Alan Moore rend hommage à cette figure de femme, malade certes, mais victime, peut-être, d’un frère incestueux, d’un père marmoréen.
La langue de Lucia nous est retranscrit phonétiquement, ce qui rend la lecture difficile mais ô combien plus riche. Ses mots sont des mots en liberté, à qui sont rendues toutes leurs possibilités sonores. « Âprès un lang et sinoueux pèriple, el arrêve deviant une clouture derrhier lac aile sextant une florêt darbes. » Petit florilège pour donner un aperçu d’une ébouriffante création linguistique : « revicœurant », « nymfauvemane », « el desdichida », « patermonster », « immobnubile », « staccadé », « ulysserre »… Certains y verront un état régressif du langage. J’y vois plutôt une fontaine de jouvence qui restitue aux mots leur ambiguïté native. Claro parle de « nomad’s langue », concept qui explique aussi bien qu’il illustre la langue d’Alan Moore : on peut y lire aussi bien « nomade », que « no-man », « no mad », « noumène », « langue », « land », etc. Le scintillement du mot laisse entrevoir une multiplication des autres signifiants qu’il suggère, et donc, des signifiés. C’est redire l’importance du langage dans un roman où même les relations entre certains personnages sont d’ordre linguistique. Ainsi de John Clare, rejouant dans la mort son évasion de l’asile en 1841 pour retrouver son amour d’antan, Mary Joyce, tombe sur une Lucia Joyce, volontiers voluptueuse. Le signifiant-désirant (Lucia Joyce) se donne à la place du signifié-désiré (Mary Joyce), par la seule grâce du langage.
Enfin, il faut insister sur la dimension politique et géographique de Jérusalem. S’emparant d’un quartier pauvre et marginal, les Borough, d’une ville elle-même déchue de son ancienne et tumultueuse histoire, Northampton, pour en faire le « centre » de l’Angleterre, Moore entre en résonnance avec une histoire sociale riche de révoltes estudiantines médiévales, d’utopies religieuses révolutionnaires, de grèves socialistes, de rues miséreuses, de luttes contre le racisme ou l’homophobie, de bagarres avec les brutes du British Union of Facists d’Oswald Mosley, de fiertés ouvrières et de désindustrialisations, de spéculations immobilières et de dérélictions urbaines… Une histoire populaire et vivante que peuplent aussi les rêves et les désirs des habitants des Borough. Jérusalem semble résumer l’opposition entre la notion d’ « espace vécu » et celle d’ « espace aliéné » théorisée par le géographe Armand Frémont. Dans les Borough, l’espace vécu des gens, approprié dans toutes ses dimensions, que symbolise Mansoul, est sans cesse menacé dans son élaboration par l’espace aliéné du travail abêtissant et des politiques urbaines du Capital. La vision hallucinée du « Destructeur », colossale cheminée industrielle dévorant le tissus même du réel et du temps, rappelle les « dark satanic mills » (les « ténébreux moulins sataniques ») issus du poème de William Blake « And did those feet in ancient time » que les anglais nomment couramment… « Jérusalem ». Le Destructeur d’Alan Moore broie dans les feux du calcul égoïste fééries, merveilleux, fraternités, mémoires populaires et vieilles religiosités… jusqu’aux anges et aux démons qui tentent d’éteindre l’incendie.
Le géographe marxiste américain David Harvey appelle de ses vœux un « matérialisme historico-géographique ». En attendant, peut-être peut-on dire que Jérusalem élabore un idéalisme historico-géographique qui vient combler cette lacune, l’idéalisme ayant toujours un coup d’avance sur le matérialisme. L’art d’Alma – et donc celui de Moore, le titre de chacun des chapitres du livre reprenant ceux des tableaux de l’exposition d’Alma – se pose alors comme un instrument de lutte afin de sauvegarder Mansoul et d’achever sa construction. « And was Jerusalem builded here / among those dark satanic mills? » se demandait William Blake. Alma et Moore lui répondent : « JUSTICE AU-DESSUS DES RUES », Justice au-dessus des mots.
Victor Blanc
Alan Moore, Jérusalem, Traduit par Claro Editions Inculte, 28,90 €, 1266 pages
Share this...

