 En 1982, je crois, mais n’en suis pas tout à fait sûr, au Centre Beaubourg, à la fin de l’année scolaire, tandis que je m’ennuyais à ne savoir que faire dans les espaces d’exposition, je remarquai un attroupement. Un célèbre écrivain signait quantité d’exemplaires de sa dernière oeuvre. Je n’avais rien lu de lui, mais je le rangeais dans les médiocres : en deçà de la littérature. Je m’en détournai quand, à gauche de l’attroupement, je vis, seul à une table, devant une pile de livres, s’ennuyant à faire pitié, le front énorme et saillant de veines posé dans une main toute menue, Michel Leiris. Pour moi, c’était un ancien surréaliste. Je l’associais à Breton, Eluard, Péret, Aragon : à ce qui était alors pour moi la Grande Littérature.
En 1982, je crois, mais n’en suis pas tout à fait sûr, au Centre Beaubourg, à la fin de l’année scolaire, tandis que je m’ennuyais à ne savoir que faire dans les espaces d’exposition, je remarquai un attroupement. Un célèbre écrivain signait quantité d’exemplaires de sa dernière oeuvre. Je n’avais rien lu de lui, mais je le rangeais dans les médiocres : en deçà de la littérature. Je m’en détournai quand, à gauche de l’attroupement, je vis, seul à une table, devant une pile de livres, s’ennuyant à faire pitié, le front énorme et saillant de veines posé dans une main toute menue, Michel Leiris. Pour moi, c’était un ancien surréaliste. Je l’associais à Breton, Eluard, Péret, Aragon : à ce qui était alors pour moi la Grande Littérature.
Je n’eus pas à faire la queue. Personne ne lui demandait rien. J’achetai un exemplaire de l’Âge d’homme et le lui tendis. Son visage se défit un peu de l’extrême mélancolie qui l’accablait, et se fit courtois, sans aller jusqu’à sourire. Je contemplai absolument et silencieusement cet homme. Sa main minuscule et tachée se déprit lentement de son front bizarrement bosselé (bossué écrit-il à la première page de ce livre), et saisit avec difficulté – me parut-il – un beau, gros et noir stylo-plume qui me fit envie. Il leva vers moi son vieux visage. Oeil délavé, inquiet et bon, arêtes du nez piquetées de rouge, peau tendue et fine à craquer, bouche décharnée comme ouverte au scalpel dans la chair, teint rose-rouge, dû sûrement aussi à la chaleur.
« Comment vous appelez-vous ? » Sa voix était douce et d’une très intimidante politesse. Je répétais plusieurs fois mon nom, et l’épelai. Il se mit à écrire. Je mettais toute mon ardeur à le contempler, à l’enclore dans ma mémoire. Son cou flétri sortait d’une chemise blanche d’un rare tissu. La veste beige, qu’il n’aurait sans doute tombée pour rien au monde, me semblait trop chaude, quoique très élégante. Il portait une cravate dont j’ai oublié la couleur. Sa main tremblait en écrivant. Je ne crois pas que je cherchais alors quelque chose à dire. Je n’avais rien à lui dire. Je le contemplais. Je le lisais de l’oeil. Il s’appliquait à bien rédiger sa dédicace. Rien ne pressait. Tandis que l’illustre d’à côté signait à la chaîne, en donnant de la voix, nul ne nous dérangeait ; il n’y avait personne pour me succéder. Notre solitude silencieuse m’intimidait sans doute, mais j’en étais très heureux. Certain d’être seul devant un monument de la littérature, je ne doutais pas de vivre un des rares moments de ma vie qui comptent.
Je contemplai encore et encore cette tête d’oiseau ou de saurien, je me complaisais à énombrer les veines sur ce crâne que je surplombais tandis qu’il était penché sur sa page. J’imaginais bientôt qu’une conversation allait naître entre nous, à l’écart des gogos qui faisaient la queue devant une des plus fausses valeurs du siècle. Leiris allait être frappé de mon indépendance et de mon acuité intellectuelle ; nous nous reverrions ; je lui montrerais quelques-unes de mes compositions ; il me présenterait à des cénacles ; une querelle littéraire, dans laquelle je prendrais son parti, lui montrerait ma fidélité et mon courage ; je serais devenu comme son fils. Mais il me tendait l’exemplaire qu’il venait de fermer, et je n’avais plus qu’à partir. J’émis un lourd et puissant « merci », que je souhaitais chargé de toute mon admiration, auquel il répondit avec obligeance en me serrant – à peine, si doucement – la main, j’hésitai un instant, et partis à petits pas.
Je me retournai et vis qu’il avait repris sa pose mélancolique, le front incliné dans sa petite main, attendant d’en finir avec cet après-midi de captif. « Pour Denis Podalydès, hommage très sincère de Michel Leiris. » L’écriture est chaotique bien qu’appliquée. Les « p » sont très étrangement calligraphiés. Le mot « hommage » s’étire et se creuse en ses deux « m ». « Très sincère » rebique et finit en l’air. La signature est belle et prolongée : tout le nom figure. Je me sentis dès lors lié à cet écrivain et, cependant, l’Âge d’homme me laissa presque indifférent. Quelques années passèrent. Le petit homme élégant, au front pensif et lourd, crevant d’ennui derrière sa petite pile d’oeuvres, disparut presque de ma mémoire. J’avais cessé de lire les surréalistes, dénigrais chacun de ses représentants, me moquais copieusement de leurs productions, placardais férocement les miennes.
Inscrit au programme de lettres modernes du concours de l’ENS en 1985, Biffures, premier volume de la Règle du jeu, me bouleversa. Je ne retrouvais plus rien de l’amphigourie aléatoire et de la brocante cabalistique des surréalistes. Je me passionnai pour cette autoanalyse rigoureuse et pleine d’anxiété. Je m’identifiai savamment, jusqu’à épouser les défauts, les faiblesses, les vices, dont il se fustige méthodiquement. Puis je l’oubliai de nouveau, dégoûté de ces jeux nombrilistes, dans lesquels je l’accusais et m’accusais de nous complaire.
Quelques années plus tard, retombant sur mon volume dédicacé, je relus l’Âge d’homme, puis, d’année en année, méticuleusement Fibrilles, Fourbis, Frêle Bruit. Je repris le fil autobiographique infiniment retendu, impitoyable et scrupuleux. Ses fiascos, ses déceptions, ses turpitudes m’étaient infiniment chers. Une photo de lui, prise dans les années vingt, m’a toujours enchanté : adossé à une grille, dans un veston étroit fermé par un seul bouton, chemise blanche et noeud papillon, mains dans les poches d’un pantalon trop court, sa grosse tête aux cheveux gominés tournée vers sa gauche, il offre à son insu l’image très pure d’un jeune dandy, mince et de petite taille, sur le point sans doute de se rendre à une surprise- partie. Un Fred Astaire mélancolique. Leiris aimait danser. Danser et boire, s’enivrer frénétiquement, et frénétiquement occuper la piste qui libérait ses ardeurs empêchées.
Je projetais parfois de tirer de mes rêveries et de ma lecture maniaque un spectacle, un scénario, l’ébauche d’un personnage que j’imaginais sous les traits d’un Chaplin perclus d’angoisse et de fantaisie nerveuse, provocatrice et timide. Rebuté par ces projets erratiques que je ne savais pas mettre en oeuvre, je tâchais encore d’abandonner Leiris. Je découvris entre-temps la tauromachie, qui me renvoya au Miroir (est-il plus belle ligne consacrée à l’art du torero que cet incipit : « Donc le matador se tient debout. »), aux poèmes d’Abanico para los toros (« Seul/Devant les ronces des cornes »), à la correspondance avec Robert Castel, Jean Paulhan, et bien sûr Georges Bataille, au Journal, à Grande Fuite de Neige (« Seul le taureau dormait au fond d’une chambre noire. »). Que cet homme-là, corps grêle, esprit anxieux, tour à tour pusillanime et courageux, toujours exigeant, coupable et généreux, que cet homme-là fut aficionado me le rendait aussi proche que secret : absolument personnel. Je poursuivais mon ridicule fantasme d’appropriation et d’identification. La très exhaustive biographie d’Aliette Armel me donna une somme de données – sociales, familiales, historiques – grâce auxquelles mes lectures gagnèrent une plus grande précision, de sorte que j’aurais pu me croire vivant dans son monde, double parmi ses doubles, qui n’ont sûrement pas manqué.
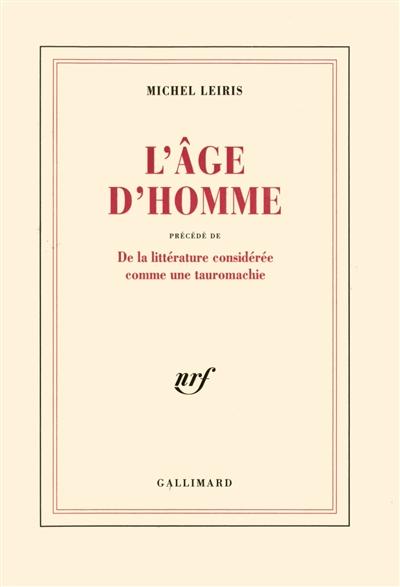
À « l’orée de la grotte », j’aime considérer ce matador illusoire, comique malgré lui, Narcisse déçu, faisant force de ses incurables faiblesses, et inversement. Leiris demeure un personnage que je quitte et reprends tour à tour, un principe d’adhésion et de retrait, une rencontre jamais sans mélange. Du petit vieillard éprouvé par la chaleur et l’ennui au comédien d’occasion, élégant et chaplinesque, je laisse flotter l’image dans ma mémoire, erratique et cependant tutélaire. Depuis ce premier jour de notre insignifiant entretien, jusqu’à l’invention mobile d’un personnage de théâtre, je cultive une mythologie souple, ce fantasme inabouti de n’être qu’un fétiche de mots, de centaines de pages lues, oubliées, relues, fermentées.
De Leiris, j’aime : qu’il soit né un 20 avril (quand je suis né un 22) ; son horreur de se voir dans la glace ; qu’il ait eu des frères ; ses frayeurs enfantines ; son combat épuisant contre sa propre peur ; sa scrupuleuse probité ; sa frénésie ; son engagement politique fait de mille réticences et de mille ratages ; ses amours toujours malheureuses (avec les Judith) ; son amour pour Zette (sa Lucrèce) ; ses commentaires sur Rafaellillo Ponce ; son style aux aguets – méticuleux, objectif, détaillé –, ne voulant jamais rien laisser échapper de son objet d’étude ; son personnage d’homme scientifique – aux limites aussi de la comédie ; ses détresses répétitives qui l’abattaient lourdement ; ses voyages (la mission Dakar-Djibouti) où fuir ce qui lui revenait tôt ou tard au visage ; sa bagarre mémorable à Béni-Ounif ; sa liaison avec Khadidja ; son goût de l’opéra qui l’emporta lorsqu’il cessa d’aller « aux taureaux » ; le récit de sa tentative de suicide ; ses amitiés vives ; sa théorie du merveilleux, espace sacré sans intervention d’une transcendance (qui finit Frêle Bruit) ; sa mort discrète, patiemment attendue : une extinction.
Denis Podalydès
Share this...

