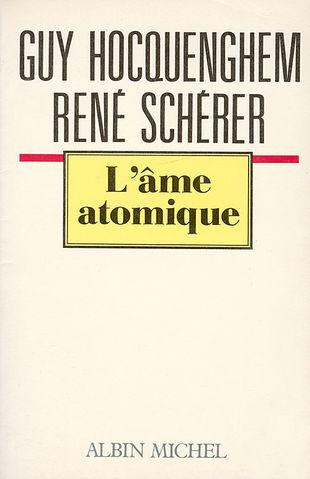 Une intime collaboration avec Guy Hocquenghem, dans la rédaction de Co-ire et de l’Âme atomique, ainsi que pour quelques articles épars ; le fait que, depuis 1962 il a été mon élève au Lycée Henry-IV, pour la préparation à l’École de la rue d’ULM, puis assistant à l’université de Vincennes, cette longue familiarité et cette communauté d’esprit, font, on le comprendra facilement, que je suis le dernier à pouvoir en parler avec aisance. Trop de choses nous furent communes, pensées et autres. Trop d’impondérables. Je ne trouverais, en fin de compte, à dire, reprenant banalement le mot célèbre de Montaigne : « Parce que c’était lui, parce que c’était moi. » Puisqu’il faut bien, pourtant, céder à la coutume célébrante, je me décide, quitte à y ajouter quelque glose, à donner à la publication, pensant qu’au fond peu de gens l’ont lu, ce petit écrit déjà paru dans mon Pari sur l’impossible, aux Presses universitaires de Vincennes, en 1989, cet Angelus novus dont le titre était emprunté à Walter Benjamin et qui, dans mon esprit, convient toujours si bien à l’évocation d’Hocquenghem, à cerner sa figure :
Une intime collaboration avec Guy Hocquenghem, dans la rédaction de Co-ire et de l’Âme atomique, ainsi que pour quelques articles épars ; le fait que, depuis 1962 il a été mon élève au Lycée Henry-IV, pour la préparation à l’École de la rue d’ULM, puis assistant à l’université de Vincennes, cette longue familiarité et cette communauté d’esprit, font, on le comprendra facilement, que je suis le dernier à pouvoir en parler avec aisance. Trop de choses nous furent communes, pensées et autres. Trop d’impondérables. Je ne trouverais, en fin de compte, à dire, reprenant banalement le mot célèbre de Montaigne : « Parce que c’était lui, parce que c’était moi. » Puisqu’il faut bien, pourtant, céder à la coutume célébrante, je me décide, quitte à y ajouter quelque glose, à donner à la publication, pensant qu’au fond peu de gens l’ont lu, ce petit écrit déjà paru dans mon Pari sur l’impossible, aux Presses universitaires de Vincennes, en 1989, cet Angelus novus dont le titre était emprunté à Walter Benjamin et qui, dans mon esprit, convient toujours si bien à l’évocation d’Hocquenghem, à cerner sa figure :
Frère Angelo, le dernier roman de Guy Hocquenghem, celui qui devait être son ultime message, car sa main, les épreuves corrigées, s’est arrêtée d’écrire, est, sans aucun doute le plus admirable. Oeuvre des sommets, de l’akmé : celle où l’écrivain est parvenu à la pleine maîtrise de son art, par l’économie de moyens, par l’aisance du style, l’équilibre des parties, la convergence des thèmes dans l’embrasement final.
C’était lui qui l’avait renouvelé, ce grand genre du roman philosophique et historique (études philosophiques au sens balzacien), où l’érudition pointilleuse soutient la percée dans l’imaginaire, où la brillance du détail renforce l’expression de l’idée. Mais on pouvait se demander, après la Colère de l’agneau, après Eve, comment aller plus loin dans l’exploration des problèmes qui nous tourmentent, de notre angoisse présente, de son ancrage dans le passé. Frère Angelo apporte la réponse. Cette fois, achevant la trilogie, c’est la naissance même de la modernité qui est en jeu : la modernité avec ce qu’elle comporte de catastrophes et d’échappées utopiques ; complexe énigmatique qui est l’histoire des temps modernes et dont l’âme individuelle est pétrie.
Voilà ce qu’il faut lire à travers la dérive initiatique et extatique de ce moine, disciple de Savonarole, ange terrestre errant, du sac de Rome aux rives lointaines de Mexico, jusqu’à son propre martyre.
Je ne résumerai point ce que l’on doit savourer à chaque page, avec quoi il s’agit de communier. Je dirai simplement pour que cela soit clair à ceux qui ne l’ont pas fréquenté, que le questionnement de la modernité fut, depuis quelques années, la préoccupation constante de Guy ; qu’il est devenu l’objet par excellence de son écriture romanesque. L’énigme de la modernité, c’est-à-dire celle d’hommes ballottés dans le renouvellement incessant de l’histoire, voilà le point commun des trois volets du triptyque. Une modernité déjà marquée, depuis le Christ, par la conjonction de la catastrophe avec l’attente de l’illumination dernière, de l’apocalypse.
Celle-ci inauguralement et, pour ainsi dire, naïvement présente comme réalité entrevue dans l’Evangile de Jean, se transforme, à la Renaissance, en espérance mystique liée à la découverte du Nouveau Monde, cru paradisiaque, pour se métamorphoser enfin en dimension utopique qui nous fait vivre, par-delà l’envahissement du réalisme odieux et du non-sens.
Du triptyque, Frère Angelo occupe le centre. Ce mundus novus, ce monde nouveau que le franciscain vit à sa source est la clef du nôtre. L’évidence de Dieu commence à s’y obscurcir, avant de définitivement se dérober. Mais elle se déplace, se dépose ailleurs, en chaque fragment de beauté, chaque geste d’amour, formant l’accompagnement de la révolte sensuelle, la traîne poétique des choses, allégoriquement.
Avec Guy, d’une commune entente, en une collaboration intime, nous avions donné, dans l’Âme atomique, les lignes directrices, et quelques échantillons concrets de cette philosophie esthétique de « l’allégorèse » . Qu’est-ce que l’âme, où peut-elle se loger, alors que, de toutes parts, la science moderne et le progrès la chassent, la rendent impossible ? Elle est là, dans la poésie, dans l’art, l’écriture du roman où l’âme de Guy se trouve désormais enclose. Il n’y a pas, il ne peut pas y avoir que le corps ; tout, en nous, s’y refuse. Il y a l’âme, cet « infini du corps », comme disait superbement Artaud.
Cette certitude unifiait, chez Guy Hocquenghem, la gnose chrétienne avec la mystique moderne, mais aussi avec le matérialisme de Lucrèce, qu’il a si bien commenté dans des cours dont ses étudiants de Vincennes garderont le souvenir ; avec l’esthétique paradoxale de Kierkegaard ; avec l’allégorisme de Fourier et de Baudelaire, ou, plus près de nous, l’esthétique de Walter Benjamin, et celle, négative, de Theodor Adorno.
On me demandera : comment tout cela s’accordait-il avec la pratique homosexuelle, avec la défense et l’illustration de l’homosexualité à laquelle le nom de Guy Hocquenghem restera historiquement associé ? Le mysticisme, pour lui, ne fut jamais une ascèse, dans le refoulement des sens, mais l’autre face, la doublure de leur exploration. Un allégorisme vécu : Vivre allégoriquement, aimait-il à dire. Et, d’autre part, il ne pensa jamais, dès l’époque du FHAR, l’homosexualité comme simple particularité sexuelle, relevant d’une sexologie, mais comme d’une vision du monde, manière d’être totale.
D’où son indéniable dimension esthétique, éthique, utopique. Le désaccord fécond de l’homosexuel et du monde actuel a toujours été l’un des thèmes majeurs de son oeuvre. L’homosexualité, est, contre ce monde, ou en marge de lui, un état de perpétuelle contestation : elle espère, elle entrevoit un ailleurs. Entre elle et la mystique, l’allégorèse au sens que nous lui donnions, la conséquence est bonne, l’analogie s’impose.
Un même refus du monde tel qu’il est a animé Genet et Pasolini, mais aussi en d’autres sphères que l’homosexualité, et qui exerçaient sur Guy Hocquenghem une très grande séduction, Walter Benjamin, Charles Fourier ; en retour, il ouvrit sur eux des aperçus fulgurants, inattendus, avec l’acuité, la sûreté de jugement, la clarté dans l’énoncé que tous ceux qui l’ont approché lui reconnaissent. Avec une puissance visionnaire, dont Frère Angelo porte le témoignage.
C’est ainsi que ma récente mémoire lui fera franchir les portes de la mort, l’allégorisant par cet Angelus novus de Paul Klee que Benjamin a décrit : « S’en allant au vent de l’histoire bouche ouverte, l’oeil rivé sur la catastrophe présente, les ailes déployées vers l’avenir. »
Cela était écrit en septembre 1988, juste au lendemain de sa mort.
Et voici maintenant la glose. Non parce que je ne pense rien retoucher à l’éloge déjà ancien, mais pour insister, au contraire sur cet esprit d’utopie qui me paraît avoir imprégné et animé l’oeuvre et la pensée de Guy.
Esprit d’utopie dans le sens que lui donnait Ernst Bloch. Qui ne se relie pas à une projection dans l’avenir selon un programme déterminé, mais qui colore tout le présent, le fait, en quelque sorte, décoller de la platitude quotidienne. Une utopie porteuse de visions et non de système. Une utopie dont la fonction essentielle, peut-être, est de déplacer le centre de notre vision, de le porter ailleurs. Moins celle de projeter un autre monde que de faire découvrir, dans ce monde-ci, autre chose que ce que notre vue, qui est bien souvent bévue, nous y fait seulement regarder.
Un déplacement du centre, du « point de voir », comme disait Fernand Deligny, une décentration. Il est certain que, quoi qu’on lise de Guy Hocquenghem, quoi qu’on observe de sa pensée et de sa vie, on y décèlera ce mouvement qu’on peut appeler aussi un changement d’axe. On le nommera utopie, comme chez Fourier où tout se met à graviter autour du plein essor des passions. Chez Guy, aussi, l’utopie est liée à l’évidence d’un tel changement. Elle est brusque, car beaucoup moins démonstrative que visionnaire.
Ainsi, quand il écrit le Désir homosexuel, c’est à une telle conversion qu’il invite, dès le départ. Ce qui pose problème, ce n’est pas l’homosexualité, mais la psychose anti-homosexuelle qui hante la plus grande partie de l’humanité actuelle ; il faut changer d’axe, de point de voir, de centre de gravitation, et faire tout tourner autour du désir, et, en celui-ci, prendre pour guide l’objet de l’anathème, ce que l’on exclut, la perversion. Tout se retourne alors, tout change. L’homosexualité n’est plus une façon, entre autres, de vivre sa sexualité, mais une conversion radicale dans la manière d’être au monde.
On comprend que, dans sa pensée, dans sa vie, il ait sans cesse traqué les retombées de sa vision, la chute dans les identités. Qu’il ait cherché passionnément à s’en arracher. Pour retrouver, dégager la source visionnaire. Ce point source de lumière qui vient toujours d’ailleurs.
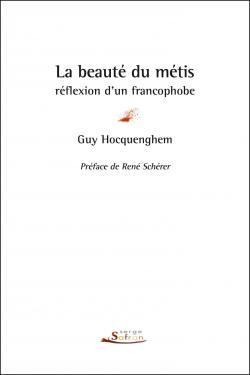
Sur quoi s’ouvre ce livre de flammes, sur quoi il se conclut. Et je ne peux mieux faire que me contenter, cette fois, de laisser à Hocquenghem la parole : « Oui, j’ai eu plus d’amants, plus d’amis, à l’étranger, de l’étranger, que je n’en aurai jamais parmi mes compatriotes. Peut-être même ne suis-je “homosexuel” comme on dit vilainement, que comme une manière d’être à l’étranger…. Etranger, bel et vivace étranger, comment font-ils pour ne pas l’aimer ? Toi seul nous interromps dans notre maniaque monologue, nous interpelles. »
Et, plus actuel encore, peut-être, qui nous concerne de plus en plus chaque jour : « J’ai commencé à écrire tout ceci parce que demain, un ami, un inconnu, un exilé peuvent être détenus, transférés, extradés simplement parce qu’ils sont étrangers. » Ou, pour la bonne bouche : « On ne nous contrôle qu’avec l’espoir de nous prendre en flagrant délit d’être étranger. » Ecrit en 1979. Et aujourd’hui ?
René Schérer, 30 août 2008
Share this...

