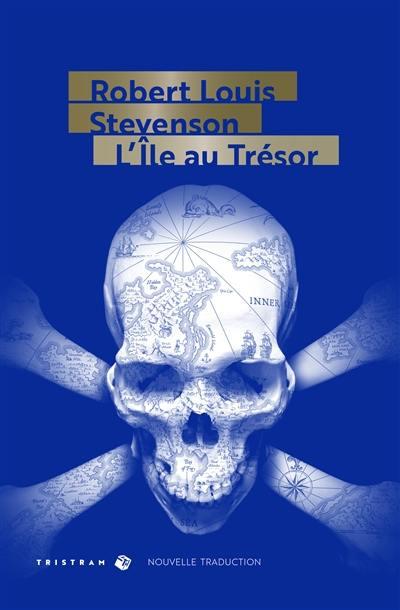
Une nouvelle traduction de L’Ile au trésor, un des plus célèbres romans dévorés par les adolescents de jadis (je doute qu’à l’époque de la télévision à 900 chaînes, des plaquettes et des consoles de jeux, les aventures de Jim Hawkins trouvent autant de public), pour quoi faire ? Précisément parce que Stevenson n’est plus l’auteur de la seule Ile au Trésor (et, accessoirement, de Dr Jekyll et Mr Hyde), mais qu’il est enfin reconnu par un vaste public comme le plus grand romancier anglais de son siècle – avec Dickens, évidemment. Ce que, à l’époque, savaient Henry James, ou Mark Twain (lui aussi longtemps considéré comme un « auteur pour la jeunesse »).
En France, sa fortune « littéraire » lui est venue des regrettés Francis Lacassin et Christian Bourgois qui, dans les années soixante-dix, ont réédité en 10/18 tous les titres traduits, plus ou moins bien, dès leur parution en anglais. Aujourd’hui, il bénéficie d’une Pléiade – inégalement réussie. Et, entre Lacassin et la Pléiade, il y eut Michel Le Bris qui, sous l’égide de Phébus, de Payot et de La Table Ronde, s’est fait son héraut, et a publié nombre d’inédits, dont une passionnante correspondance.
Et j’en arrive à la justification de cette traduction nouvelle : si Stevenson – comme Mark Twain, dont le cas est assez similaire – était considéré comme un romancier « pour la jeunesse », c’est que ses romans les plus lus mettaient en scène des adolescents, et leurs aventures, et qu’ils étaient traduits sans soin, par des traducteurs peu soucieux de tenter de rendre en français ce qui faisait d’eux des écrivains immenses. Ce qui faisaient d’eux des écrivains immenses : leur style, et leur « modernité ».
Une « modernité » reconnue par leurs pairs (Henry James considérait Stevenson comme son égal, et leur correspondance témoigne du respect mutuel qu’ils s’accordaient, et Faulkner et Hemingway ont tous deux affirmés que toute la littérature américaine contemporaine sortait de Huckleberry Finn), mais ignorée par les traducteurs de la Bibliothèque Verte, – et par les universitaires qui, responsables de la Pléiade en tête (qu’il s’agisse de celle de Stevenson, ou de celle de Twain), semblent toujours avoir du mal à « théoriser » sur des romanciers qui sont avant tout des conteurs, et dont la limpidité de façade dissimule des abîmes réservés aux lecteurs qui ont gardé un esprit d’enfance.
On pourrait continuer pendant des pages – comme un universitaire. A quand une thèse sur le parallélisme entre Twain et Stevenson ? Disons, plus rapidement, que ce n’est pas un hasard si les éditions Tristram qui, via la plume du regretté Bernard Hoepffner, ont donné à lire une véritable traduction de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn, nous proposent aujourd’hui une nouvelle Ile au Trésor. Car Stevenson, comme Twain, sont des écrivains à entendre autant qu’à lire, et le sens de leurs livres ne se dévoile qu’à travers les voix des personnages. Il faut les lire « à l’oreille » (comme Salinger, dont The Catcher in the Rye ne prend son sens qu’en V.O.)
Autorisons-nous un raccourci (car l’oeuvre de chacun d’eux est multiple) : Twain fait parler des Noirs, ou des petits Blancs du Sud, et Stevenson des Ecossais, ou des pirates, ou des Blancs échoués sur les îles du Pacifique, tous avec leurs accents, leurs mots, leur syntaxe. Ce qui est quasiment intraduisible, – ou très difficilement, sauf à les banaliser, à les aplatir, à les déformer. A ôter leur sens aux romans traduits. Car, ainsi que l’écrivait Michel Le Bris à l’occasion d’une nouvelle traduction de la « novella » The Beach of Falesa, le sens même du livre, autant qu’à son scénario, tient aux voix qu’on y entend (et c’est pourquoi, plutôt que La Plage de Falesa, traduction littérale du titre de Stevenson, il avait choisi d’intituler son édition Ceux de Falesa, c’est à dire ceux qui parlent le « beach of Falesa », le bêche-de-mer propres aux épaves échouées dans les mers du Sud).
Certains des plus grands romans de Stevenson – Kidnapped, Weir of Herminston (dont l’inachèvement est aussi regrettable pour les lettres anglaises que celui du Mystery of Edwind Drood de Dickens) – font une large place au dialecte écossais, car ce sont des livres sur des lieux (et leurs habitants) autant que sur des personnages. Et les traductions françaises peuvent difficilement leur rendre justice : il faut les lire en anglais, et les lire à haute voix, – ce qui prend du temps, mais n’est tout compte fait pas si difficile.
Le cas de L’Ile au trésor est un peu différent, quoique pas tant que ça, si l’on considère que les « Gentislhommes de Fortune » constituent une Nation apatride – indépendamment de l’origine de chacun – et que, comme toute Nation, elle possède sa propre langue. Jean-Jacques Greif a réussi à leur donner une langue en français : « Sauf vot’rexpet, msieur, vous prenez vot’ aise avec certaines règues ; vous srez ptêt aimabe d’observer les aut’. Ce quipage est pas satisfait ; ce quipage précie pas la tyrannie ; ce quipage a ses droits autant qu’un aut ‘ quipage, j’me permets ».
Ca sonne mieux, ça sonne plus « pirate », que « Je vous demande pardon, monsieur, vous êtes assez libre avec quelques-unes des règles, mais peut-être voudrez-vous bien ne pas perdre de vue les autres. Cet équipage est mécontent, cet équipage n’aime pas les reproches non justifiés, et cet équipage a ses droits comme les autres équipages, je me permets de dire cela. » (traduction de Théo Varlet, la plus lue pendant un siècle). Ou même que « Sauf vot’ respect, m’sieur, vous prenez trop de libertés avec certaines règles, et il faudrait p’têt voir à respecter les autres ! C’t équipage est mécontent ; c’t équipage en a assez d’être houspillé ; c’t équipage a des droits comme les autres, j’prends la liberté d’l ‘signaler. » (traduction Marc Porée, Pléiade, 2001).
En V.O. : « Ax your pardon, sir. You’re pretty free with some of the rules ; maybe you’ll kindly keep an eye upon the rest. This crew’s dissatisfied ; this crew don’t vally bullying a marlin-spike ; this crew has its rights like other crews, I’ll make so free as that. » Et « shiver my sides », une expression familière à Long John Silver, a plus d’allure en « Casse ma carcasse » qu’en « Que le diable m’emporte » (traduction Théo Varlet).
On se demande simplement pourquoi « Squire », un mot dont les lecteurs français ont l’habitude et qui restait en V.O. dans la première traduction, est traduit pas « Sieur » (en Pléiade, c’était « Seigneur », ce qui n’est pas mieux). Mais il s’agit d’une broutille, qui n’empêchera cette traduction exceptionnelle d’amener à Stevenson de nouveaux lecteurs, on l’espère.
Quant au roman lui-même, le premier achevé par Stevenson, s’il n’est pas aussi accompli que Kidnapped (le jeune Jim Hawkins est un adolescent moins subtilement travaillé que David Balfour) ou que The Wrecker (le plus grand roman « maritime » de Stevenson, et sans doute son plus grand roman tout court), il en annonce déjà toutes les promesses, et Long John Silver, le pirate-cuisiner cul-de-jatte, est la première incarnation, et l’une des plus réussies, du héros stevensonien type, cet homme double qui sera peu après, de façon un peu schématique, à la fois Docteur Jekyll et Mr Hyde. Avant que ce thème du double ne contamine insidieusement, de façon fascinante, comme des racines d’acacia ou de fraisiers, qui se démultiplient inlassablement, toute la fiction de Stevenson.
Christophe Mercier
Robert Louis Stevenson, L’Ile au Trésor Traduit de l’anglais (écossais) par Jean-Jacques Greif Tristram, 300 pages, 19, 90 €.
Share this...

