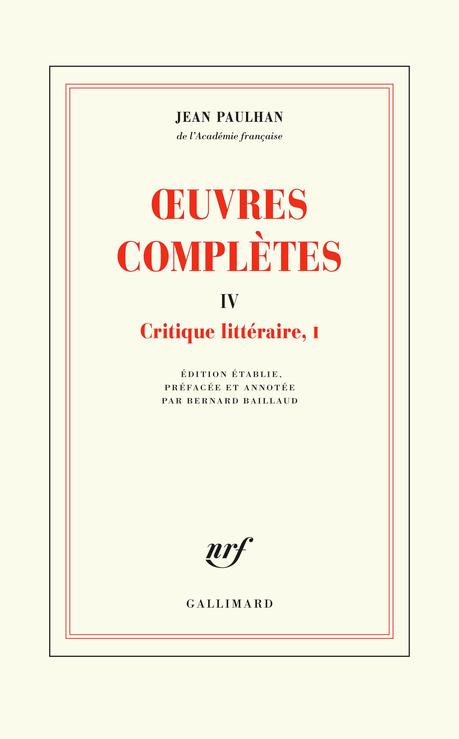 « Qui est ce type ? » a dit un jour Georges Perros, dans un article intitulé « Le métier d’être ou les instants bien employés » qui porte sur Jean Paulhan et son œuvre, Jean Paulhan grâce à qui Perros est devenu Perros quand, en 1953, La Nouvelle Revue Française renaissait de ses cendres et que Jean Paulhan, alors septuagénaire, cherchait des regards neufs comme celui de Georges Poulot qui allait dès lors signer – ses critiques et bientôt des « papiers collés » – Georges Perros…
« Qui est ce type ? » a dit un jour Georges Perros, dans un article intitulé « Le métier d’être ou les instants bien employés » qui porte sur Jean Paulhan et son œuvre, Jean Paulhan grâce à qui Perros est devenu Perros quand, en 1953, La Nouvelle Revue Française renaissait de ses cendres et que Jean Paulhan, alors septuagénaire, cherchait des regards neufs comme celui de Georges Poulot qui allait dès lors signer – ses critiques et bientôt des « papiers collés » – Georges Perros…
Jean Paulhan allait diriger cette Nouvelle Revue Française de 1953 à sa mort, après l’avoir dirigée une première fois de 1920 à 1940. Jean Paulhan fut un « guerrier appliqué », pour reprendre le titre de l’un de ses récits, qui figure dans le tome 1 de ses Œuvres complètes éditées chez Gallimard sous la direction de Bernard Baillaud, qui nous donne aujourd’hui les volumes IV et V rassemblant la critique littéraire de Jean Paulhan, l’auteur du grand ouvrage Les Fleurs de Tarbes qui figure dans le tome 3 des Œuvres complètes, livre qu’il avait deux fois publié, d’abord en 1936, puis en 1941 à la veille de créer Les Lettres françaises avec son ami Jacques Decour, livré aux Allemands par la police française en mars 1942, exécuté le 30 mai avec le sociologue Politzer et le physicien Salomon.
Jean Paulhan a toujours raconté que c’était Jacques Decour qui avait pris la tâche, dès 1941, de fonder la revue du Front National des Ecrivains : Les Lettres françaises. Jacques Decour était « long et mince, l’air moqueur. Il avait gardé une gentillesse d’enfant. » Jean Paulhan dit aussi de son ami qu’il est mort à trente-deux ans, sans avoir renié une seule de ses convictions, sans avoir trahi un seul de ses camarades. Il note qu’il écrivait en 1939, dans Commune : « La Révolution française nous a appris que la liberté politique et l’indépendance nationale sont inséparables. » Et Paulhan de souligner qu’il ne les séparait pas, et que c’est même pour l’une et l’autre qu’il s’était préparé à mourir et qu’il est mort.
Dans un texte intitulé « Pour l’éloge de Jacques Decour », qui figure dans le tome IV des Œuvres complètes, Paulhan raconte que son ami lui a dit un soir : « à présent, je sais qu’ils peuvent me prendre, et faire de moi ce qu’ils voudront. Je ne parlerai pas. » Et c’est ce qui est arrivé : ils l’ont arrêté, ont fait de lui ce qu’ils voulurent, mais il ne parla pas. Paulhan cite alors Périclès disant dans Thucydide : « Si je prouve qu’Athènes a des lois justes, j’aurai suffisamment fait l’éloge de nos héros. » Mais pour nous, dit-il, c’est tout le contraire : « le jour où la France aura des lois justes, nous auront fait un éloge digne de Jacques Decour. » « Paulhan le juste » est par ailleurs le titre d’un essai de Frédéric Badré, publié en 1996 aux éditions Grasset, un essai qui s’attache à retrouver l’unité d’un personnage complexe, multiforme, paradoxal. Ici, dans le tome IV des Oeuvres complètes, dans un texte de 1964, Paulhan lui-même se défend d’être paradoxal : « Ce sont les gens qui se trompent. Je ne suis pas paradoxal, je suis plein de bon sens. Mais le bon sens est paradoxal. N’est-ce pas paradoxal de croire que la terre tourne ? »
C’est la révolution copernicienne de Jean Paulhan, qui disait : « Fuyez langage, il vous poursuit ; poursuivez langage, il vous fuit. » Pour Paulhan, qui se considérait linguiste, le langage est un événement métaphysique. On a même prétendu que l’écrivain (et l’éditeur) avait passé sa vie à chercher ce que parler veut dire. Pourtant, à la toute fin des Fleurs de Tarbes, il dit : « Mettons que je n’ai rien dit. » Dans ce livre, sous-titré : « La Terreur dans les lettres », il y a notamment deux points : l’un est que la Terreur admet couramment que l’idée vaut mieux que le mot et l’esprit que la matière. Le second point porte que le langage est essentiellement dangereux pour la pensée (toujours prêt à l’opprimer, si l’on n’y veille pas). Et Paulhan de dire alors que la définition la plus simple que l’on puisse donner du terroriste, c’est qu’il est misologue. Mais ce n’est pas le cas de Paulhan, qui a de toute façon écrit beaucoup de contes et de récits qui n’ont rien à voir avec cette méthodologie : Les Causes célèbres, L’Aveuglette, mais aussi Lalie, Le Pont traversé, Le guerrier appliqué, et un petit roman, Progrès en amour assez lents, qu’il a écrit en 1915, au front.
Dans un entretien de 1967 (un entretien avec lui-même), Paulhan a expliqué que le personnage de son roman ne va pas lentement en amour parce qu’il est timide, mais il va lentement en action, ce qui est extrêmement agréable pour la femme (et pour lui assez fatigant). C’est la raison de son succès, et même de ses succès multiples (comme auprès de la dénommée Simone). Dès qu’on parle d’amour, dit Paulhan, il ne faut pas avoir peur d’en venir au côté physiologique de la chose. Paulhan aimait l’érotisme. Il aimait assez les orgies de Georges Bataille. Il aimait plus encore l’œuvre du marquis de Sade qui a quelque chose de très pur, avait-il déclaré au président de la XVIIIe chambre correctionnelle de Paris (Me Garçon), le 15 décembre 1956, qui voulait interdire l’édition des Œuvres complètes du marquis par Jean-Jacques Pauvert.
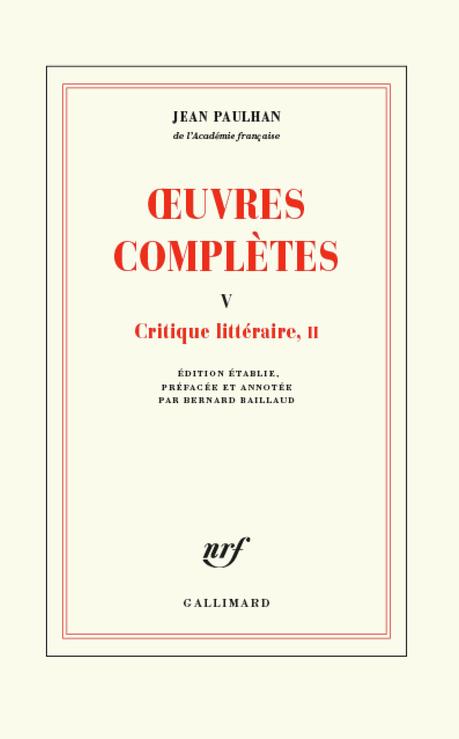
Duns Scot fut l’auteur d’une révolution subtile, celle de la possibilité d’une connaissance des individus, à une époque où il n’y avait de science que des Universaux (c’était du Foucault avant l’heure). Paulhan fut en tout cas celui qui s’est intéressé aux individus (à leur « hecceitas », dirait Duns Scot). Et c’est bien ce qu’on voit dans ces deux volumes de critique littéraire, qui paraissent aujourd’hui chez Gallimard, où les plus grands (Sade, Valéry, Rimbaud, Larbaud) côtoient les plus petits (Stephen Jourdain, Marius-Ary Leblond, Marcel Lecomte). C’est la position médiane de Paulhan, Paulhan le juste.
Didier Pinaud
Jean Paulhan, Oeuvres complètes IV et V - Critique littéraire Gallimard, Tome IV, 784 pages, 39,50 €Tome V, 784 pages, 39,50 €
Share this...

