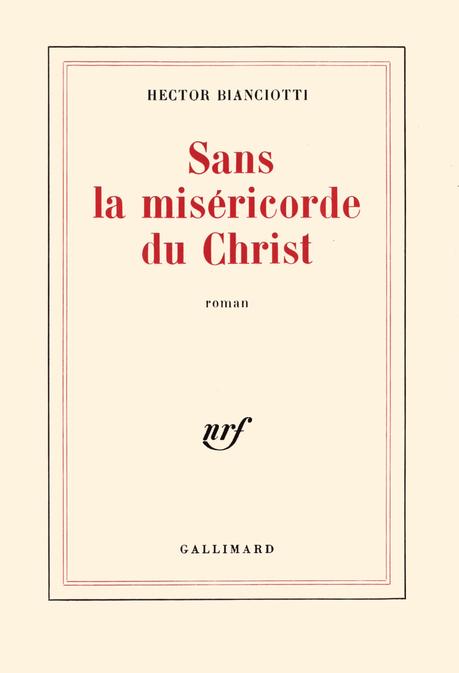 Paru il y a trente-trois ans, Sans la miséricorde du Christ marquait l’entrée d’Hector Bianciotti dans « le délicat labyrinthe de la langue française » comme il aimait à dire et le fit connaître du grand public grâce à son prix Femina obtenu, chose rare, à l’unanimité. Il avait toutefois déjà rédigé, dans cette langue que son admiration pour Paul Valéry l’avait convaincu d’adopter, une nouvelle, La barque sur le Neckar, dans son recueil L’amour n’est pas aimé qui lui avait valu le Prix du Livre étranger, en 1982.
Paru il y a trente-trois ans, Sans la miséricorde du Christ marquait l’entrée d’Hector Bianciotti dans « le délicat labyrinthe de la langue française » comme il aimait à dire et le fit connaître du grand public grâce à son prix Femina obtenu, chose rare, à l’unanimité. Il avait toutefois déjà rédigé, dans cette langue que son admiration pour Paul Valéry l’avait convaincu d’adopter, une nouvelle, La barque sur le Neckar, dans son recueil L’amour n’est pas aimé qui lui avait valu le Prix du Livre étranger, en 1982.
Né à Cordoba en Argentine, le 18 mars 1930, dans une famille d’émigrés piémontais qui y établirent une ferme, il était le sixième enfant d’une fratrie de sept (trois filles et quatre garçons) qu’il évoque dans le troisième tome de son autobiographie, Comme la trace de l’oiseau dans l’air (Grasset, 1999). Élu à l’Académie française, il prononça le 23 janvier 1997 un discours mémorable où il dit sa dette à une culture française vénérée. À quoi Jacqueline de Romilly, qui l’accueillait dans la vieille institution, répondit en soulignant, entre autres remarques pertinentes, l’importance de ce titre, Sans la miséricorde du Christ. « Bref, dire le silence de Dieu nous fait penser à lui », commentait la célèbre helléniste. Sans doute avait-elle raison de rappeler que dans l’oeuvre du romancier argentin, qui avait pensé devenir prêtre, Dieu est aussi présent qu’absent.
Ce titre, Hector l’avait emprunté à Elsa Morante qui avait projeté d’écrire un long roman sur le cinéma qu’elle avait intitulé Sans le réconfort de la religion. Du moins s’en inspira-t-il. Il avait rencontré grâce à leur amie commune, l’artiste italo-argentine Leonor Fini, l’auteur de La Storia, bien avant que ce roman ne soit écrit. C’était au milieu des années 1950, où fraîchement débarqué en Europe, Hector Bianciotti cherchait non seulement sa langue, mais aussi sa voie. Dans la cour de la fantasque décoratrice, costumière et peintre d’origine triestine, qu’il suivait d’Espagne en Italie et qu’il finit par accompagner jusqu’à Paris où il s’installa à son tour, le futur romancier avait été frappé par la personnalité de la femme de Moravia. Le suicide de son jeune amant américain détourna Elsa Morante de son projet de roman auquel elle substitua plus tard celui auquel elle dut sa gloire en 1974.
Hector Bianciotti était non seulement un grand écrivain, mais aussi un éditeur perspicace et un critique aigu et Jacqueline de Romilly avait vu juste quand elle déclara sous la coupole ce jour de réception : « On ne dira jamais assez à mon sens la puissance de la littérature. Je ne veux pas dire son rôle pour notre joie ou notre formation intellectuelle et affective, je veux dire son influence de fait – son rôle dans la vie des peuples où elle compte au moins autant que toutes les données matérielles –, je veux dire le pouvoir qu’elle peut exercer sur nos sympathies comme sur nos décisions. Je l’ai toujours cru, mais aucun exemple n’est à cet égard aussi probant que le vôtre. » Le lien de l’écrivain avec les livres se transformait volontiers en amitié avec leurs auteurs s’ils vivaient encore, mais parfois, si l’on peut dire, au-delà de leur mort. Alberto Savinio, qui devait inspirer le dernier roman d’Hector Bianciotti, La nostalgie de la maison de Dieu (Gallimard, 2003), en est la preuve. Sans parler de Borges, sa constante référence, du reste présent dans quelques paragraphes de Sans la miséricorde du Christ, sous les traits reconnaissables du « poète aveugle ». Ou de Silvina et Victoria Ocampo. Ou de Ruben Dario.
La publication du Traité des saisons (Gallimard, Prix Médicis du livre étranger 1977) avait permis de connaître les passions et le parcours général d’un petit paysan devenu un des citadins les plus raffinés, d’abord à Buenos Aires, puis à Madrid et enfin à Paris. Il était fasciné par le monde du spectacle, auquel il consacrera en partie son deuxième roman français, Seules les larmes seront comptées (Gallimard, 1989) et auquel il donnera de nombreuses années de sa vie, comme acteur de cinéma en Argentine (sous la direction de Leopoldo Torre-Nilsson) et en Espagne et comme assistant décorateur et lumières à l’Opéra de Paris.
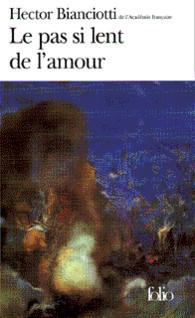
Quand il écrit Sans la miséricorde du Christ, Hector Bianciotti rassemble et transfigure tous ses souvenirs, en choisissant une protagoniste, Adelaïde Marese, exilée comme lui, venue du même pays, et dont il dit vouloir « préserver par l’écrit une vie dont les jours ne s’éclairèrent d’aucune gloire ». Il parsème son roman de très nombreux détails autobiographiques et le dialogue intérieur entre le narrateur et son personnage laisse transparaître un autoportrait de plus en plus évident, si bien que ce roman quoique entièrement fictif a été lu comme un aveu.
Avant de prendre carrément la parole à la première personne dans la série autobiographique qu’il commencera à publier moins de dix ans plus tard, il avait préféré dessiner la figure crépusculaire de cette femme simple à laquelle il s’identifiait ou du moins se comparait. Mais c’était, peu à peu, ses propres souvenirs qui remontaient à la surface. La ferme de son enfance qu’il décrivait. Le « il » ou plutôt le « elle » est plus facile à manier que le « je », car Hector Bianciotti n’était jamais tout à fait sûr de sa propre identité, tant il était convaincu qu’une vie était constituée de hasards et de rôles empruntés – « On ne se connaît soi-même que par ouï-dire », écrit-il ou encore : « Tout passe, rien ne nous reste et rien ne nous retient, sauf, un instant les miroirs. Quelques instants – et on ne s’y ressemble pas » –, lui qui, pourtant, avait une ligne de conduite si soucieuse d’éthique et d’authenticité, d’absolu et de rapport intense à une voix intérieure. À travers son personnage féminin, c’était cette voix qu’il faisait sourdre et qu’il entendait.
Le livre dut son grand succès non seulement à la prouesse que la critique célébra de ce spectaculaire changement de langue, après trois romans, un récit, une pièce de théâtre et un recueil de nouvelles écrits en espagnol, mais aussi à l’atmosphère envoûtante qui se dégageait de pages souvent sépulcrales, suspendues entre le passé et le présent, la vie et la mort. Les nombreuses digressions, les pages réflexives transformaient parfois le récit en manuel de sagesse sans prétention, en ascèse intime et cela séduisit journalistes et lecteurs, indépendamment de la trame mélancolique qui met en scène le destin d’une femme obscure, qui semble ne vivre que par procuration et frustration, souvenir et intuitions inachevées, le tout dans le décor populaire d’une brasserie de la porte Saint-Martin, décor qui était familier à l’auteur, dans ce vieux Paris de la rive droite qu’il affectionnait parce qu’il lui rappelait certains quartiers centraux de Buenos Aires, figé dans les années 1950.
« Nous ne laissons pas encore aux morts le soin d’enterrer nos morts : nous leur fournissons une demeure contre le néant ; nous payons la concession de six pieds de terre ou d’un bout de ciment, pendant ces quatre-vingt-dix-neuf ans que nous accordons à un souvenir pour qu’il passe d’une génération à la suivante ; puis, c’est selon, on apporte des fleurs, on les fait envoyer, on fait dire des prières. Nous essayons d’étouffer la rémanence des morts. Nous ne cessons pas de quêter leur pardon, car ils ne nous oublient pas. »
Extralucide, Hector Bianciotti écrivait là, au coeur de son roman dont un épisode conduisait ses personnages au Père-Lachaise, avec plusieurs décennies d’avance, sa propre épitaphe. Il devait mourir le 12 juin 2012, après une dizaine d’années de vie fantomatique. Il ne connut pas la grande vieillesse, mais une terrible anticipation de sa disparition en perdant l’usage ou du moins la maîtrise de la parole. Une maladie neurologique relativement précoce sema une grande confusion dans son langage qu’il avait toujours redouté de perdre. De plus en plus isolé et paralysé par cette infirmité, il tenta cependant de poursuivre bien des projets littéraires et de maintenir quelques amitiés fidèles avant d’en être totalement coupé par le silence imposé.
Il avait conservé, cependant, sa profonde sensibilité à la musique et un chapitre central du roman décrit de façon saisissante ce rapport-là qui ne sera jamais altéré en lui et auquel du reste il consacrera une grande partie de La nostalgie de la maison de Dieu. Évoquant la création du monde et la comparant à la musique, il esquisse une parabole de la matière et de l’antimatière, en opposant les dissonances de l’école de Vienne et les harmonies célestes de Bach. « Je sais, conclut-il, que la bataille immémoriale des atomes atteint l’homme là même où il se croit libéré des servitudes de la matière, dans les dérives de son imagination, dans son rêve. Mais où s’en est-elle allée, l’autre musique, celle au clair dessein d’intelligence, celle qui ménage des relais au coeur ? Peut-être le monde tend-il à l’oubli. »
René de Ceccatty
Hector Bianciotti, Sans la miséricorde du Christ « L’imaginaire », Gallimard, 352 pages, 12,50 €
Share this...

