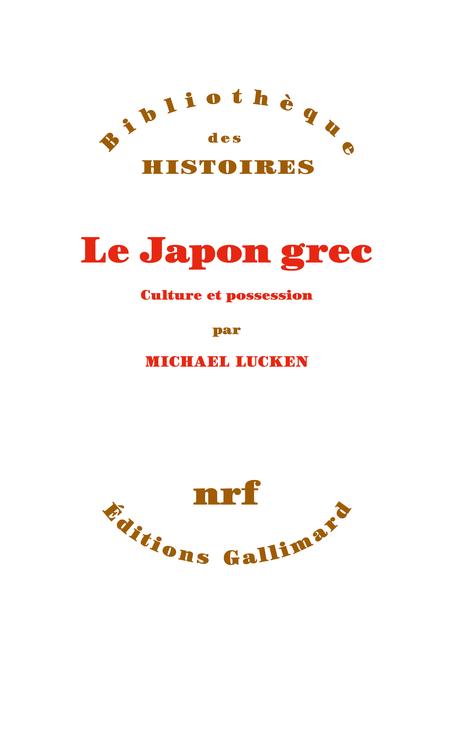 Souvent pensée comme exclusivement influencée par la pensée indienne et par la pensée chinoise, la civilisation japonaise, longtemps refermée sur elle-même et interdite d’accès quasiment jusqu’à la fin de l’ère Meiji (début du dernier tiers du XIXe siècle), à l’exception de quelques brèches (au XVIe siècle avec l’arrivée des Portugais porteurs du christianisme, puis avec le commerce hollandais et quelques incursions de voyageurs-savants dans divers domaines) a eu en réalité des rapports profonds, ainsi que nous le révèlent deux essais, avec la pensée grecque et avec la philosophie politique occidentale.
Souvent pensée comme exclusivement influencée par la pensée indienne et par la pensée chinoise, la civilisation japonaise, longtemps refermée sur elle-même et interdite d’accès quasiment jusqu’à la fin de l’ère Meiji (début du dernier tiers du XIXe siècle), à l’exception de quelques brèches (au XVIe siècle avec l’arrivée des Portugais porteurs du christianisme, puis avec le commerce hollandais et quelques incursions de voyageurs-savants dans divers domaines) a eu en réalité des rapports profonds, ainsi que nous le révèlent deux essais, avec la pensée grecque et avec la philosophie politique occidentale.
La traduction française d’un commentaire du Contrat social de Rousseau par le philosophe et traducteur Nakaé Chômin (1847-1901) est une mine de renseignements sur les échanges fertiles entre trois types de culture : européenne, chinoise et japonaise. Nakaé Chômin avait en effet appris la langue française et séjourné en France avant de traduire en japonais de nombreux ouvrages de philosophie politique, parmi lesquels le Contrat social. Socialiste avant l’heure, dans un contexte politique de grande effervescence, préludant à l’ouverture du Japon à l’Occident et surtout précédant la première constitution démocratique japonaise, il faisait partie d’un groupe de réflexion de sages tentant de mettre sur pied un texte respectant l’intérêt du peuple, avant d’y renoncer et de retourner à ses études. Et il entreprit alors la « traduction interprétative », en kanbun — langue sino-japonaise classique, sorte d’équivalent, si l’on peut dire, de notre latin pour les langues européennes — du Contrat social qu’il avait déjà traduit une première fois en japonais, traduction qu’il n’avait toutefois pas publiée. Il s’agissait, cette fois-ci, avec le kanbun, d’une langue artificielle, constituée exclusivement d’idéogrammes chinois et usant d’une grammaire sino-japonaise, très différente de la syntaxe japonaise. Comme le souligne le préfacier et traducteur Eddy Dufourmont, on se trouve en présence du dernier grand texte réflexif rédigé dans cette langue archaïque, mais en même temps du premier grand texte posant les principes d’une démocratie moderne. L’idée de Nakaé était de proposer une lecture de Rousseau à travers le filtre de la pensée chinoise (Confucius, Mencius, Tchouang-Tseu désormais appelé Zhuangzi), en employant une terminologie exclusivement chinoise pour traduire des concepts européens.
L’essai de Michael Lucken, de son côté, nous ouvre d’autres horizons, concernant l’influence de l’esthétique et de la pensée grecques sur le Japon, dans différents domaines : architecturaux, littéraires, sculpturaux, picturaux, politiques, spirituels et même linguistiques. Des découvertes archéologiques ont permis de faire remonter cette influence plus tôt qu’on ne pensait. S’il est facile d’analyser les textes (romanesques ou théoriques) qui se réfèrent explicitement au monde grec, il est plus délicat de déceler des traces dans la structure des temples japonais qui obéissent à de tout autres principes architectoniques, d’une part, et spirituels de l’autre. Les lieux n’avaient pas la même fonction, la même fréquentation et le rapport à la divinité était autre. Mais la pensée indienne, qui était arrivée, via la Chine, jusqu’au Japon, pour se mêler de façon plus ou moins syncrétique au panthéisme local, issu d’une autre tradition, avait elle-même été visitée par la Grèce.
Il s’agit donc pour le Japon, dans le cas de la philosophie politique française d’un côté et de l’esthétique (ou plus généralement de la vision du monde) grecque de l’autre, de deux ouvertures de types différents, mais qui permettent de penser d’une façon nouvelle la civilisation japonaise, du moins à partir de la fin du XIXe siècle, même si, nécessairement, pour comprendre son évolution, il faut remonter dans le temps. D’autant plus que le modèle chinois est très présent dans le premier cas, et que Nakaé Chômin ne manque pas de souligner les références à ses maîtres chinois, non seulement dans le vocabulaire, mais dans ses principes éthiques, spirituels et sociaux. La richesse des deux livres nous empêche d’en approfondir les détails et nous force à n’en donner que les grandes lignes.
Dans un des articles qui accompagnent l’interprétation « sino-japonaise » du Contrat social, Nakaé Chômin nous offre un pont entre l’univers chinois et l’univers grec. Il commente, en effet, la question « grecque » du scepticisme et du doute, thème fondateur de la philosophie européenne, qu’elle soit grecque, allemande ou française. Le doute comme fondement de la pensée philosophique. Mais rapidement, Nakaé Chômin rapporte le doute à un contexte chinois. Cela commence dès le vocabulaire dont il use, car il définit le doute grec en termes chinois à propos de Pyrrhon : « Il fit du doute le centre de son enseignement. Selon lui, le point essentiel est qu’il n’y a rien qui ne soit soumis au doute parmi les grandes choses comme la Terre, le Ciel, le Soleil, la Lune et les petites créatures. Il y a une limite à l’intelligence humaine, sa capacité ne touchant qu’à la superficialité des choses. » Suit une définition du pyrrhonisme, qui se conclut par une référence à la pensée chinoise et donc par une invitation à la confrontation des modes de pensée, et à un retour à la pensée chinoise après être passé par la pensée grecque : « Laozi faisait porter le doute sur la notion de mystère. Confucius mettait en question celle d’humanité, Mencius et Xun Zi celle de nature humaine. Par conséquent, il dit qu’après avoir accumulé du doute, l’esprit en a subitement une compréhension parfaite. Si on prenait aujourd’hui modèle sur Pyrrhon, même si on pouvait atteindre une voie médiane, on ne pourrait savoir pour autant que nos doutes soient désormais dissipés, et que nous ayons atteint la Voie dans sa rectitude. Pour le moment, j’écris cela en maintenant mes doutes et les fais connaître à ceux qui ne doutent pas d’eux-mêmes. »
Comme on le voit, Nakaé Chômin n’hésite pas à commenter de manière active la pensée grecque, afin de s’en servir pour réfléchir à la pensée chinoise. C’est probablement ce mouvement stimulant qui manque à l’essai de Michael Lucken (certes, écrit dans un tout autre esprit, puisqu’il s’agit non de philosophie comparative, mais d’une recherche historique sur la pénétration d’une influence grecque au Japon et sur les identités, sur la possession et la dépossession d’une exclusivité culturelle) qui répugne à analyser dans leur fond même les spiritualités, les philosophies, les esthétiques mêmes des deux cultures, grecque et japonaise. André Malraux, Paul Claudel et Marguerite Yourcenar ne sont jamais nommés par lui dans cet essai. Seul Ezra Pound, dans cette catégorie-là d’écrivains amoureux de confrontations culturelles et particulièrement tournés vers l’Orient, échappe, avec Lafcadio Hearn, à cet injuste silence. Les comparatistes, en quête de sources communes, de structures universelles ou de troublantes coïncidences, sont mis d’emblée hors sujet par l’historien, même si cela a été un fantasme du siècle des Lumières.
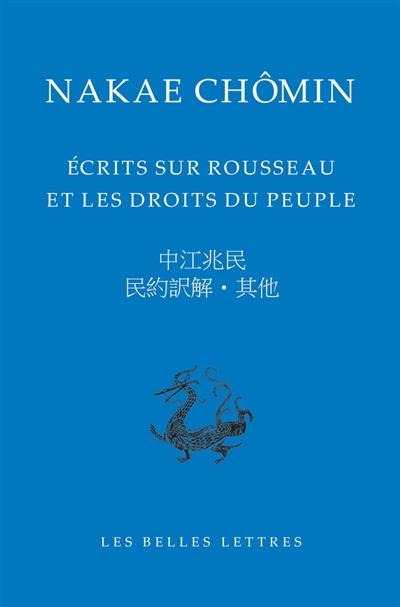
Le préfacier ne cache pas que le but de Nakaé Chômin était d’établir une rencontre, sinon une équivalence, entre Rousseau et Mencius (qu’il traduisait parallèlement en français), sur différents plans, notamment celui de son propre athéisme et de sa conception de la liberté ou de l’autonomie, qui n’était pas tout à fait celle de Rousseau. Omissions, simplifications ou au contraire ajouts, interventions, interprétations, inflexions caractérisent cette étrange version du Contrat social, qui a été du reste amputé, puisque Nakaé Chômin a interrompu son travail sans même finir le deuxième livre de cet ouvrage qui en comportait quatre.
L’essai de Michael Lucken, lui, est à la fois plus ambitieux et infiniment moins pointu, puisqu’il s’agit d’un survol diachronique, parfois rapide, parfois fouillé, des relations avouées ou secrètes entre le monde grec et la civilisation japonaise. C’est à travers les déplacements de la pensée bouddhique que s’est faite essentiellement la circulation : l’image « gréco-bouddhique » a en effet été importée par la statuaire et l’architecture des lieux de cultes. « Le corps du bouddha serait-il en partie grec ? », telle est la question par laquelle le chercheur résume le problème archéologique de cette influence. Façon inversée de poser la question de l’orientalisme. Mais Michael Lucken est prudent : l’art de la province du Gandhara, au sud-est de la Bactriane et de l’Hindu Kush, particulièrement touchée par l’influence hellénistique, n’a pas été directement importé. « L’hypothèse d’une origine gréco-bouddhique de l’art japonais permet de mettre en évidence des éléments de portée générale. Il s’agit d’un cas limite qui tire la continuité des cultures à son maximum, puisque, si un lien a existé, celui-ci est extrêmement discret et essentiellement indirect ».
Il s’attarde cependant sur les colonnes du temple du VIIe siècle à Nara, le Hôryûji, qui ont une « entasis », c’est-à-dire une forme galbée, par ailleurs inexistante dans l’architecture sacrée japonaise, ce qui semble indiquer un modèle indien d’influence grecque… La route de la soie aurait été le trajet suivi par ce courant esthétique inattendu.
Dans le domaine linguistique, les hypothèses paraissent plus fragiles, mais elles ont été également avancées avec plus ou moins de bonheur. De même paraissent hasardeuses les théories réunissant les divinités fondatrices du panthéon japonais et les héros grecs. Ce sont surtout les philosophes, beaucoup plus tardifs, (de l’école de Kyôto dans la première moitié du XXe siècle) qui seront les meilleurs importateurs de la pensée grecque et tenteront un dialogue entre les civilisations. Mais à vrai dire dans un seul sens. Car la traduction des textes japonais en langues occidentales, notamment des discours, sermons, sûtras des diverses écoles zen, trahiront des efforts souvent forcés de conceptualisation de termes infiniment plus imagés et ne relevant pas de la philosophie au sens grec du terme. Si les penseurs japonais n’ont guère eu de difficultés à comprendre la phénoménologie et les textes de Heidegger, ou le marxisme, ou les recherches de Derrida, de Deleuze et de Foucault, on ne peut pas dire que l’inverse ait été vrai. Et la pensée du néant, caractéristique de toute une tradition bouddhique, a parfois été mésinterprétée, en Occident, sous une forme caricaturale, l’infléchissant vers un nihilisme avec lequel elle a peu de rapport.
En multipliant les points de vue sur ce dialogue gréco-japonais (jusqu’à l’histoire du commerce et de l’immigration grecque), l’historien éparpille, nous semble-t-il, une démarche qui ne trouve ses véritables sens et centre que dans l’analyse précise des recherches et publications de la Société Classique de Japon, qui a procédé à des traductions systématiques de textes grecs anciens, avec d’intéressantes comparaisons entre le stoïcisme et le bushidô (l’éthique des guerriers) ou encore dans la fascination de certains écrivains (comme Mishima bien sûr, mais il en est bien d’autres) pour l’idéal esthétique grec.
L’essai se termine par un double entretien avec deux philosophes contemporains majeurs, Kôjin Karatani et Takaaki (ou Ryûmei) Yoshimoto, qui tous deux, à travers la lecture de Marx, réfléchissent à la démocratie, à la philosophie naturelle, au droit, à des notions ancrées dans la ou plutôt dans les pensées grecques (des présocratiques à Aristote, en passant par le matérialisme atomiste). Mais on est alors parvenu à l’âge moderne où le dialogue entre des philosophes d’origines culturelles diverses va de soi quand ils commentent des textes récents annonciateurs d’une situation politique, idéologique, économique contemporaine et donc finalement partagée pour le meilleur et pour le pire.
René de Ceccatty
Nakaé Chômin, Ecrits sur Rousseau et les droits du peuple Traduit du sino-japonais par Eddy Dufourmont et Jacques Joly Préface et notes d’Eddy Dufourmont. Edition bilingue Les Belles Lettres, 310 pages, 35€ Michael Lucken, Le Japon grec. Culture et possession Gallimard, « Bibliothèque des Histoires » 258 pages, 22,50€
Share this...

