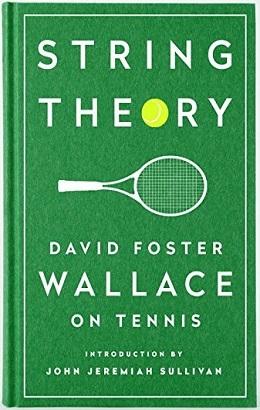 A Wimbledon, les bourrasques de vent qui ont balayé la capitale anglaise toute la matinée se sont enfin apaisées, et « le soleil émerge au moment précis où l’on retire la bâche du Court central pour y dresser les poteaux du filet. » Tandis que les juges de ligne, « dans leur uniforme Ralph Lauren aux allures de marinière », pénètrent sur le court, « on peut presque apercevoir, derrière les cabines de verre qui surplombent la tribune sud, les commentateurs de télévision qui piaffent sur leur siège. » Ce dimanche 8 juillet 2007, sur le gazon « calciné par la canicule » de l’All England Club, Rafael Nadal et Roger Federer vont s’affronter en finale. Si Federer remporte un nouveau titre, il égalera le record de Björn Borg. Le Suédois a fait le déplacement pour l’occasion, il est assis au premier rang de la loge royale. Un autre spectateur notable est présent ce jour-là dans les tribunes : l’écrivain David Foster Wallace a été dépêché spécialement par le New York Times pour couvrir la rencontre [1].
A Wimbledon, les bourrasques de vent qui ont balayé la capitale anglaise toute la matinée se sont enfin apaisées, et « le soleil émerge au moment précis où l’on retire la bâche du Court central pour y dresser les poteaux du filet. » Tandis que les juges de ligne, « dans leur uniforme Ralph Lauren aux allures de marinière », pénètrent sur le court, « on peut presque apercevoir, derrière les cabines de verre qui surplombent la tribune sud, les commentateurs de télévision qui piaffent sur leur siège. » Ce dimanche 8 juillet 2007, sur le gazon « calciné par la canicule » de l’All England Club, Rafael Nadal et Roger Federer vont s’affronter en finale. Si Federer remporte un nouveau titre, il égalera le record de Björn Borg. Le Suédois a fait le déplacement pour l’occasion, il est assis au premier rang de la loge royale. Un autre spectateur notable est présent ce jour-là dans les tribunes : l’écrivain David Foster Wallace a été dépêché spécialement par le New York Times pour couvrir la rencontre [1].
Wallace avait été, dans sa jeunesse, un joueur accompli, de niveau régional ; devenu écrivain, il a consacré plusieurs articles à son sport favori, et une partie de son grand œuvre, Infinite Jest, se déroule dans une académie de tennis. Cet été 2007, à Wimbledon, Wallace observe les moindres détails : le soin « enfantin et étrangement touchant » que met Federer à accrocher sa veste au dossier de sa chaise pour éviter de la froisser ; les coups d’œil inquiets que Nadal jette à droite et à gauche en marchant vers le fond du court, « comme un détenu qui s’attend à se prendre un coup de lame.»
Il y a aussi tout ce que la télévision escamote ou distord, le coup de fouet des raquettes, le bruit féroce des projectiles. Dans Boys of summer, son passionnant mémoire sur le baseball, le journaliste Roger Kahn se souvient du jour où un des lanceurs de l’équipe des Brooklyn Dodgers lui demanda de se placer en position de receveur, au cours d’un entraînement : « Son lancer me frôla dans une déflagration, un souffle strident doublé d’un bourdonnement de frelons, témoigne Kahn, tétanisé. Je n’avais jamais entendu une balle faire ce son-là. » Wallace a la même réaction en entendant, au bord du court, le « sifflement liquide » des balles déformées par la vitesse. « Si vous n’avez jamais regardé de tennis qu’à la télévision, vous n’avez simplement aucune idée de la rapidité à laquelle se déroulent les échanges, de la force avec laquelle les joueurs professionnels frappent la balle, du peu de temps dont ils disposent, de leur capacité à se déplacer, à se retourner, à se rétablir. Et personne n’est plus rapide, personne ne donne une aussi trompeuse impression de facilité que Roger Federer. »
Dans cet affrontement historique entre Federer et Nadal, qui offre un si frappant contraste entre les styles de jeu et les personnages, « Apollon et Dionysos », la préférence de Wallace va à la virtuosité élégante du Suisse. « La beauté n’est pas le but d’une compétition sportive, mais le sport de haut-niveau fournit un cadre propice à l’expression de la beauté humaine. Les deux entretiennent à peu près la même relation que le courage à la guerre », note Wallace. Cette beauté dont Wallace parle ici est d’un type particulier, qui n’a rien à voir avec le sexe ou les normes culturelles : « Ce à quoi elle s’attache vraiment, c’est à réconcilier l’être humain avec le fait de posséder un corps. » Notre pauvre corps, soumis aux afflictions, aux infections, aux douleurs, aux maladies. Et même quand le corps ne souffre pas, ne meurt pas, il y a encore la maladresse, le vertige, la pesanteur pour nous rappeler « chaque petit schisme entre nos désirs et nos capacités réelles. »
C’est alors que survient un de ces êtres d’exception pour qui les lois de la physique semblent, sinon suspendues, du moins assouplies : « Michael Jordan, capable non seulement de sauter à des hauteurs inhumaines mais de s’y maintenir un ou deux temps de plus que la gravité ne le permet, ou Muhammad Ali qui pouvait réellement « flotter » au-dessus du ring et envoyer deux ou trois crochets dans le temps imparti pour un seul. » Federer est de ceux-là. Pour lui, le court paraît plus petit, la balle semble coopérer, ralentir à son approche, comme soumise à sa volonté.
Wallace décrit longuement plusieurs échanges remarquables de Federer, contre Nadal ou Agassi, de ceux dont la conclusion laisse le spectateur « bouche bée, ébahi » : « Je ne sais pas quels sons j’ai émis, mais mon épouse m’a dit qu’elle s’était précipitée dans la pièce et qu’il y avait du popcorn partout sur le canapé, j’avais un genou à terre, et mes yeux ressemblaient à ceux d’un personnage de dessin animé. » Il est amusant de noter, en regardant à nouveau le match en question, que l’on ne retrouve pas ce long échange que Wallace décrit coup par coup. Il y en a plusieurs autres durant la partie qui lui ressemblent, mais le point – littéralement fabuleux – de Wallace n’existe pas… Privilège du sport, disait Antoine Blondin, de « composer des monuments somptueux et fugitifs qui s’absorbent d’eux-mêmes sans laisser de traces ailleurs que dans les yeux et les esprits de ceux qui les ont accueillis. » Ce mensonge de la mémoire est fidélité à la perfection du rêve, celui du spectateur, « reflet des mirages qui récompensent les athlètes exténués » (Giono). La vérité du souvenir de Wallace, c’est la sensation d’avoir assisté à l’extraordinaire, au renversement du cours naturel des choses, à un franchissement par procuration des limites acceptées. « Les athlètes font des choses dont nous nous contentons de rêver. Mais ces rêves sont importants – ils nous consolent. »
Au milieu de ce match de titans, Wallace repense soudain au garçon qui a donné le coup d’envoi honorifique de la rencontre : William Caines, un blondinet de sept ans qui a survécu à une tumeur maligne du foie, invité par les organisateurs du tournoi pour promouvoir la fondation Cancer Research UK. Tandis que l’on raccompagne le jeune garçon et que les champions se préparent, « des applaudissements se font entendre, mais éparpillés, désorganisés, remarque Wallace. La majorité du public n’arrive pas vraiment à décider quoi faire. C’est comme si, une fois le rituel accompli, la raison de la présence de ce garçon se faisait réellement admettre ». Wallace se force à imaginer : ce petit enfant, la chimiothérapie, « sa mère obligée d’y assister, de raccompagner son fils à la maison, de prendre soin de lui, puis de le ramener à l’hôpital pour une nouvelle séance. Que pouvait-elle répondre aux questions de son enfant – à la grande, l’incontournable question ? Et qui pouvait répondre aux siennes ? Qu’est-ce qu’un prêtre pouvait bien dire qui ne fût pas grotesque ? »
Troublé par la rencontre entre ces deux extrêmes des possibilités humaines, l’athlète miraculeux et l’enfant martyrisé, Wallace se rappelle le chauffeur de bus qui lui avait prédit une « expérience quasi-religieuse » à voir jouer Federer. Hyperbole enflammée, avait pensé l’écrivain, emphase de supporter. Pourtant, dans cette « cathédrale du tennis », Wallace est soudain pénétré du sentiment « du grand privilège d’être vivant » et d’assister à cette rencontre de légende. Sur le Central, Federer déjoue la fureur musculeuse de Nadal par ses mouvements « plus gracieux qu’athlétiques » ; dans la tenue blanche immaculée que Wimbledon impose aux joueurs, il ressemble à une créature dont le « corps serait en même temps chair et, en quelque sorte, lumière ».
Wallace se refuse à exagérer, ni même à prétendre qu’on y trouverait une sorte de compensation équitable. « Mais la vérité c’est que, quelque soit la divinité, l’entité, l’énergie ou la loterie génétique capable d’engendrer des enfants malades, c’est elle aussi qui a produit Roger Federer. Et regardez-le, là, sur le court. Regardez ça. »
Douze années se sont écoulées depuis ce texte et depuis cette finale. D’un point de vue tennistique, par certains aspects, rien ne semble avoir changé. Aussi improbable que cela paraisse, Roger Federer est toujours là. En 2019, à 38 ans, Federer est à Wimbledon pour la 21ème fois, et toujours dans la peau d’un favori, toujours aussi vif, aussi leste. Ses nouveaux adversaires ont l’âge d’être ses fils, mais le temps ne semble pas avoir plus de prise sur lui que la matière. Profitez-en, regardez-le : cela finira un jour. Nadal aussi est toujours là. Borg est souvent dans les tribunes pour voir ses records tomber les uns après les autres. Le seul absent, c’est David Foster Wallace, qui s’est suicidé en septembre 2008. Il m’arrive de penser à lui, au milieu du match le plus disputé, comme il pensait au petit William Caines, pour me rappeler que « les meilleurs athlètes parviennent à catalyser notre conscience du bonheur qu’il y a à toucher et à percevoir, à se mouvoir dans l’espace, à interagir avec la matière ». Quant à nous consoler de nos limites… « La consolation », regrettait Stig Dagerman, « ne dure que le temps d’un souffle de vent dans la cime d’un arbre » ; deux rebonds d’une balle sur le gazon.
Sébastien Banse
[1] Ce long article a ensuite été repris, avec tous les autres écrits de David Foster Wallace sur le tennis, dans un volume, String Theory, édité par la Library of America.
Share this...

