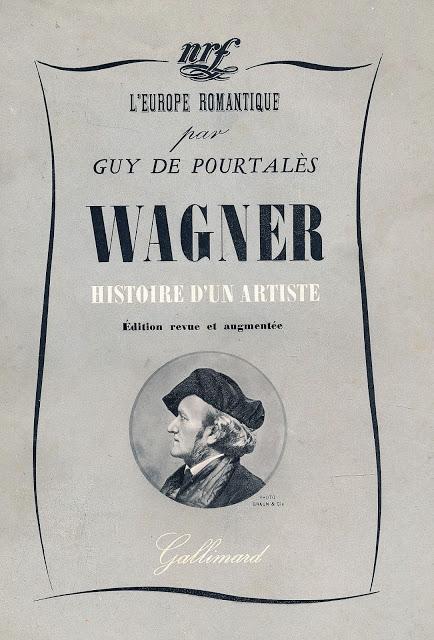
La Critique des Livres
« WAGNER, HISTOIRE D'UN ARTISTE », un article de Léon Daudet dans le Candide du 27 octobre 1932
M. Guy de Pourtalès est un puissant critique, et qui s'attaque avec bonheur aux grands sujets. Son Wagner, tout récemment paru, est sans aucun doute ce qu'on a écrit de plus pénétrant et de plus complet sur le génie dramatique et musical qui personnifie, avec Gœthe et Nietzsche, l'art allemand contemporain. Car Gœthe, on vient de s'en apercevoir pour le centenaire de sa mort (1832), est étrangement contemporain. De nombreux travaux ont été publiés sur la vie et l'œuvre de Richard Wagner. Des correspondances importantes du maître et de ses amis ont vu le jour. Lui-même a écrit le récit de sa vie tourmentée. M de Pourtalès fait la somme de ce que nous savons, en éliminant le secondaire. C'est ce qui fait, avec la sobriété des interprétations, le prix de cette excellente biographie. Wagner, c'est comme son Wotan, le voyageur (der Wanderer), le vagabond. Il l'est en amour, il l'est en séjours et résidences, il l'est en pensée. Mais, comme tout ce qu'Ovide tentait d'écrire était poésie, tout ce que Wagner ressent est musique et aboutit à la symphonie... Modulant tour à tour, sur la lyre d'Orphée, Les soupirs de la sainte et les cris de la fée.
L'amour de la femme, le plus violent, le plus ardent, le plus sensuel a fait vibrer, comme chez Gœthe — M. de Pourtalès le note bien — son âme en perpétuel tressaillement sonore. Cela du début de son existence à la fin. Nous avons sa confession complète à ce sujet dans son œuvre la plus parfaite, la plus bouleversante et dont on peut être assuré, dès maintenant, qu'elle ne vieillira jamais, Tristan et Yseult. À l'expansion totale de sa passion amoureuse, une des plus frénétiques que Dionysos ait connues, submergeante comme la mer aux bruits sans nombre, à laquelle elle est associée, il fallait l'obstacle et l'absence. Mathilde Wesendonk, mariée jeune à un brave commerçant en étoffes, lui apporta ces deux thèmes essentiels, vers le milieu de son âge, comme Frédérique Brion les avait apportés à Gœthe dans sa jeunesse.
Ma génération — celle qui avait vingt ans aux alentours de 1890 — a été, à la Faculté de médecine, comme à la Faculté des lettres, réellement envoûtée par Wagner. Nous admirions non seulement sa musique, mais ses thèmes, ses livrets, ses géants, ses nains, ses ondines, bref ce que j'appellerai aujourd'hui, irrespectueusement, sa ferblanterie. Ses « leitmotiv » — motifs d'accompagnement — répétés par lui à satiété et qui, aujourd'hui, fatiguent un peu, nous enchantaient. Il ajoutait, à nos plaisirs sensoriels, celui d'une science spéciale, d'une « niebelungologie ». Aucune difficulté ne nous arrêtait et le « fou pur », le « par pitié sachant », les symboles du Rhin, de son or, du Walhalla, des Filles Fleurs, les énigmes psychologiques de Brünehilde, de Sieglinde, de Koundry, nous semblaient avoir la clarté de l'eau de roche. Nous classions intellectuellement nos camarades en admirateurs de Wagner — c'est-à-dire intelligents — et contempteurs de Wagner, c'est-à-dire idiots. Certaines salles de garde retentissaient des airs les plus célèbres de notre héros. C'est un fait que la wagnéromanie déclinante fut presque aussitôt remplacée par la nietzschomanie et que Zarathoustra supplanta Parsifal, mais avec un moindre rayonnement. M. de Pourtalès nous a montré les femmes de Wagner, tout au moins les principales : Minna, Mathilde, Cosima, Judith. Il a passé légèrement sur Jessie, et il a eu raison, car elle n'est qu'un épisode sans importance. Il n'a pas dissimulé les tares de ce génie, son manque de scrupules et de sens de l'honneur, en matière amoureuse comme en matière d'argent (Wagner empruntait au brave Wesendonk, tout en courtisant vigoureusement madame son épouse) ses bizarreries et ses foucades, ses enfantillages. Il a marqué, d'un trait peut-être un peu flou, le tournant de 1870, le moment où l'ethnicité germanique s'éveille chez Wagner sous le choc de la victoire allemande, où il vise au rôle de prophète en son pays, de rassembleur d'annales, la phase de « Bayreuth, colline sacrée ». Il a dépeint de main de maître l'amitié avec Liszt, celle instable, avec Hans de Bülow et Nietzsche, celle avec Louis II de Bavière, mécène et maboul. Mais la grande influence sur le malléable auteur de la Tétralogie et de Tristan fut exercée par Schopenhauer, je veux dire par son grand ouvrage, Le monde comme volonté et représentation. C'est là que Wagner a puisé ce que nous appelions sa philosophie, c'est-à-dire son idéologie. Je pense que son admiration entêtée pour Schopenhauer, dont la morbidité intime correspondait à la sienne, fut cause de sa rupture avec Nietzsche, tyran né de la pensée d'autrui et qui n'admettait point de n'être pas suivi dans ses conceptions nébuleuses. C'était un crime, aux yeux de Zarathoustra, que de concevoir autrement que lui la naissance de la tragédie, ou d'émettre des doutes sur le retour éternel. Ce prétendu destructeur d'idoles faisait des idoles de ses aphorismes. En outre, Nietzsche était misogyne, — on ne cite de lui qu'une assez pitoyable aventure intellectuelle avec la petite Lou Salomé — au lieu que le mari de Minna, puis de Cosima, était toujours sur le gril d'Eros, toujours ouvert aux fugues des sens et aux caprices des sentiments. Entre deux hommes de complexion si différente, l'antagonisme était commandé par la rencontre, et l'antipathie était fatale, sous le masque trompeur de la sympathie désordonnée. Puisque j'ai parlé de morbidité, il faut bien reconnaître que ce deuxième milieu romantique allemand, fondé sur la musique et les correspondances entre les sentiments et les sons, comme le premier l'avait été sur la poésie et les correspondances entre les sentiments et les mots, que cette second nuit de Walpurgis, dis-je, n'est pas plus saine que la première. Elles se rejoignent par Heine, Schopenhauer et Schumann, c'est-à-dire, mêlées à l'originalité géniale, par l'amertume, l'appétit du néant et la neurasthénie aiguë. Tout l'épisode des relations esthético-sentimentales de Louis Il de Bavière — Hamlet-Roi, comme dit, dans un autre livre, remarquable lui aussi, M. de Pourtalès — et de Wagner criblé de dettes, désemparé, à la recherche d'un commanditaire, appartient à un genre de baroque que, pour ma part, j'estime repoussant. Car il est trop clair que le grand musicien-dramaturge, en quête d'un théâtre et d'une subvention, ne se prête à ces exaltations et à ce jargon de la psychopathia sexualis que pour ses commodités personnelles et celles de son art. Ce mécénat de sanatorium est hideux, et quand je pense à Wagner et à son incontestable puissance créatrice, je préfère l'oublier. Dans ma jeunesse il en était autrement et mon premier essai littéraire fut un dialogue imaginaire entre le roi et son médecin, quelques minutes avant la noyade de celui-ci. Quelques années plus tard, Bainville débutait, tout jeune, dans les lettres, par un Louis de Bavière étincelant. Hamlet-Roi, pendant dix années, avait frappé les imaginations des jeunes Français. Le changement de place, l'exil, la fugue morale et physique, intellectuelle aussi, animaient la nature instable de Wagner. La Suisse, Paris, Venise, Naples l'attirèrent. le second à plusieurs reprises et dans des circonstances trop connues pour qu'il soit nécessaire d'y insister. Il a fait à Paris de longs séjours, dans une gêne frisant parfois la misère ; il y a eu de réels succès, puis un four illustre entre les fours et parfaitement immérité, celui de Tannhaeuser, qui lui valut, néanmoins un splendide article de Baudelaire, que l'on ne savait pas alors être notre plus grand critique d'art, pour la musique comme pour la peinture. M. de Pourtalès raconte alertement cette soirée fameuse qui brouilla, pour de longues années, Wagner avec Paris .
La véritable intronisation de la gloire wagnérienne à Paris fut, une dizaine d'années après la mort de l'auteur de la Tétralogie, en 1892, à moins que ce ne soit en 1893, la première représentation, à l'Opéra, de la Walkyrie, avec Mlle Lucienne Bréval dans le rôle de Brünehilde. La beauté plastique de la jeune interprète, le cristal doré de sa voix, la justesse de ses mouvements rendirent humaine et accessible à la sensibilité française cette légende un peu bien nordique. Telle est la puissance de l'interprète. Assis à côté l'un de l'autre, nous échangions nos impressions, Maurice Barrès et moi : « Quel dommage que Wagner n'ait pas vu cela ! » Car Barrès aussi admirait le drame wagnérien. Quelque temps après, Mlle Bréval incarnait, avec un égal bonheur, dans un style tout différent, mais aussi beau, la railleuse Eva des Maîtres chanteurs. De sorte que, pour les hommes de mon âge, — comme on dit dans le Midi — le souvenir du génie wagnérien est intimement lié à celui de cette grande artiste, en qui le premier critique musical de notre temps et du Temps, Pierre Lalo, saluait aussi la dépositaire de cette « mélancolie héroïque » qui court sous la Tétralogie, comme sous Tristan. Dans une vie de cette ampleur et de ces rumeurs, ce qui parachève la figure terrestre et l'œuvre géante, ce sont les dernières années et la mort. Finis coronat opus. Wagner vit et conduisit la réalisation de Parsifal, où flotte, sous les traits de Kundry, l'image de la belle Française, Judith Gautier, alors épouse de Catulle Mendès. Son âme bruissante et tourmentée, symphonie de tous les possibles, accordée à toutes les joies comme à toutes les douleurs de la volupté, quitta son corps au palais Vendramin à Venise, sous les regards en larmes de Cosima. Il est impossible d'oublier ici la page déchirante écrite par Gabriele d'Annunzio dans le Feu. Elle a la cruelle douceur du chant du pâtre, alors que Tristan haletant attend « la nef ». On voit courir le flambeau de Lucrèce — vitaï lampada. (1)
Léon DAUDET, de l'académie Goncourt.
Post précédent sur Léon Daudet : Vu de France : Wagner au regard de Léon Daudet
(1) Et quasi cursores, vitaï lampada tradunt (Et comme les coureurs, ils se passent le flambeau de la vie.) LUCRÈCE, liv. II, vers 79. Pour exprimer que les générations humaines se transmettent, comme les coureurs antiques, le flambeau de la vie

