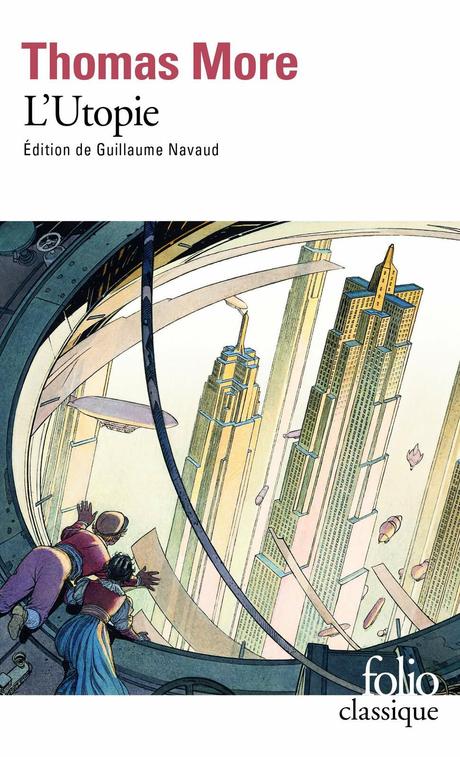
L'été est toujours pour moi une période d', surtout après cette année extrêmement chargée en matière de recherche universitaire. J'en profite donc pour m'aventurer sur d'autres chemins intellectuels. En particulier, je suis en train de préparer un cours d'histoire de la pensée économique et suis retombé sur une grande œuvre de Thomas More parue en 1516, que j'avais lue quelques années auparavant : Utopie. Construit sur le modèle des Dialogues de Platon, on y trouve une critique puissante des enclosures et plus généralement du système économique de son temps, puis une description d'une société idéale ( Utopie) fondée hors de l'ordre marchand et sur la propriété collective des moyens de production. Dans ce billet, je vous propose donc de nous intéresser au mouvement des enclosures sur la base de quelques extraits de l'œuvre de Thomas More (les pages citées font référence à l'édition de 1842 traduite du latin par Victor Stouvenel).
Comme de nombreux érudits de son époque, Thomas More (1478-1535) fut tout à la fois juriste, philosophe, théologien et même homme politique en Angleterre. Il est l'un des plus illustres représentants de l'humanisme anglais, mouvement d'idées de la Renaissance que le dictionnaire de l'Académie française définit comme " la redécouverte de la pensée antique et l'examen critique des textes grecs et latins". Son passage comme chancelier du roi Henri VIII lui vaudra bien des déboires, qui sont décrits de manière romancée dans un très beau film de 1966 avec Orson Welles : A Man for All Seasons. Il est vrai que sa mort par décapitation et sa béatification trois siècles plus tard ne pouvaient qu'inspirer le cinéma...
Voici ce qu'écrit Thomas More au sujet des enclosures, de l'oisiveté, des voleurs, de la misère, etc. qui, je l'espère, vous donnera envie de lire l'œuvre en entier.
" Le hasard me fit rencontrer un jour, à la table de ce prélat, un laïque réputé très savant légiste. Cet homme, je ne sais à quel propos, se mit à combler de louanges la justice rigoureuse exercée contre les voleurs. Il racontait avec complaisance comment on les pendait çà et là par vingtaine au même gibet. Néanmoins, ajoutait-il, voyez quelle fatalité ! à peine si deux ou trois de ces brigands échappent à la potence, et l'Angleterre en fourmille de toutes parts.
Je dis alors, avec la liberté de parole que j'avais chez le cardinal :
- Cela n'a rien qui doive vous surprendre. Dans ce cas, la mort est une peine injuste et inutile ; elle est trop cruelle pour punir le vol, trop faible pour l'empêcher. Le simple vol ne mérite pas la potence, et le plus horrible supplice n'empêchera pas de voler celui qui n'a que ce moyen de ne pas mourir de faim. En cela, la justice d'Angleterre et de bien d'autres pays ressemble à ces mauvais maîtres qui battent leurs écoliers plutôt que de les instruire. Vous faites souffrir aux voleurs des tourments affreux ; ne vaudrait-il pas mieux assurer l'existence à tous les membres de la société, afin que personne ne se trouvât dans la nécessité de voler d'abord et de périr après ?
- La société y a pourvu, répliqua mon légiste ; l'industrie, l'agriculture, offrent au peuple une foule de moyens d'existence ; mais il y a des êtres qui préfèrent le crime au travail.
- C'est là où je vous attendais, répondis-je. Je ne parlerai pas de ceux qui reviennent des guerres civiles ou étrangères, le corps mutilé de blessures. Cependant combien de soldats, à la bataille de Cornouailles ou à la campagne de France, perdirent un ou plusieurs membres au service du roi et de la patrie ! Ces malheureux étaient devenus trop faibles pour exercer leur ancien métier, trop vieux pour en apprendre un nouveau. Mais laissons cela, les guerres ne se rallument qu'à de longs intervalles. Jetons les yeux sur ce qui se passe chaque jour autour de nous.
La principale cause de la misère publique, c'est le nombre excessif des nobles, frelons oisifs qui se nourrissent de la sueur et du travail d'autrui, et qui font cultiver leurs terres, en rasant leurs fermiers jusqu'au vif, pour augmenter leurs revenus ; ils ne connaissent pas d'autre économie. S'agit-il, au contraire, d'acheter un plaisir ? ils sont prodigues jusqu'à la folie et la mendicité. Ce qui n'est pas moins funeste, c'est qu'ils traînent à leur suite des troupeaux de valets fainéants, sans états et incapables de gagner leur vie.
Ces valets tombent-ils malades ou bien leur maître vient-il à mourir, on les met à la porte ; car on aime mieux les nourrir à ne rien faire que les nourrir malades, et souvent l'héritier du défunt n'est pas de suite en état d'entretenir la domesticité paternelle.
Voilà des gens exposés à mourir de faim, s'ils n'ont pas le cœur de voler. Ont-ils, en effet, d'autres ressources ? Tout en cherchant des places, ils usent leur santé et leurs habits ; et quand ils deviennent pâles de maladie et couverts de haillons, les nobles en ont horreur et dédaignent leurs services. Les paysans mêmes ne veulent pas les employer. Ils savent qu'un homme élevé mollement dans l'oisiveté et les délices, habitué à porter le cimeterre et le bouclier, à regarder fièrement le voisinage et à mépriser tout le monde ; ils savent qu'un tel homme est peu propre à manier la bêche et le hoyau, à travailler fidèlement, pour un mince salaire et une faible nourriture, au service d'un pauvre laboureur.
Là-dessus mon antagoniste répondit :
- C'est précisément cette classe d'hommes que l'État doit entretenir et multiplier avec le plus de soin. Il y a chez eux plus de courage et d'élévation dans l'âme que chez l'artisan et le laboureur. Ils sont plus grands et plus robustes ; et partant, ils constituent la force d'une armée, quand il s'agit de livrer bataille.
- Autant vaudrait dire, répliquai-je alors, qu'il faut, pour la gloire et le succès de vos armes, multiplier les voleurs. Car ces fainéants en sont une pépinière inépuisable. Et, de fait, les voleurs ne sont pas les plus mauvais soldats, et les soldats ne sont pas les plus timides voleurs ; il y a beaucoup d'analogie entre ces deux métiers. Malheureusement, cette plaie sociale n'est pas particulière à l'Angleterre ; elle ronge presque toutes les nations.
" De quelque manière que j'envisage la question, cette foule immense de gens oisifs me paraît inutile au pays, même dans l'hypothèse d'une guerre, que vous pourrez au reste éviter toutes les fois que vous le voudrez. Elle est, en outre, le fléau de la paix ; et la paix vaut bien qu'on s'occupe d'elle autant que de la guerre. La noblesse et la valetaille ne sont pas les seules causes des brigandages qui vous désolent ; il en est une autre exclusivement particulière à votre île.
- Et quelle est-elle ? dit le cardinal.
- Les troupeaux innombrables de moutons qui couvrent aujourd'hui toute l'Angleterre. Ces bêtes, si douces, si sobres partout ailleurs, sont chez vous tellement voraces et féroces qu'elles mangent même les hommes, et dépeuplent les campagnes, les maisons et les villages.
En effet, sur tous les points du royaume, où l'on recueille la laine la plus fine et la plus précieuse, accourent, pour se disputer le terrain, les nobles, les riches, et même de très saints abbés. Ces pauvres gens n'ont pas assez de leurs rentes, de leurs bénéfices, des revenus de leurs terres ; ils ne sont pas contents de vivre au sein de l'oisiveté et des plaisirs, à charge au public et sans profit pour l'État. Ils enlèvent de vastes terrains à la culture, les convertissent en pâturages, abattent les maisons, les villages, et n'y laissent que le temple, pour servir d'étable à leurs moutons. Ils changent en déserts les lieux les plus habités et les mieux cultivés. Ils craignent sans doute qu'il n'y ait pas assez de parcs et de forêts, et que le sol ne manque aux animaux sauvages.
Ainsi un avare affamé enferme des milliers d'arpents dans un même enclos ; et d'honnêtes cultivateurs sont chassés de leurs maisons, les uns par la fraude, les autres par la violence, les plus heureux par une suite de vexations et de tracasseries qui les forcent à vendre leurs propriétés. Et ces familles plus nombreuses que riches (car l'agriculture a besoin de beaucoup de bras), émigrent à travers les campagnes, maris et femmes, veuves et orphelins, pères et mères avec de petits enfants. Les malheureux fuient en pleurant le toit qui les a vus naître, le sol qui les a nourris, et ils ne trouvent pas où se réfugier. Alors, ils vendent à vil prix ce qu'ils ont pu emporter de leurs effets, marchandise dont la valeur est déjà bien peu de chose. Cette faible ressource épuisée, que leur reste-t-il ? Le vol, et puis la pendaison dans les formes.
Aiment-ils mieux traîner leur misère en mendiant ? on ne tarde pas à les jeter en prison comme vagabonds et gens sans aveu. Cependant, quel est leur crime ? C'est de ne trouver personne qui veuille accepter leurs services, quoiqu'ils les offrent avec le plus vif empressement. Et d'ailleurs, comment les employer ? Ils ne savent que travailler à la terre ; il n'y a donc rien à faire pour eux, là où il n'y a plus ni semailles ni moissons. Un seul pâtre ou vacher suffit maintenant à faire brouter cette terre, dont la culture exigeait autrefois des centaines de bras.
Un autre effet de ce fatal système, c'est une grande cherté de vivres, sur plusieurs points. Mais ce n'est pas tout. Depuis la multiplication des pâturages, une affreuse épizootie est venue tuer une immense quantité de moutons. Il semble que Dieu voulait punir l'avarice insatiable de vos accapareurs par cette hideuse mortalité, qu'il eût plus justement lancée sur leurs têtes. Alors, le prix des laines est monté si haut, que les plus pauvres des ouvriers drapiers ne peuvent pas maintenant en acheter. Et voilà encore une foule de gens sans ouvrage. Il est vrai que le nombre des moutons s'accroît rapidement tous les jours ; mais le prix n'en a pas baissé pour cela ; parce que si le commerce des laines n'est pas un monopole légal, il est en réalité concentré dans les mains de quelques riches accapareurs, que rien ne presse de vendre et qui ne vendent qu'à de gros bénéfices".
Que de leçons à méditer !
P.S. L'image de ce billet correspond à l'édition Folio Classique de 2012.

