Article paru dans La Presse Littéraire, n° 14, mars-avril-mai 2008
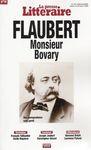 Je suis tout à fait prêt à admettre que je ne suis pas un bon lecteur : il peut m’arriver de passer à côté de certaines œuvres. Et c’est peut-être le cas ici, avec ce récit autobiographique de Joan Didion récemment couronné par le Médicis, qui suscite un engouement d’une unanimité que je m’explique mal. Sauf à ce qu’on accepte d’en considérer les possibles mauvaises raisons : le statut de son auteur (dont on lit un peu partout qu’elle est une icône et un quasi-mythe vivant), son âge (soixante-quatorze ans), son sujet (l’épreuve du deuil), et surtout sa douleur, consécutive à la double disparition de son mari, le scénariste, chroniqueur et romancier John Gregory Dunne, et de leur fille Quintana, trente-neuf ans. Autant de raisons qui n’ont donc pas grand-chose à voir avec la littérature, mais qui, par l’effet bien compris d’une élémentaire pudeur, peuvent inviter à la retenue, voire à une certaine bonté. Disant cela, je ne dis pas que L’année de la pensée magique est un mauvais livre – ce serait un peu exagéré. Je suggère seulement que la critique a pu baisser sa garde devant un sujet et un auteur dont, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, donc, on n’ose peut-être pas entreprendre l’exégèse critique. Il faudrait d’ailleurs se demander si cette réserve ne pourrait pas s’appliquer aux tendances actuelles d’une critique qui n’a plus parfois de littéraire que son désir de passer pour telle, obnubilée qu’elle est par le contexte des livres et ne parvenant alors qu’à rôder autour.
Je suis tout à fait prêt à admettre que je ne suis pas un bon lecteur : il peut m’arriver de passer à côté de certaines œuvres. Et c’est peut-être le cas ici, avec ce récit autobiographique de Joan Didion récemment couronné par le Médicis, qui suscite un engouement d’une unanimité que je m’explique mal. Sauf à ce qu’on accepte d’en considérer les possibles mauvaises raisons : le statut de son auteur (dont on lit un peu partout qu’elle est une icône et un quasi-mythe vivant), son âge (soixante-quatorze ans), son sujet (l’épreuve du deuil), et surtout sa douleur, consécutive à la double disparition de son mari, le scénariste, chroniqueur et romancier John Gregory Dunne, et de leur fille Quintana, trente-neuf ans. Autant de raisons qui n’ont donc pas grand-chose à voir avec la littérature, mais qui, par l’effet bien compris d’une élémentaire pudeur, peuvent inviter à la retenue, voire à une certaine bonté. Disant cela, je ne dis pas que L’année de la pensée magique est un mauvais livre – ce serait un peu exagéré. Je suggère seulement que la critique a pu baisser sa garde devant un sujet et un auteur dont, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, donc, on n’ose peut-être pas entreprendre l’exégèse critique. Il faudrait d’ailleurs se demander si cette réserve ne pourrait pas s’appliquer aux tendances actuelles d’une critique qui n’a plus parfois de littéraire que son désir de passer pour telle, obnubilée qu’elle est par le contexte des livres et ne parvenant alors qu’à rôder autour.Rappelons donc en quelques mots qui est Joan Didion. Née à Sacramento en 1934 dans une famille d’origine alsacienne, fille d’un officier de l’armée de l’air, la jeune Joan fréquente les campus universitaires, notamment Berkeley, et commence comme journaliste au magazine Vogue. Pionnière de ce qu’on a pu appeler le « nouveau journalisme », elle publie un grand nombre d’enquêtes sur l’Amérique des sixties et des seventies, enquêtes qui font aujourd’hui référence. Des auteurs aussi réputés que Donna Tartt, Bret Easton Ellis ou Jay McInerney clament à qui veut l’entendre leur dette à son endroit. Et indiscutablement, elle a longtemps été en pointe dans le travail de sismographie de la modernité américaine, déstructurant au passage le mythe d’une Amérique californienne, vertueuse, moderne, paradisiaque et prophétique. Ce qui est annoncé comme son chef-d’œuvre romanesque, Maria avec et sans rien, publié en 1970, est traduit pour la première fois en France et paraît concomitamment à ce récit.
A certains égards, ce dernier est d’ailleurs touchant. Mais les qualités couramment décrites à propos du travail d’écriture de Joan Didion (concision, précision, distanciation, rejet des fioritures…) peuvent être ici diversement appréciées. Certes, il n’est pas anodin de lire le récit de cette femme déjà âgée dont le compagnon de vie meurt « le 30 décembre 2003, à neuf heures du soir », d’une attaque coronarienne « à la table de la salle à manger de notre appartement de New York. » On dira peut-être que la narration, très clinique, obéit à une des dimensions du travail du deuil, et à la volonté, consciente ou pas, de mettre à distance tout ce qui pourrait empêcher la vie de reprendre, non son cours normal, mais disons un certain cours. Mais ce qui est indiscutable d’un point de vue intime peut ne pas l’être dès lors qu’il s’agit de littérature. Autrement dit, on croit accéder à une certaine vérité factuelle et affective en retraçant de manière directe faits et affects, en en décrivant les conséquences immédiates sur sa propre psyché et en les contextualisant. Mais la contextualisation prend ici infiniment trop de place. Annoncé comme un grand livre sur le deuil, L’année de la pensée magique est bien trop ancré dans la réalité américaine contemporaine pour faire œuvre universelle. Ce que Joan Didion décrit, avec des mots dont on comprend qu’elle aime leur simplicité en ce qu’elle est censée renvoyer à l’immédiateté directe du deuil et de la douleur, relève davantage de sa relation aux obstacles qu’elle rencontre pour réinventer un quotidien sans l’autre, voire d’une sociologie du deuil, que de l’exploration de ladite douleur. Moyennant quoi, ce récit m’a franchement ennuyé. C’est dommage, parce que rien peut-être n’est aussi saisissant que le témoignage des menus instants de la vie lorsque celle-ci se trouve traumatisée de fond en comble, lorsque plus aucun geste ne trouve sa signification dès lors qu’il est réalisé sans l’autre – rédiger un chèque en son nom propre puisque celui du mari défunt ne doit plus apparaître « que sur les comptes de tutelle », acheter toujours « le même jambon chez Citarella », s’inquiéter du « nombre d’assiettes dont je vais avoir besoin pour le réveillon », se rendre au « rendez-vous annuel de décembre chez le dentiste » et finir par aller déjeuner, seule, « chez 3 Guys, sur Madison Avenue. » L’écriture est souvent molle, fade, mécanique, et à trop vouloir essuyer ce qui suinte, elle dit la souffrance comme une chose extérieure plutôt que comme une sensation des profondeurs. Pour ne rien dire de ce côté gorgée de bière delermienne, sans doute plus esthétique et moins nécessaire qu’il y paraît, dont je vois bien, ici ou là, qu’il soulève l’émotion, mais qui ne parvint qu’à assécher ma lecture et, ce qui est plus gênant encore, à me donner le sentiment d’une approche simplement fonctionnaliste du travail de deuil. Tout comme me gêne le nombre d’occurrences où Joan Didion cite les marques commerciales qu’elle affectionne, sans que l’on en comprenne jamais l’intérêt (sauf à décrire un mode de vie bourgeois), et dont on se dit au contraire que cela interdit toute immersion dans ce qu’un tel récit pourrait avoir d’irréductible. Aussi, dès la deuxième ligne de la première page de ce livre sur une intimité déchirée, ai-je été mal à l’aise de lire : « Le document Microsoft Word ("Notes sur changement.doc ») est daté du "20 mai 2004, 13h11", mais sans doute l’ai-je simplement ouvert ce jour-là puis sauvegardé par réflexe avant de le refermer. » Tout au long du récit, nous pourrons donc apprendre qu’elle possède « un peignoir élimé en tissu éponge, taille XL, acheté dans les années 1970 chez Richard Caroll à Bervely Hills », qu’elle se souvient d’un « T-shirt "Canyon Ranch" », qu’elle remplit des sacs de rangement de « baskets New Balance » ou de « caleçons de chez Brooks Brothers », qu’elle se rappelle l’année 1968, quand son mari la rejoignit pour « dîner ensemble, chez Ernie’s », avant qu’il prît « le vol de minuit de la compagnie PSA (Pacific Southwest Airlines), pour treize dollars » (et de préciser que « c’était l’époque, en Californie, où l’on pouvait faire Los Angeles-San Francisco ou Sacramento-San José pour vingt-six dollars l’aller-retour »), qu’elle portait, le jour de son mariage en 1964, « une robe courte en soie blanche que j’avais achetée chez Ransohoff’s à San Francisco le jour de l’assassinat de John Kennedy. » La liste (des commissions…) est longue.
Je me moque un peu, mais le récit ne parvient que rarement à s’oxygéner de cet envahissement par la situation sociologique, et donc d’une superficialité dommageable à un récit qui, s’il l’on conçoit qu’il ait pu ne pas vouloir user d’une formulation dramatique, n’en est pas moins né d’une tragédie personnelle. Cette impression de superficialité trouve encore à s’incarner dans cette manière un peu systématique de conclure chaque chapitre par une note qui, elle, tend à bouleverser le lecteur – grâce à un sens de l’ellipse affective qui, pour le coup, s’avère le plus souvent réussie. Toutefois, ces chutes viennent toujours en résolution d’un empilement de paragraphes cliniques, et l’on ne peut, là non plus, s’empêcher d’y voir un simple truc d’écrivain – la répétition dudit truc finissant par anéantir l’impression de bonne surprise. On entrerait pourtant volontiers dans les méandres de cette pensée qui cherche à s’enquérir d’elle-même pour survivre, et le livre réussit d’ailleurs à dire ce que subit un esprit vivant en butte à la rationalité, ou simplement en quête d’une verbalisation qui soit moins chaotique. C’est ici que Joan Didion touche juste : l’écriture, parce qu’on sent, malgré tout, ce qui la meut, ne devient belle que lorsqu’elle est hésitante. C’est vrai notamment de ce qui fait peut-être l’intérêt du livre : la réflexion rétrospective sur d’éventuels signes avant-coureurs de la mort. Cela ne suffit pas, hélas, et ce qui aurait pu constituer un récit renouvelé de l’approche du deuil ne dépasse en fait que très rarement le stade du simple témoignage.
