Les films de guerre, surtout dans les années 50, étaient rarement autre chose que l’occasion d’un éloge du courage des vainqueurs face à la force brutale ou retorse de l’ennemi. Ca pouvait aussi occasionnellement être un simple terrain de galéjade, une toile de fond de comédie. Rarement autre chose. En voyant au programme du satellite un film inconnu de 1958 rangé dans la catégorie « Film de Guerre », je ne me suis donc pas le moins du monde méfié, en me préparant à un spectacle classique, pénard dans mon sofa, bien à l’abri derrière la ligne Maginot des habitudes. Et badaboum. Qu’est-ce qui se passe ? C’est quoi cet ovni ? … Mais n’allons pas trop vite. D’abord un petit mot de l’histoire.
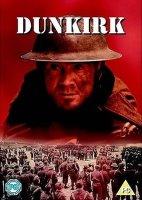
Affiche (posters.motechnet.com)
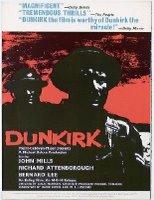
Parallèlement, en Angleterre, le désastre de l’armée prise au piège dans la ville assiégée mobilise l’attention. Une opération de sauvetage pour récupérer les troupes par la mer est organisée, mais tourne vite à la déroute sous le feu des avions allemands qui coulent plusieurs navires de la Navy à l’approche de la ville. Les quelques journalistes présents, en particulier un anglais, Charles Foreman (Bernard Lee), et un français, Jouvet (Michael Shillo), sont atterrés par la catastrophe). Une vaste campagne de réquisition de tout ce qui peut flotter, civil et militaire, est alors lancée pour porter secours aux soldats, à base de petits bateaux, moins accessibles aux bombes ennemies. Certains propriétaires de bateaux de plaisance se portent volontaires pour conduire leurs embarcations eux-mêmes plutôt que de les confier à l’armée, peu habituée à manoeuvrer ce genre de véhicules. Foreman, justement un des propriétaires d’embarcation, prend la tête de cet engagement comme supplétif. Un de ses voisins, John Holden (Richard Attenborough), lui-même propriétaire du Héron et sous la pression d’une épouse, Grace (Patricia Plunkett), paniquée et se refusant à imaginer son mari sous les drapeaux, renâcle davantage à la réquisition de son bateau. Il obtempère néanmoins et, une fois éloigné de Grace, finit par se joindre aux volontaire à la manœuvre de l’hétéroclite flottille.
Foreman et Holden, arrivant sur les lieux, sont bloqués quelques heures sur la plage de Dunkerque par une avarie de moteur et y partagent le sort des soldats, sous le feu ennemi. Ils observent les longues files d’hommes s’enfonçant dans la mer dans l’attente d’un navire à aborder. Ils écoutent, ils tentent de rassurer, ils se protègent des mêmes obus que leurs compagnons, ils contemplent le même horizon rougi des faubourgs en flamme de la ville, ils regardent les bâtiments de la Navy coulant avec leur cargaison de soldats à peine récupérés sur le sable. Ils se lient en particulier avec les hommes survivants du caporal Bins qui les aident à réparer le moteur du Héron. Jusqu’à l’heure où Holden pourra, seul, lever l’ancre et rapatrier son petit lot de rescapés sur les côtes anglaises.
En 1958, le réalisateur Leslie Norman en était encore à ses premières tentatives dans le cinéma. Tentatives qu’il allait bientôt abandonner pour une carrière à la télévision, avec la direction de multiples épisodes de séries mémorables comme « Le Saint », « Chapeau melon et bottes de cuir », « Amicalement votre », … Le pourquoi de ce revirement serait sans doute à creuser, et à regretter tant « Dunkerque » (« Dunkirk » pour la VO) est un film étonnant. Le pourquoi de l’oubli de cette réalisation serait sans doute également à questionner tellement le film semble avoir une place à part dans le paysage des films de guerre.
Le premier étonnement vient de l’histoire elle-même, ou du moins du choix du sujet, relatant la catastrophe nationale que fut la défaite de la bataille de Dunkerque. A-t-on tant d’autre exemple à l’époque de récits d’une défaite par les battus eux-mêmes, surtout si peu de temps après qu’elle soit survenue ? D’autant que le parti pris n’est pas ici de transformer la réalité, de la camoufler, de la travestir en une forme de victoire quelconque. Non, le choix est bien de montrer l’âpreté du sort de ces combattants quasiment livrés à eux-mêmes, les hésitations du commandement, les lenteurs des secours. Bien sûr, il y a une forme d’héroïsme dans l’intervention de ces civils venant au secours de leur armée, une forme de grandeur dans la révolte spontanée d’une partie de la population contre les lenteurs de la guerre officielle, une forme de bravoure sobre et émouvante dans ce choix de fourmi se portant au secours de l’éléphant paralysé. Mais il n’est pas pour autant question d’en faire une vertu unanimement partagée. Les petites lâchetés du quotidien restent présentes, les petits bouts de courage comme ceux de veulerie ou de couardise, tant chez les civils que chez les militaires.
Le second étonnement tient dans le choix de raconter cette histoire en deux parties parallèles, l’une sur place et l’autre au pays, ne fusionnant que dans la seconde partie du film. Comme deux volets fonctionnant en contrepoint, avec une économie de moyens inhabituelle pour un genre ordinairement plus spectaculaire. Toute l’épopée du groupe mené par le caporal Bins se déroule presque comme une partie de campagne. Il y a bien quelques épisodes de combats, mais décrits comme de l’extérieur, comme le ferait un journaliste présent sur les lieux mais qui ne prendrait pas part à l’action. Le petit groupe erre de place en place, croisant presque sans y croire une colonne de réfugiés ou une batterie d’artillerie. Tels des enfants perdus, ils tentent bien de s’intégrer à une unité de rencontre pour en être presqu’aussitôt expédiés comme on renvoie des enfants pour les éloigner d’un danger. Les combats, dans une zone pourtant censée grouiller d’ennemis, sont épisodiques, brefs, comme irréels dans un jeu de cache-cache enfantin. Seuls apparaissent les destructions, les ruines, les épaves à mesure qu’on se rapproche de la ville. Sur la plage, la mort rôde sans qu’elle effraie vraiment les hommes qui attendent, comme un simple fait. La mort est là ? Oui, et alors ? Elle reste neutre, impersonnelle, tombant du ciel dans un bruit de Stuka ou de Messerschmit, sans visage ennemi à haïr.
Le troisième étonnement réside dans la qualité de l’interprétation des trois acteurs principaux.
Que ce soit Bernard Lee, qui tiendra son heure de gloire dans le personnage récurrent du M de la série des James Bond. Avec sa grande carcasse posée, paternelle, il figure ce courage de la révolte modeste, presque silencieuse. Il est cette force tranquille dont les anglais se sont fait une spécialité. Quiconque croyait qu’il s’agissait d’une image d’Epinal n’a pourtant pu qu’en vérifier l’existence dans la sobriété des réactions de la population après les récents attentats de Londres. On peut bien penser ce que l’on veut des tenants et des aboutissants du terrorisme, de la capacité de propagande des images télévisées, il y a dans l’interprétation de Bernard Lee quelque chose qui résonne jusqu’à aujourd’hui.
Que ce soit Richard Attenborough incarnant un Holden paralysé entre plusieurs fidélités, entre la peur et le courage, entre l’égoïsme et la main tendue. Petit homme gris, derrière ses lunettes rondes et sa moustache proprette, il est cet homme ordinaire écrasé par le doute. Il est ce héros quasiment malgré lui, navigant à sa mesure dans un monde en folie. Et de sa mesure, entre dignité et indignité, naît un geste qui, bien qu’hésitant, prend sa part de l’avancée de l’Histoire.
Que ce soit John Mills au contact d’un front qu’il recherche tout en l’évitant. Caporal d’occasion qui ne s’était jamais imaginé à la tête d’un groupe d’hommes qui attendent de lui ce qu’il attendrait lui-même d’un plus gradé que lui. Basculant soudainement d’un statut d’enfant que l’on guide à un statut d’adulte qui guide les autre, à un statut quasiment de père qui se retrouve en charge d’une marmaille plus ou moins docile. Deuxième père dans cette histoire, accouché dans son nouveau statut dans la brutalité d’un camion qui explose et tue son officier, comme on se découvre père brutalement à l’expulsion d’un enfant du ventre de sa mère malgré les mois d’attente d’un évènement qu’on ne vivait qu’en pensée. Bins est cette métamorphose, cette déstabilisation, ce cataclysme du changement de rôle, de l’autorité nouvelle qui vous assomme, de la responsabilité qu’il faut apprendre en un quart de seconde de bon ou de mauvais gré.
Métaphoriquement, Leslie Norman nous raconte ainsi l’histoire d’une naissance, dans la douleur et dans le sang, comme toute naissance d’avant l’invention de la péridurale. Et comme d’habitude dans le cinéma anglo-saxon, les simples noms des personnages sont profondément signifiants. Avec un père fantasmé, Foreman, littéralement l’homme du devant, celui qui montre la route, qui guide sa famille, sa tribu, même au prix de sa vie. Et on reconnaît alors l’étymologie de « obstétrique », du latin « ob stare », se tenir devant. Père fantasmé ou plus précisément accoucheur. Avec une mère fantasmée, Holden, littéralement celui qui tient, comme une mère tient et protège sa famille, pleine de doutes et de craintes, mais finalement porteuse de ce courage de tous les jours face à l’adversité quotidienne. Avec un chef de famille réel, incarné, Bins, littéralement à la fois « boîtes » mais ici phonétiquement « têtes » (« beans »), à la tête de ce minuscule groupe qui s’organise face au monde pour se défendre, se protéger, survivre, prospérer, se reproduire. Ainsi doté d’un père, d’une mère, et d’un accoucheur, un monde nouveau peut enfin naître du chaos, une société nouvelle, une nation prête à traverser la douleur et la guerre pour en sortir grandie et réunifiée.
Parti du triste constat d’une cuisante défaite, passant par les affres de la tristesse, de l’errance, de l’incompréhension, sans jamais tomber dans un naïf acte de foi patriotique, Norman en arrive à nous faire sentir, sous la cendre et les décombres, cet espoir insensé que rien n’est jamais perdu, à ce paradoxe de la survie qu’elle est rebelle à toute destruction.
Le plus grand étonnement, au bout du compte, est au bout du compte celui qui s’interroge sur les raisons de l’oubli d’un film de ce gabarit. Et sur ce qu’on retiendrait du cinéma du passé si quelques énergumènes obscurs ne se tenaient anonymement derrière leurs tables de programmation du petit écran à nous distiller quelques unes de ces perles rares.
