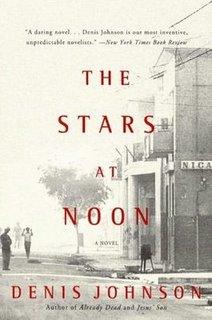
La chaleur brouille la vue, empêche de penser, provoque mirages et autres hallucinations, plonge les personnages dans un état second. Voir les étoiles à midi, essayer de vivre sur cette étoile, cette fournaise, cet enfer. Le rhum n’est sans doute pas le remède indiqué pour étancher cette soif-là, mais peut-être est-ce le moyen, attiser un feu interne, de supporter la chaleur infernale, ou plutôt de ne plus la sentir, la subir. Rhum ou pas, le Nicaragua que décrit Denis Johnson dans ce bouquin ne laisse pas la moindre place à la lucidité, au sens du réel, et par suite – il doit bien y avoir une sorte de logique là-dedans - à la moralité. Il s’agit bien de personnages perdus dans l’enfer, arrivés pour quelque motif, qu’il soit clair ou non, ça n’a plus d’importance. On laisse tout de même entendre qu’on n’arrive pas en enfer pour rien, mais si on n’est pas soi-même au courant de la raison de cette fatalité, ou qu’on l’a oubliée. Ce savoir n’apporterait pas grand chose, de toute façon. Les personnages, en particulier une Américaine (la narratrice) et un Anglais, ne maîtrisent de toute façon presque rien, et ne sont soumis qu’aux impératifs de ce qui leur apparaît comme leur destin, qu’ils mettent en branle malgré eux et dont ils préfèreraient arrêter la marche. Comme dans Angels, Johnson nous parle de l’irresponsabilité de ses personnages, mais aussi de l’inéluctabilité du mal qu’ils font ou qu’ils subissent– du moins telle qu’elle est perçue par l’Américaine prostituée journaliste humanitaire narratrice, par ailleurs impliquée dans un bizarre trafic de devises. Ce n’est pas que ça ne leur demande aucun effort, de faire ce qu’ils font plutôt que rien, c’est seulement qu’ils agissent sans vraiment y penser, sans chercher à évaluer les conséquences de leurs actes, mais parce que l’idée leur en est venue à l’esprit, et s’est imposée. La narratrice peut raconter parce que plutôt qu’une actrice véritable de l’intrigue, qui ne serait pourtant rien sans elle, elle se définit comme observatrice, à la manière des journalistes, qui pullulent naturellement en cette année 1984 de troubles politiques violents - ils en vivent - ou à la manière des agents de la CIA - pareil. « (…) to observe is my designated agony, the sharpest punishment is just to watch. »
Les personnages ne peuvent pas échapper à leur destin, ils ont perdu prise, peut-être à cause de la chaleur, de l’alcool, de l’argent ou d’un autre narcotique, et on assiste, sous les yeux de la femme, à une descente dans les profondeurs infernales, territoire des militaires et des agents secrets, forces démoniaques à la poursuite d’un Anglais maladroit et improbablement naïf, défaut majeur et impardonnable - ce n’est pas en enfer qu’on peut espérer obtenir de l’aide (elle n’a pas le sang froid, brûlant de rhum, mais elle survit quand même bien mieux que l’Européen sous les latitudes en question). Ils sont tous les deux pris dans une sorte de délire, chacun le sien même si le fond, le désir, la sexualité, le décor est commun. La nature de ce délire n’est pas évidente : éthylique ou, d’une certaine façon, mystique ? Ils sont poussés par des forces qui les dépassent. C’est ce qu’ils croient. Il faudrait d’ailleurs prendre le temps de mieux repérer les motifs religieux qui apparaissent, sous forme pervertie sans doute, dans les œuvres de Johnson (qu’on commence par lire le titre de ses livres). On le fera peut-être mieux pour ses autres bouquins.
I was caught up in a cloud of rage… I sensed cool sanity drifting just beneath me but couldn’t reach it. “All I’m saying is be ready. Be ready to find out that this is Hell.
“It isn’t Hell. This is all quite real.”
“If it wasn’t real, it wouldn’t be Hell.”
That seemed to get him thinking.
“You do have a vivid world view,” he said.
The Stars at Noon, de Denis Johnson, chez HarperPerennial ou chez Bourgois.
