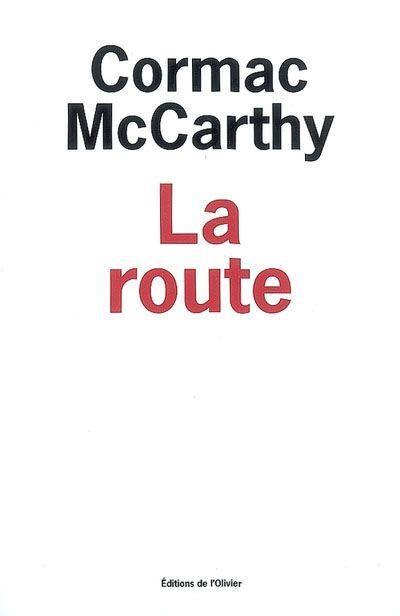
In those first years the roads were peopled with refugees shrouded up in their clothing. Wearing masks and goggles, sitting in their rags by the side of the road like ruined aviators. Their barrows heaped with shoddy. Towing wagons or carts. Their eyes bright in their skulls. Creedless shells of men tottering down the causeways like migrants in a feverland. The frailty of everything revealed at last. Old and troubling issues resolved into nothingness and night. The last instance of a thing takes the class with it. Turns out the light and is gone. Look around you. Ever is a long time. But the boy knew what he knew. That ever is no time at all.La route ne provoque pas de déambulations mais une fuite droite, pure et simple. La destination « vers le sud » est accessoire. Simplement se réchauffer quelque part, fixer ses horizons vers un point de fuite qui peine à se matérialiser. Rester en mouvement pour rester en mouvement. Se forcer à aller vers pour ne pas s'exposer à. La fuite devient un mode, une trajectoire ; on ne fuit pas par espoir d'horizons vivables mais parce qu'on le peut encore.
La langue de Cormac McCarthy est sèche, succession de phrases courtes et répliques brèves. La narration est opaque et ne perce jamais la surface crânienne des personnages (focalisation zéro). Le livre s'organise autour de comportements fixés sur la page, esthétique résolument béhavioriste qui vise à affiner au mieux les situations. Les successions de « et » et de « il » sont légions, parfois les silhouettes des personnages (jamais décrits) se confondent : ils ne sont que corps en suspension, projetés en orbite autour de la route. Aux premières lignes esquissées, on peut penser frustration, mais non. Le livre (court) se dévoile sous des silences, des agencements de silences qui entre eux dévoilent une profondeur véritable au récit (en réalité absence de récit ou récit de l'absence : les pas se succèdent, les dialogues se répètent et les impressions aussi, mais il n'y a ni confrontation au monde, ni initiation dans ce périple). Derrière, la cruauté des situations s'exposent en quelques mots, syllabes, McCarthy n'a jamais besoin de plus pour fixer une intention. Les dialogues entre le père et le fils, particulièrement, marquent sec à la lecture.
Then he heard them in the dry leaves. He took the boy's hand and pushed the revolver into it. Take it, he whispered. Take it. The boy was terrified. He put his arm around him and held him. His body so thin. Dont be afraid, he said. If they find you you are going to have to do it. Do you understand? Shh. No crying. Do you hear me? You know how to do it. You put it in your mouth and point it up. Do it quick and hard. Do you understand? Stop crying. Do you understand?Comme soufflé précédemment, le contexte historique et géopolitique dans La route n'est pas même esquissé. On pense simplement cataclysme écologique, catastrophe nucléaire, soleil figé dans la glace quelques années plus tôt. On ne sait pas non plus pourquoi l'humain (l'autre) a viré cannibale durant ses années d'errances, pourquoi ceux qui restent naviguent à vue entre la peur d'une mort palpable et les cauchemars récurrents des suicidés passés. On ne sait pas. Les causes n'intéressent pas Cormac McCarthy. Les conséquences, elles, ne sont simplement plus permises. Le roman trace sa route dans cet éternel présent : survivre tant qu'on le peut et comme on pourra. Les figures sont pourtant marquées par des types, aucun personnage n'émerge vraiment. Ils n'ont pas de noms. Il y a le père et il y a l'enfant, deux « il » alternés entre sable et bitume.
I think so.
No. Do you understand?
Yes.
Say yes I do Papa.
Yes I do Papa.
The salt wood burned orange and blue in the fire's heart and he sat watching it a long time. Later he walked up the beach, his long shadow reaching over the sands before him, sawing about with the wind in the fire. Coughing. Coughing. He bent over, holding his knees. Taste of blood. The slow surf crawled and seethed in the dark and he thought about his life but there was no life to think about and after a while he walked back. He got a can of peaches from the bag and opened it and sat before the fire and ate the peaches slowly with his spoon while the boy slept. The fire flared in the wind and sparks raced away down the sand. He set the empty tin between his feet. Every day is a lie, he said. But you are dying. That is not a lie.La route comme plongée dans le chaos permet aussi de faire affleurer ce feu sacré que porte en eux les personnages principaux. Ce feu là n'a pas de nom, c'est peut-être la foi, mais ce n'est pas nommé, il n'y a aucun nom dans La route, tout est anonyme. L'enfant doit ici être porté (porté vers le sud, porté vers demain, porté vers la survie au jour le jour ; jamais porté vers l'espoir d'un jour pouvoir supporter le monde comme il est, c'est encore la grande cruauté du livre) puisqu'il représente le devenir de l'espèce. Comme un prétexte, comme cette fuite qu'il faut prolonger encore pour se prouver que c'est possible. La survie est une question à part, elle n'anime pas vraiment le personnage du père, lui qui regrette chaque jour un suicide jamais tranché. On porte l'enfant sur le bord de la route puisque c'est tout ce qui nous reste : mince, si mince contact avec le reste de la vie. Dieu, probablement, est ailleurs, ou bien inexistant. Il n'y a bien que l'enfant, l'enfant et le silence que l'on traverse à pas traînés. Le reste (la civilisation en miettes, le passé qu'on ne côtoie plus que par cauchemars interposés, les autres, désamorcés par la possibilité du mal ambiant) n'a plus aucune importance.
The boy stood up and got his broom and put it over his shoulder. He looked at his father. What are our long term goals? he said.La route s'ouvre et se referme de la même façon : les interlignes bourrés de silence. Le souffle de Dieu est rare, entre les lèvres de l'enfant, qu'il articule par monosyllabes. Le père porte contre lui ce qu'il peut porter, pendant qu'il le peut encore. On sait déjà que la route ne s'épuisera jamais, que cette fuite en avant n'a pas de terme. Il faut pourtant poursuivre la trajectoire : allez, viens, il commence à faire nuit.
What?
Our long term goals.
Where did you hear that?
I dont know.
No, where did you?
You said it.
When?
A long time ago.
What was the answer?
I dont know.
Well. I dont either. Come on. It's getting dark.
D'autres routes :
- Cafard cosmique #1 et #2
- Chez Juan Asensio
PS : Si une âme charitable qui possède à portée de mains une édition française de La route se sentait l'envie de me traquer les quatre passages cités plus haut et de m'envoyer l'ensemble déjà tout tapé-numérisé, il va de soi que je ne dirai pas non pour les insérer à la suite des citations de cette chronique.
