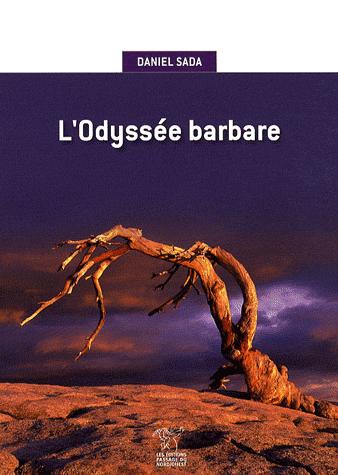
Sauf que L'odyssée barbare est un livre, un vrai, et là les problèmes commencent.
Le récit démarre avec l'arrivée à Remadrín, petit village mexicain, d'une caravane des morts trainant derrière elle rumeurs et poussière mêlées. Trinidad est ici notre Léopold Bloom, donc notre Ulysse, mais en plus fainéant. Parmi ces morts que l'on amène au village pour identification des corps, se trouvent peut-être ses deux fils, opposants politiques lors des dernières élections (pour lesquelles on a volé des urnes et trafiqué les scrutins, mais ça c'est une autre histoire). Trinidad, malgré les injonctions de sa femme, n'y va pas, reste chez lui, fait la sieste. Voilà donc notre (faux) Ulysse.
Le début semble se mettre en place plutôt normalement. Puis, de ce point de départ improvisé, naissent les digressions : passées les quelques pages qui suivent, le récit rompt complètement toute notion de chronologie et d'espace. Les périodes puis les chapitres se succèdent, saccades ou logorrhées en fonction de, comme un puzzle désordonné : les pièces non seulement sont mélangées, mais probablement qu'il en manque quelques unes également. Le but du jeu de la lecture sera alors de rétablir un équilibre, un ordre salutaire, dans ce chaos littéraire certain. Le narrateur lui-même, créature hybride dont on ignore l'identité, s'amuse à détourner le lecteur de son sens de lecture quand il le souhaite, ou bien le cale arbitrairement sur les bons rails lorsqu'il sent que c'est nécessaire. Pour pouvoir avancer décomplexé dans cette jungle parfois hostile, il faut accepter au préalable de se laisser guider, de n'avoir plus le moindre contrôle sur les environnements alentour, de n'être pas le décideur dans cette odyssée là. Telles sont les règles du jeu. Pour trouver plaisir dans cette galère, il faut les accepter. En guise d'exemple, cet intermède savoureux durant la conférence de presse qui présente les « volontaires » s'étant chargé de récupérer les cadavres et de nettoyer la zone où ceux-ci ont été exécutés, où le narrateur invite le lecteur à relier les questions/réponses échangées entre deux micros (cf. l'article éclairé chez Bartleby).
Au fond, dans ce livre, rien n'est réel, rien n'est chronologique. Les évènements se succèdent dans une amplitude de dix ou vingt ans. Les personnages rajeunissent, retrouvent leur âge la page suivante, les suicides se défont et les meurtres se répètent. Les rêves sont décalquées à même la page, ce qui n'arrive pas prend la même veine que ce qui (probablement) se produit. Le sens du mot événement vacille. Le ton du narrateur complique (pimente) tout. Les digressions bousculent l'équilibre de la lecture (au fond parce que l'équilibre de l'univers magique dépeint ici, à la fois très sûr et perpétuellement en proie à l'instabilité, ne tient pas vraiment), la lecture force le sens des évènements relatés. Cette odyssée là n'est pas un parcours mais un labyrinthe (labyrinthe spatial et temporel, tant qu'à faire) à l'intérieur duquel on ne peut pas vraiment se retrouver : la seule issue possible, à en croire la progression de l'intrigue, semble être, non pas la fuite (celle du couple central Trinidad & Cecilia), mais la désolation : destin qui attend Remadrín, en proie aux bourrasques poussiéreuses et aux fantômes, comme ces villes désertées du Farwest dans leur représentation western (la référence au Western est exploitée par le texte, déformée par le texte, voir pour cela l'extrait ci-dessous). Une odyssée tronquée, somme toute, plus proche de Don Quichotte que d'Homère.
- Pour que tu arrêtes une bonne fois de me casser les pieds, je vais te dire quelque chose qui, je l'espère, te plaira beaucoup : si tu ne me donnes pas le pistolet, je renonce à être ton assistant et je fiche le camp d'ici.Qui peut-on sauver de cette odyssée là ? Personne, probablement. Aucun personnage réellement ne se dégage de l'intrigue comme éminemment positifs. Aucun ne semble échapper à cette rage de lâcheté qui s'abat sur ces paysages. Toutes les situations qui se présentent dans ce livre peuvent en réalité être décortiquées comme autant de parodies en puissance, ou satires décomplexées. Dans ce pays qui « adore le mensonge » (nous dit la quatrième de couverture, qui dit toujours ce qu'il faut dire, rappelons-le), Daniel Sada présente les effets directs de la corruption et de la nécrose du pouvoir telle qu'elles se perpétuent depuis des années, sans distinction de régimes ni de couleurs politiques. Le mensonge tel qu'on aime l'entendre et se le raconter (le mensonge de la fiction, à voir chez Cecilia, Emma Bovary des feuilletons radiophoniques, mais également mensonge de masse, gouvernemental, relayé par une presse soumise et une opposition paresseuse puisque intéressée) se propage de bouche en bouche, de main en main, il tourbillonne effleuré sur la page, mais au bout du mouvement c'est un cyclone qui déferle. Le mensonge, certes, mais aussi la lâcheté, trait de caractère qui semble embrasser tous les personnages de l'intrigue, du plus gras (la classe politique, le maire de Remadrín, le gouverneur Pío Bermúdez) au plus insignifiant (les exemples seraient nombreux !). Dans ces conditions, le moindre événement est une farce, la moindre scène une parodie (relire, pour cela, l'extrait cité quelques lignes plus haut, un duel type farwest où personne ne tire, d'autres exemples pourraient être cités, comme cette manie chez les gouvernants de résoudre le moindre problème par le meurtre, comme la déclaration d'amour pathétique de Venulo pour Cecilia, etc.). L'humour est d'ailleurs omniprésent : le narrateur, comique des parenthèses et des entre-tirets, en est le chef d'orchestre et le lecteur son complice.
- Tu ne peux pas me faire ça !
- Eh bien tu es prévenu et je le fais si tu ne me donnes pas le pistolet.
- Tu ne partiras pas, parce que sinon ici même je te colle une balle dans la peau. Tu comprends ?
- Tue-moi, si c'est ce que tu veux ! Tu vois maintenant pourquoi je t'ai demandé le pistolet il y a un instant ? Bon, je m'en vais... il n'y a rien à faire...
- Ne pars pas... ne fais pas l'idiot !
- Je m'en vais ! Je ne changerai pas d'avis... mais je partirai ni en courant ni en criant... Je ne le ferai pas, ne t'inquiète pas... En plus, personne ne saura rien de ton crime de bravache. Aussi, fais ce que tu dois... Je pense que tu auras tout le temps de me tirer dans le dos.
Conrado se dirigea vers la lumière qui agonisait derrière les collines de l'ouest. Résignation qui, cependant, sonnait pas à pas comme un défi lancé à la ligne séparant subtilement la vie qui s'enfuit et la mort qui, attendant de pied ferme, voudrait tout dévorer, ou aussi fragilité superflue : de plus en plus vers cette fameuse ligne critique qui, si elle ne se brisait pas, devrait être une incitation à vagabonder frénétiquement – et Conrado était déjà en chemin- à travers les villages et les hameaux de l'État de Capila ; vagabonder, s'égarer et devenir authentique héroïcité laborieusement fidèle au dessein des nuages. Mais la rupture funeste ?
Sans se lever, Egren sortit de la mallette le pistolet et le pointa en tremblant sur la nuque de Conrado. La lumière, le jeu de ses lames tranchantes, soir ou forme en perspective, et par conséquent l'angle de visée décentrée du tueur qui pensait, indécis – à présent comme un poids qui s'estompait – aux papiers en rouleau : les prendre à sa victime pour ensuite découvrir quoi ? Quelque chose d'insolite ?
Tremblement stupide de la main brandissant le pistolet pointé vers une nuque qui ne se dérobait pas, et une gâchette non plus. Nuque, dos : une seule balle, parce que deux seraient une erreur. Gâchis, plus orgueil ou honneur bafoués, d'autant plus que c'est lui qui devrait compléter son plan après s'être délivré d'un traître qui – pourquoi ne l'avait-il pas prévu ? - ne valait pas une cacahuète.
Cependant, la nuque se faisait de plus en plus imprécise, petite et floue.
Daniel Sada, L'odyssée barbare, Passage du Nord-Ouest, trad : Claude Fell, P.563-564.
Tout fait monstrueux s'étend en un magma fascinant. Il présuppose de la douleur, postule du sang et de l'angoisse, une amplitude ignoble et un effort grotesque. C'est ainsi que Pío Bermúdez s'imagina l'exécution dans un lieu désert du maire de Remadrín et de son épouse : la séquelle d'un ralenti, car il ne s'agissait pas de les cribler de balles en deux temps trois mouvements mais de... Il fallait les blesser à une jambe, pour qu'ils boitent, qu'ils se traînent. La rafale finale surviendrait dès que leurs plaintes se seraient répercutées alentour : peut-être : une chose : si elles portaient au loin, le moins possible tonitruantes ou alarmantes de sorte que leur retentissement (plus ou moins)... L'endroit importait-il ? Un avis modeste sur le sujet avait été insinué pour une mise à mort dans les règles et... Quand à nouveau l'informateur établit le contact avec : allons donc ! il reçut l'ordre de tuer (avec un luxe de détails à de celui qui, batifolant de contentement, dit qu'une fois les époux morts on devait les brûler sur place avec de l'essence jusqu'à les réduire en cendres, on retiendra l'image : de la cendre d'une flambée. Les détails dont il se pourléchait concernant d'autres ordres plus anodins, mais très importants, furent légion : des troupes devaient surveiller les alentours pour la circonstance : répartition concertée, et autres futilités. Accords pertinents. Cela dit, un doute ne devait jamais durer plus d'une heure : c'était là une règle intangible auto-imposée par Pío Bermúdez, pour ne pas s'emmêler les pieds et finalement se repentir. Après cet éclaircissement, on pouvait passer à autre chose. Dernière instruction : une fois le sinistre consommé, l'informateur en question devait à nouveau appeler pour dire simplement : « Tout est réglé ! »L'odyssée barbare maquille la langue, joue avec elle. Sada se permet des écarts de syntaxe au risque de perdre définitivement la compréhension du texte, il articule des néologismes à rallonge et autres créations verbales audacieuses (lire l'article de Bartelby pour plus d'exemples à ce sujet). Idem pour les quelques déformations de prononciation qui trouvent leur place entre les lèvres de certains personnages (accent, bégaiement, bouche pleine, etc.) : tout ici nous ramène vers l'oralité d'un conte que l'on pourrait se perpétuer de bouche à oreille depuis plusieurs générations (oralité que l'on retrouve également dans cet art de la digression et du commentaire perpétuel avec mise en haleine et titillement du spectateur à chaque rebondissement, attendu ou non). Une langue parlée qui va de pair avec une relative simplicité du propos : ici la littérature ne se prend pas en objet, rares sont d'ailleurs les références littéraires dans ce livre. Daniel Sada raconte une histoire, une fiction, par l'intermédiaire de dizaines, centaines de micro-histoires enchâssées les unes dans les autres. La littérature y est pratiquement absente, d'autant plus que cette histoire nous est murmurée, exclamée, déclamée, détraquée, harassée, violentée, gueulée depuis la place du village opposée, égosillée depuis les collines et déformée par les échos (d'où les quelques écarts de sens et autres approximations narratives) ; bref, racontée, tout simplement.
P.648-649.
L'odyssée barbare est un livre compliqué, qui exige beaucoup du lecteur. Ne pas se perdre au sein de ces sept cent pages d'une lourde densité (douleurs dans les poignets, épaule contre vitre froide dans le RER, lecture marquante sur les genoux quand on s'y appuie) est un challenge en soi. Daniel Sada (« le plus baroque d'entre nous », dixit Roberto Bolaño) y déverse une énergie folle que l'on peine à maîtriser à la lecture. Il y a pourtant entre ces pages cette fascination vers le risque, vers la crasse, vers la poussière qu'on inhale et les saloperies qu'on subit (sens propre, sens figuré). Voyage au bout de la nuit était en soi une destination physiquement éprouvante, L'odyssée barbare se plonge dans ce type de douleur : le plaisir est aussi masochiste. Le chef d'œuvre que l'on découvre au fil de ces « périodes » est immense mais incomplet : tant de ruines enterrées dans un sol trop meuble qu'on n'a pas pu creuser. Démesure et frustration mêlées : qui sait si, au bout de cinq, dix, quinze lectures, on aura épuisé ce mythe là ? Qui sait si ce sera seulement possible ? Mais faudra bien (me souffle-t-on), faudra bien essayer d'aller voir, d'y retourner. Ce livre là, tellement exigeant avec son lecteur, qu'il l'invoque à tout reprendre une fois la dernière page refermée. Faudra, faudra bien...
D'autres odyssées :
Bartleby les yeux ouverts
Fric-Frac Club
g@rp #1, #2, #3, #4 et #5
Dernières marges #1, #2 et #3
Ici même, deux extraits déjà cités ces dernières semaines : #1 et #2
