
« Et alors la touche fut donnée, et alors le glacis fut placé ; et pendant un moment le peintre se tint en extase devant le travail qu’il avait travaillé ; mais une minute après, comme il contemplait encore, il trembla et devint très pâle, et il fut frappé d’effroi ; et criant d’une voix éclatante : « En vérité, c’est la Vie elle-même ! » - il se retourna brusquement pour regarder sa bien-aimée : elle était morte ! »
Edgar Allan Poe, « Le portrait ovale »,
Trad. Charles Baudelaire
Les Onze, publié il y a quelques mois, a renouvelé la prétention d’une part de la littérature à faire concurrence, non à l’état civil, mais au réel lui-même et à la vérité objective qui le caractérise : à l’archi-célèbre Joconde que nous finissons par n’apprécier que pour le fait pur et simple qu’elle se trouve devant nos yeux, au Louvre, s’est substitué, le temps d’un court récit, un grand tableau révolutionnaire représentant les onze membres du Comité de salut public. De gauche à droite, Billaud, Carnot, Prieur, Prieur, Couthon, Robespierre, Collot, Barère, Lindet, Saint-Just, Saint-André. Au regard de la vérité objective et factuelle, il s’agit bien d’une supercherie. En toute rigueur, ce tableau n’existe pas davantage que son peintre, Françoizélie Corentin. Mais nous ne répétons ici cet inévitable constat que pour reconnaître in fine leur appartenance à une vérité qui n’est pas celle du monde[1].
*
« François-Élie sans la regarder demande ce que font là ces gens. " Ils refont ce qu’a fait une première fois ton grand-père, dit la mère. Ils font le canal. " Alors l’enfant, avec un grand sérieux et sur un ton d’évidence fâchée :
– Ceux-là ne font rien : ils travaillent.
Vous souriez, Monsieur ? Vous n’y croyez pas ? Oui, c’est trop beau pour être vrai : l’artiste, n’est-ce pas, le créateur – celui qui veut croire de toutes ses forces, et qui arrive à croire, que l’acte par lequel on a prise sur le monde, l’acte digne de ce nom, a pour fondement et principe l’intellection pure, la magie en somme, la volonté magique d’un seul, et n’est machinique que par surcroît, magiquement machinique si l’on peut dire, ainsi qu’il arrive dans l’acte d’Éros. »
Pierre Michon, Les Onze, Verdier, 2009, pp.67-68
*
Peut-être cette vérité du monde pourrait-elle concéder au tableau de Corentin la possibilité d’exister, ne serait-ce que facticement, à l’intérieur des frontières du récit qui le fait apparaître ; mais ce n’est visiblement pas là le projet de Pierre Michon. Cette apparition n’a pas été conçue pour se limiter à un texte, puisqu’elle étend ses ramifications jusque dans l’œuvre de Michelet : « Il a cru s’évanouir, écrit-il, et on veut bien le croire »[2]. L’écrivain, questionné sur le plateau d’Arrêts sur image au sujet de ces douze pages fictives ajoutées au livre III de l’Histoire de la Révolution française, justifie ce coup de bluff par une réponse étonnante et révélatrice que je ne peux transcrire avec exactitude, n’ayant plus accès à la vidéo. Quoi qu’il en soit, plutôt de s’abriter derrière sa qualité d’auteur de fiction non assujetti à l’exactitude historique ou même au respect de l’intégrité des textes, Michon affirme que cette extension apportée à l’œuvre de Michelet correspond à une forme de vérité : si Michelet avait pu contempler Les Onze, il en aurait sans nul doute éprouvé une vive émotion, et lui aurait accordé une place de choix dans ses écrits. Autrement dit, l’apparition du tableau de François-Élie Corentin ne s’effectue pas ex nihilo ; au contraire, tout porte à à croire que la démarche de l’auteur consiste à combler un vide, un manque dans l’histoire de la Révolution. Les Onze n’est pas une simple version uchronique des faits, qui déboucherait sur un présent sensiblement différent, mais un récit dont la matière s’imbrique à la perfection dans le cours contingent de l’histoire pour en faire apparaître la nécessité. Il fallait une « cène révolutionnaire », un banquet des bourreaux de la Terreur qui furent aussi les garants de l’intégrité de la Nation ; un témoignage vivace et onze fois personnifié de la Révolution qui fut, selon le mot de Clemenceau, ce « bloc », cet agglomérat ambigu dont on ne saurait retrancher la part de sang, et le minerai irréductible à partir de quoi l’histoire contemporaine n’en finit pas de se forger.
*
Il fallait donc que Billaud, Carnot, Prieur, Prieur, Couthon, Robespierre, Collot, Barère, Lindet, Saint-Just, Saint-André, de gauche à droite, fussent représentés par Corentin, et par Michon à travers lui ; non seulement parce qu’ils furent les convives glorieux et ensanglantés de cette Cène farouchement laïque, onze barons sadiens emblématiques des Lumières et de leur ombre portée, mais aussi pour cette autre raison plus spécifiquement littéraire : avant d’accéder à leurs rôles d’hommes de pouvoir, ou dans l’exercice même de leurs macabres fonctions, tous furent écrivains. En d’autres termes, tous eurent l’ambition de faire au sens où l’entend François-Élie, c’est-à-dire de produire des discours qui fussent au bavardage ce qu’est le canal à la Loire, ou sa conception au labeur des Limousins. Le tableau de Corentin fournit ainsi au narrateur des Onzel’occasion de comparer l’activité d’écrivain – ou de peintre – à celle de membre du Comité de salut public. L’un et l’autre sont en effet soumis in fine au même constat : toute oeuvre digne de ce nom est révolutionnaire par nature[3], et la révolution est un bloc – ou plutôt, comme l’écrit Michon avec force variations de sens, « Dieu est un chien », Dio cane !
C’est-à-dire que le canal ne saurait exister sans la souffrance bien réelle des Limousins, pas plus qu’alors l’idée d’une République libre, égale et fraternelle sans le sang versé de la Terreur, ou encore qu’un livre sans les monceaux de cadavres, métaphoriques ou non, sur quoi il prend racine. À commencer, sans doute, par celui de l’auteur : « L’idéal, écrit-il, serait d’être glorieux et caché, c’est-à-dire mort. »[4]
*
Toute Œuvre exige un sacrifice expiatoire à sa mesure : tel est le prix à payer pour tracer le cours des fleuves. Mais un tel acte repose sur une croyance fondamentale : « Il faut vouloir percer quelque mur, croire que prodigieusement les mots vont y entamer un brèche, pour commencer d’écrire et persister. »[5] Autrement dit, il faut croire en quelque prodige digne de la vie qui lui est sacrifiée ; et quel prodige le serait davantage que la restitution de cette vie même, transfigurée au moyen de la fiction, qui est pourtant l’antithèse de la vérité du monde ? Il faut croire en effet qu’un tel prodige est possible, et cette croyance s’apparente singulièrement à la Foi chrétienne. Pour François-Élie, il existe une autre Vérité, celle de la Vie elle-même, qui est pur surgissement et pure subjectivité. L’histoire est par excellence le domaine où passe la frontière entre la vérité objective, scientifique, et celle de la Vie, qui n’est perceptible qu’à l’échelle individuelle ; et le coup de force réalisé par la fiction consiste à permettre à cette vérité phénoménologique – au sens où les événements y sont appréhendés dans la singularité de leur apparaître – de parvenir à l’universel, par le truchement d’un effet de réel qui acquiert, avec Les Onze, une puissance singulière.
*
« " Ils ne font rien, car ils travaillent " : on ne saurait croire plus passionnément que l’on est unique et que le monde est magique, magiquement le jouet d’une seule volonté, n’est-ce pas ? On ne saurait croire davantage qu’agir et jouir sont une seule et même chose. On ne saurait être davantage artiste, si vous voulez, comme disent les bonnes gens qui lisent avec attention ce mot d’enfant dans la petite notice de l’antichambre, au Louvre. On ne saurait mieux illustrer ainsi que l’homme individuel est un monstre, comme disaient dans leurs différentes façons Sade et Robespierre. François-Élie fut avec une grande simplicité ce monstre : sa croyance monstrueuse lui donnait plaisir d’être au monde et vigueur en ce monde : avec cette croyance et pour la soutenir, la nourrir, pour qu’elle continue d’être (et du même coup pour que lui-même, Corentin, soit), il a fait l’œuvre qu’on sait. Cette croyance devint du doute en chemin, mais elle persista : c’est elle qui l’a fait tenir debout toute sa vie, qui l’a conjointement entravé et poussé aux reins dans ses moindres actes, et que pour finir il a pulvérisée dans Les Onze, - à moins qu’une fois de plus il ait rusé avec elle, l’ait amadouée en la reniant, ou reniée pour la restaurer, et l’ait secrètement rétablie, méconnaissable. »
Pierre Michon, Ibid., pp.69-70
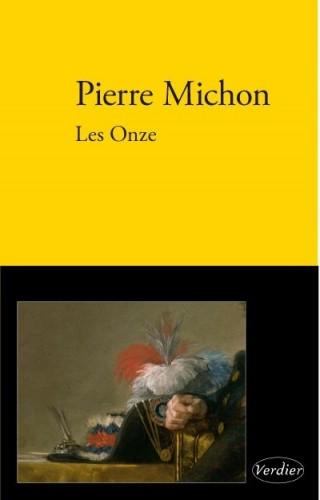
[1] Je reprends ici à dessein la terminologie mise au point par Michel Henry dans C’est moi la vérité : pour une philosophie du christianisme, Seuil, 1996.
[2] Pierre Michon, Les Onze, Verdier, 2009, p. 130.
[3] Sur ce point Michon rappelle une anecdote historique à propos de Bernadotte (Charles XIV), roi de Suède sous le règne de Bonaparte. Après son décès, on s’aperçut qu’il portait au bras une inscription tatouée : " Mort aux rois ". « Eh bien, dit Pierre Michon, chaque fibre du corps de Rimbaud, sa vie le prouve assez, portait tatoué : " Mort à l’auteur ". » (Le Roi vient quand il veut, Albin Michel, 2007, p. 112) Ou encore, plus loin : « Ceux qui importent, ce sont ceux qui mettent leur briquette comme si c’était de la dynamite, en se disant : cette fois l’édifice va péter. Ceux qui aiment tellement la biliothèque qu’ils voudraient qu’elle s’effondre avec eux et à cause d’eux. Ceux dont l’œuvre a la prétention exorbitante de mettre fin. Et bien sûr, c’est Rimbaud qui nous vient tous à l’esprit. Mais Baudelaire, Proust ou Faulkner étaient du même tonneau. Ou de la même mèche. » (Ibid., p. 141)
[4] Ibid., p. 129.
[5] Ibid., p. 57.
