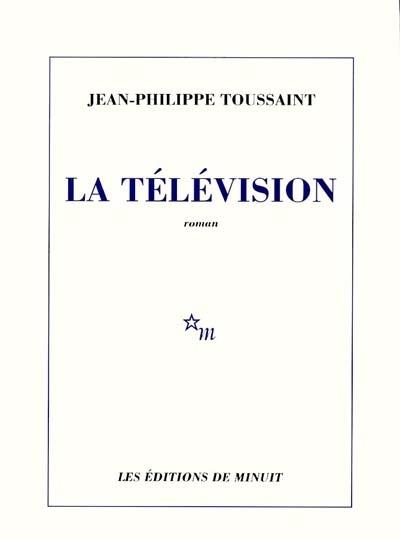
Vous avez tout à fait le droit de penser que ce livre est le plus drôle. Ce n'est pas du tout mon cas. Je vois davantage La télévision comme un roman aux limites de l'essai – j'aime d'ailleurs ce mélange des genres chez Jean-Philippe Toussaint - qui porte un regard sur l'image, la dévalorisation de la culture, les rapports humains.
« J'ai arrêté de regarder la télévision. »
Ainsi commence ce nouvel opus. Disons d'emblée qu'il ne faut pas trop se fier au narrateur. Celui-ci vit à Berlin, où il est venu, après avoir obtenu une bourse, étudier le rapport entre les arts et le pouvoir politique en Italie au XVIè siècle en se basant sur l'œuvre du Titien dont le vrai nom, rappelons-le, est Tiziano Vecellio ou Tiziano Vecelli, « TV ». Quand on vous dit que Jean-Philippe Toussaint aime le jeu.
Comme dans les précédents romans, vous aurez remarqué que le narrateur n'a pas de nom. Enfin, celui-ci nous est inconnu. En revanche, nous apprenons vite le nom de celle qui partage sa vie. Comme dans La salle de bain avec Edmondsson, celle-ci a un patronyme que l'on verrait plutôt attribué à un homme – référence cinématographique oblige - : Delon.
« Delon, au début du mois de juillet, était repartie en vacances en Italie avec les deux enfants, l'un à la main, l'autre dans son ventre (ce qui est éminemment pratique quand on est toujours chargé comme elle d'une quantité folle de valises et de bagages à la main), et je les avais accompagnés tous les trois à l'aéroport ; je portais les billets d'avion. »
Dans le livre, il est d'ailleurs dit que Delon ressemble à une actrice de cinéma quand elle arrive à l'aéroport. Il y a d'ailleurs un constant va-et-vient, me semble-t-il, entre la vie réelle et une vie restituée sur un écran. Là encore, nous sommes dans un espace médian où les deux univers semblent s'interpénétrer. Il y a toujours chez Jean-Philippe Toussaint un entre-deux. J'y vois un signal d'alarme déclenché par l'auteur sur cette place grandissante de l'objet dans nos vies respectives :
« Une des principales caractéristiques de la télévision quand elle est allumée est de nous tenir continûment en éveil de façon artificielle. Elle émet en permanence des signaux en direction de notre esprit, des petites simulations de toutes sortes, visuelles et sonores, qui éveillent notre attention et maintiennent notre esprit aux aguets. Mais, à peine notre esprit, alerté par ces signaux, a-t-il rassemblé ses forces en vue de la réflexion, que la télévision est déjà passée à autre chose, à la suite, à de nouvelles simulations, à des nouveaux signaux tout aussi stridents que les précédents, si bien qu'à la longue, plutôt que d'être tenu en éveil par cette succession sans fin de signaux qui l'abusent, notre esprit, fort des expériences malheureuses qu'il vient de subir et désireux sans doute de ne pas se laisser abuser de nouveau, anticipe désormais la nature réelle des signaux qu'il reçoit, et, au lieu de mobiliser de nouveau ses forces en vue de la réflexion, les relâche au contraire et se laisse aller à un vagabondage passif au gré des images qui lui sont proposées. Aussi notre esprit, comme anesthésié d'être aussi peu stimulé en même temps qu'autant sollicité, demeure-t-il essentiellement passif en face de la télévision. De plus en plus indifférent aux images qu'il reçoit, il finit d'ailleurs par ne plus réagir du tout lorsque de nouveaux signaux lui sont proposés, et, quand bien même réagirait-il encore, il se laisserait de nouveau abuser par la télévision, car, non seulement la télévision est fluide, qui ne laisser pas le temps à la réflexion de s'épanouir du fait de sa permanente fuite en avant, mais elle est également étanche, en cela qu'elle interdit tout échange de richesse entre notre esprit et ses matières. »
Mais cette invitation à la réflexion sur ce média et les conséquences de sa force de frappe n'empêche pas, comme d'habitude, la légèreté. Légèreté quand le narrateur est engagé par ses voisins du dessus Uwe et Inge Drescher - « que l'on pourrait traduire approximativement en français par Guy et Lucie Perreire » - pour arroser leurs plantes en leur absence. On rit parce que c'est précisément le genre de chose à ne pas demander à un personnage de Jean-Philippe Toussaint, être, en général, dépourvu de la moindre volonté mais qui ne sait pas dire non. Contraste d'autant plus saisissant et drolatique que le couple d'Allemands s'escrime à expliquer dans le détail la façon de s'y prendre pour que les plantes ne meurent pas.
Situations cocasses aussi lorsque le narrateur rencontre, au Parc Halensee, le président de la fondation qui lui a octroyé une bourse, accompagné de l'écrivain Cees Noteboom. Ou, plus loin, quand le personnage principal raconte qu'un jour il cherche un livre de Musset au centre Pompidou. On lui répond qu'il est introuvable, recherche informatique à l'appui. Et pourtant, le narrateur retrouvera l'ouvrage dans les étagères de Beaubourg. On aurait envie, à ce moment-là, d'entonner un « Les gens tout de même » - voir chroniques précédentes -.
J'y vois une critique d'une société qui s'enorgueillit de ses performances, de sa capacité à être plus rapide, plus réactive mais qui ne voit pas ses excès. Une société de l'objet à tout prix comme lorsque le narrateur est confronté à son fils qui veut à tout prix un Ninjet, « moi le seiziémiste ».
A mon sens, Jean-Philippe Toussaint dénonce aussi une société d'imposteur, sans jamais avoir l'air d'y toucher. Ainsi quand il introduit le personnage de John Dory qui remplace un psy alors qu'il n'a aucune compétence en la matière. Il s'agit d'un ami canadien du narrateur avec qui il va voler. L'avion pour prendre de la hauteur, dans tous les sens du terme.
J'ai lu ce roman comme un appel au calme – les derniers mots sont d'ailleurs « silence » et « obscurité » -, à une pause dans le mouvement qui gangrène tout, y compris, la vie personnelle - « (...) il a cinq ans ! Dit-elle en s'asseyant en face de nous dans le canapé; Il a déjà cinq ans ! Dis-je (c'était incroyable, ça changeait tout le temps : il n'y a pas quinze pages, il avait quatre ans et demi. » - . Comme s'il s'agissait de ne pas se laisser embarquer dans cette course perpétuelle dont le poste de télévision serait le symbole.
« La télévision nous prive de trois des cinq sens dont nous nous servons d'ordinaire pour appréhender le monde à sa juste valeur. »
Et Jean-Philippe Toussaint de s'interroger aussi dans ce livre sur ce qu'adviennent les images une fois diffusées. Images tellement omniprésentes que certaines scènes de la vie quotidienne semblent elles-mêmes échappées d'émissions abêtissantes. La frontière entre les deux mondes devient de plus en plus floue.
« Ces deux petits – des caniches nains - excités s'appelaient Cassis et Myosotis, je l'appris de la bouche même de leur maître, qui, après avoir bu placidement une gorgée de thé, s'était penché sous la table pour essayer de calmer les ardeurs de ses petits protégés (et non pas Prime Time et Dream Team, ni même, plus mimétiquement, comme je m'étais également plus à l'imaginer en observant leur petit manège sous la table Sodome et No more). »
Et pourtant, malgré cela, le narrateur finira par racheter une nouvelle télévision pour remplacer son poste tombé en panne. Comme si le phénomène d'accoutumance était trop fort.

Vous partagerez ici quelques moments de vie de Jean-Philippe Toussaint. Ils disent finalement pas mal de choses sur le regard plutôt amusé que porte cet auteur sur le monde, ses contemporains.
Je me suis régalé en lisant une confrontation particulièrement savoureuse, à Berlin, entre l'auteur et une charcutière peu amène dont il finira par se venger.
Il y a aussi cette partie de pétanque, inoubliable semble-t-il, où l'auteur pratique avec brio l'auto-dérision un brin british : « Lui, petit, râblé, court, musclé, avec un filet de moustache noire, un short rouge et des savates (et torse nu, peut-être, capable), le tireur infaillible. Moi, longiligne, aristocratique (très prince de Savoie, m'étais-je laissé dire.) »
Je trouve délicieux cette façon d'être un peu en retrait du monde et de regarder ses incohérences d'un peu loin – ce qui introduit une certaine profondeur de champ, me semble-t-il -. J'aime ces réflexions qui ponctuent certains chapitres :
« Mais trêve de vraisemblance »
Plus tôt :
« Mais trêve de confidence. »
Ce côté Bill Murray dans Lost in translation est évidemment très présent dans les pages sur le Japon - « Grillé, c'est bon aussi le poisson cru » ; « Je n'ai pas tellement eu l'occasion d'améliorer mon allemand à Kyoto » -, la Chine - « Un médecin chinois, voilà ce que j'étais dans le fond. » confie l'auteur après une rencontre avec une admiratrice qui attribue à ses livres des effets dignes de ceux de la médecine chinoise – ou encore la Tunisie - « (...) cela (Tunis) m'a rappelé un peu Elseneur, au Danemark, où il n'y a rien à voir non plus. » -.
Mais derrière cet amusement je devine une distance teintée de tristesse à la vue de certains spectacles de la vie. Ici, au Japon.
« Puis, tandis que la strip-teaseuse, sans se départir de son perpétuel sourire avenant de speakerine américaine d'origine asiatique, continuait de bonimenter le public à distance les jambes écartées depuis le bord de la scène sans sembler s'apercevoir le moins du monde que les trois types étaient en train de lui pétrir les seins et de lui travailler le con avec des assiduités de manchot aveugles, bornés et répétitifs, elle leur réessuyait distraitement le bout des doigts et se transportait légèrement sur le côté pour faire profiter les spectateurs suivants des tréfonds de son âme, emportant avec elle le petit tas de serviettes transparentes usitées, qui, de tout, dans ce rituel bien huilé, me semblait le plus répugnant. Eh bien, joyeux Noël. »
Sinon, comment comprendre autrement cette phrase :
« C’est une expérience concrète et douloureuse, physique et fugitive, de me sentir moi-même partie prenante du temps et de son cours. »
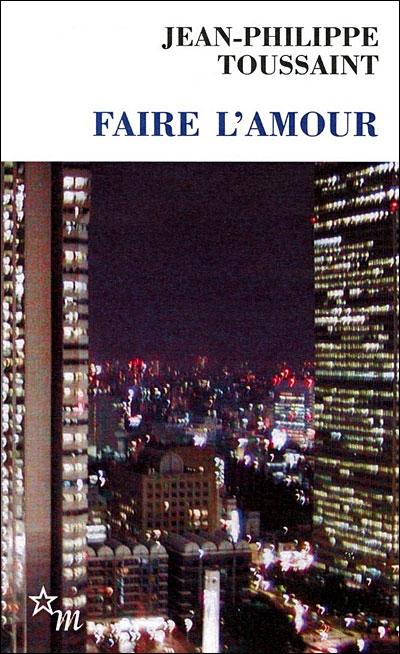
Sous-titre : Hiver.
Nous avions quitté un des narrateurs de Jean-Philippe Toussaint qui lançait une fléchette dans la tête de sa compagne. Nous en trouvons un autre tout aussi inquiétant en amorce de Faire l’amour.
« J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique, et je le gardais sur moi en permanence, avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un. »
Quelle gueule ? Celle de Marie, compagne du narrateur, styliste et plasticienne, qui a conçu des vêtements expérimentaux en titane et Kevlar pour une exposition d’art contemporain ? Possible :
« Mais combien de fois avions-nous fait l'amour pour la dernière fois. »
Voilà donc un couple qui fait l’amour dans un hôtel de Tokyo. Soudain, l’écran de télévision – décidément – s’allume disant qu’un fax est arrivé – l’intrusion du monde extérieur dans la sphère de l’intime – provoquant l’interruption du coït, déclenchant la colère de Marie.
Marie qui, contrairement aux autres femmes des romans précédents de Jean-Philippe Toussaint possède un nom à rallonge : Marie Madeleine Marguerite de Montalte, dont on appréciera l’allitération en « m ». En « aime » ?
« Nous nous aimions mais nous ne nous supportions plus. »
Il y a beaucoup de gravité dans ce texte. Mais, chez Jean-Philippe Toussaint, cette gravité n’empêche pas une certaine distanciation – si je puis dire par rapport à la citation suivante - :
« Le jour se levait sur Tokyo et je lui enfonçais un doigt dans le trou du cul. »
C’est donc à la progressive décomposition d’un couple que nous assistons dont l’élément déclencheur – cela ne vous surprendra pas – est encore un élément extérieur : un tremblement de terre, phénomène assez courant dans l’archipel nippon.
« (...) tremblement de terre était indissociablement lié pour nous à la fin de notre amour. »
Une fois la rupture annoncée, le narrateur s’en ira chez un ami, Bernard, à Kyoto. Il enverra un fax à Marie en espérant qu'un message s'allumera sur l'écran du téléviseur dans sa chambre. Peine perdue. Finalement, il l'appellera, retournera à Tokyo et entrera dans la salle d'exposition - où sont exposés les travaux de Marie - après avoir menacé le gardien du flacon d'acide. Flacon qu'il videra ensuite sur une fleur. Celle fleur pourrait être une pensée comme l’explique dans les « Notes », à la fin de l’ouvrage, Laurent Demoulin qui parle de roman plus acide, qui décrit l’inaction et ose la psychologie.
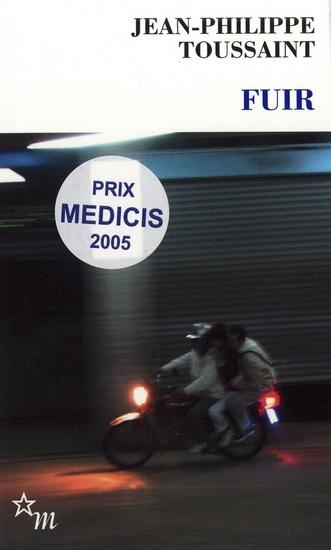
Sous-titre : Été. Ce roman a reçu le Prix Médicis il y a maintenant quatre ans.
Est-ce la suite de Faire l’amour ? C’est possible. Est-il nécessaire de lire ce duo – qui pourrait même former une trilogie avec La vérité sur Marie – dans cet ordre ? Pas forcément si vous voulez mon avis.
C’est la Chine qui, cette fois, sert de décor au roman et plus précisément Shanghai où le narrateur vient faire du « business » pour Marie. Il est accueilli par une dénommée Li Qi – lychee – et un certain Zhang Xiangzhi, homme pour le moins trouble, qui lui met en main un téléphone portable. Au bout du fil il y a Marie qui appelle pour dire que son père est mort.
La première partie est une espèce de course dans cette Chine débordante de vitalité. Moi qui ai eu la chance de pouvoir voyager notamment dans l’empire du milieu, je vous assure que les lignes suivantes rendent parfaitement compte du choc visuel, sonore et presque olfactif que subit tout nouvel arrivant dans ce pays.
« Nous débouchâmes là sans transition, encore en mouvement, encore agités, encore en état de choc, dans la fuite, dans le tremblement du corps, dans l'urgence d'échapper, incapables de se remettre, et de freiner, arrivant trop vite, trop fort, trop brutalement, sur le trottoir, que nous heurtâmes de plein fouet et chutant tous les trois à la terrasse d'un café, dans les jambes d'un groupe de consommateurs, qui reculèrent d'un bond et s'écartèrent pour nous éviter, non pas exactement chutant d'ailleurs, mais versant simplement sur le côté, nous rattrapant de la jambe, nos trois jambes à la fois qui avaient anticipé le mouvement pour amortir la chute, et redressant tous les trois la moto, péniblement, encore à califourchon, les jambes empêtrées dans la machine, mais ne roulant plus, à l'arrêt maintenant, et l'objet de tous les regards, ne disant rien, ne nous excusant pas, tirant laborieusement la roue arrière pour la dégager de la rigole et pouvoir se remettre en route, continuer à avancer, à contre-courant, sur le trottoir, de nouveau tous les trois sur la moto, à l'italienne, comme sur une Vespa dans la nuit tiède, remontant la foule parmi les rires et les conversations des tables, au ralenti, longeant le bas-côté, redescendant sur la chaussée en accélérant à fond sur quelques mètres, puis freinant brutalement devant une voiture qui arrivait en face, remontant sur le trottoir, et redonnant tous les trois l'impulsion avec nos pieds, pour se relancer et repartir en slalomant entre les tables, descendant toute l'avenue ainsi, jusqu'en bas, où il n'y avait plus rien, plus de café, plus personne, roulant à fond dans le noir sur quelques dizaines de mètres, puis arrêtés, freinés de nouveau dans une rue animée, bloqués par une marée de piétons qui marchaient dans la rue, une petite rue de bars et de bouis-bouis à brochettes, plus sombre, sans réverbères, avec quelques néons blancs et verts, des portes en bois, des stores en bambou, derrière lesquels se devinaient des lumières de bouge, fauves, tamisés, quelques fenêtre éclairées, des lueurs vertes qu'on apercevait derrière les vitres. »
OUF ! Mais n’est-ce pas là la preuve éclatante que le rythme n’est pas forcément lié à la longueur des phrases ?
La tonalité, le rythme s’apaisent dans la troisième partie qui commence en Méditerranée. On retrouve Marie devant le cercueil de son père, en tenue d’équitation – Jean-Philippe Toussaint n’oublie jamais le détail, il a son importance dans le roman suivant -.
Les deux protagonistes se retrouvent, font à nouveau l’amour. Un rapport qui n’est pas exempt d’une certaine violence :
« (...) un coup de chatte dans la gueule »
Violence aussi, d’une certaine manière, quand Marie oblige le narrateur à nager, la nuit tombée, pour la retrouver.
Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. On pourrait lire ce roman comme une illustration de ce vieil adage. Roman qui, comme l’apprend le lecteur dans le dialogue entre Jean-Philippe Toussaint et Chen Tong, son éditeur chinois, avait d’abord pour titre « Vivre ». Comme s’il s’agissait de montrer qu’il y a de la vie dans la fuite. Certes. Mais aussi de la fuite dans la vie.
Une fuite hors du monde qui caractérise assez bien l’œuvre de Toussaint. Il s’agit donc ici de renforcer ce côté « en dehors du monde en montrant une réalité qui nous échappe ».
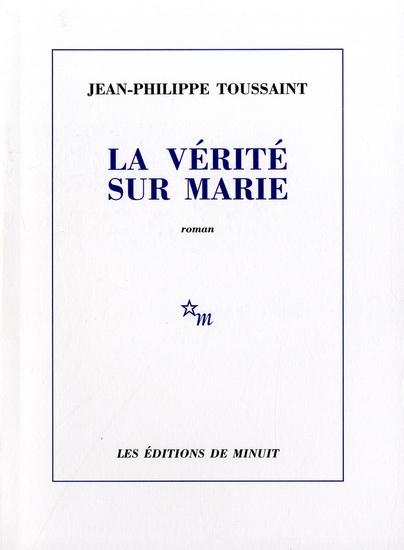
Sous-titre : Printemps-été.
Titre un brin provocateur en tant qu’il pose le thème de la vérité romanesque – voir l’interview que m’a accordé Jean-Philippe Toussaint -.
On retrouve donc ici le narrateur et Marie. Nous les avions laissés à nouveau « unis ». Ce n’est plus d’actualité.
« Plus tard, en repensant aux heures sombres de cette nuit caniculaire, je me suis rendu compte que nous avions fait l'amour au même moment, Marie et moi, mais pas ensemble. »
D’emblée donc, le langage de la vérité : Jean-Philippe Toussaint ne tourne pas autour du pot.
Marie a unamant : « Jean-Christophe de G ». Un nom à particule, comme celui de Marie – voir chronique précédente -. JC de G vient d’avoir une attaque fatale.
Commence alors un flash-back des événements passés qui a vu la disparition du narrateur. Disparition qui s’accompagne d’ailleurs d’un effacement temporaire du « je » - son retour est violent -. Narrateur qui, de con côté, s’est trouvé une autre compagne également prénommée : Marie, histoire d’ajouter un peu à la complexité de l’histoire.
Durant la première partie du roman, le narrateur est appelé au domicile de Marie, son ex-copine et découvre les lieux où, quelques minutes plus tôt, elle partageait encore la vie de Jean-Christophe qui, en fait, s’appelle Jean-Baptiste de Ganay – j’aime beaucoup cette démarche qui consiste à fausser les pistes et à apporter souvent des correctifs, créant ainsi un mouvement opposé -.
« Je regardais ces chaussures vides, abandonnées au pied du lit, c'était tout ce qui demeurait de cet homme dans la chambre. De lui, comme dans une image mythologique d'homme foudroyé, ne subsistaient que ses chaussures. »
C’est à Tokyo que Jean-Baptiste, éleveur de chevaux, a fait la connaissance de Marie, lors du vernissage de son exposition. Qu’il l’a emmenée à l’hippodrome où ils croiseront d’ailleurs le narrateur – moment merveilleux quand ce dernier se « dédouble » et se voit dans les yeux de Marie : « elle était violemment avec lui » -.
Le lecteur se délectera des péripéties autour de Zahir, pur-sang bourré d'anabolisants, en particulier quand le cheval est conduit de force dans une stalle afin d’effectuer un voyage vers la France. Et voici donc cet animal, symbole de mouvement, progressivement dompté à qui il arrive les pires malheurs en vol :
« Ce Zahir était autant dans la réalité que dans l'imaginaire, dans cet avion en vol que dans les brumes d'une conscience, ou d'un rêve, inconnu, sombre, agité, où les turbulences du ciel sont des fulgurances de la langue, et, si dans la réalité, les chevaux ne vomissent pas, ne peuvent pas vomir (il leur est physiquement impossible de vomir, leur organisme ne le leur permet pas, même quand ils ont mal au cœur, même quand leur estomac est surchargé de substances toxiques), Zahir, cette nuit, à bout de forces, titubant dans sa stalle, tombant à genoux dans la paille, la crinière plaquée sur la tête, les poils emmêlés, torsadés, enduits d'une mauvaise sueur sèche, les mâchoires molles, la langue pâteuse, mastiquant le vide, sécrétant une salive aigre, transpirant, se sentant mal, essayant de se redresser dans sa stalle, faisant un pas de côté sur ses jambes flageolantes et perdant de nouveau l'équilibre, à deux doigts de s'effondrer sans connaissance, dans le box, retombant, lentement, au ralenti, sur ses genoux, s'affaissant, les antérieurs ployés, l'estomac lourd, distendu par les fermentations, sentant les aliments lui monter le long du ventre, des sueurs froides lui noyant maintenant les tempes et éprouvant soudain cette proximité concrète, physique, avec la mort, que l'on éprouve quand on va vomir, cette affreuse salive qui remonte dans la bouche et annonce l'imminence des vomissements, quand les viscères se contractent et que les aliments affluent dans la gorge et commencent à remonter dans la bouche, Zahir, cette nuit, indifférent à sa nature, traître à son espèce, se mit à vomir sous le ciel dans les soutes du Boeing 747 cargo qui volait dans la nuit. »
On revient donc ici à une forme de légèreté. Mais n’en concluons pas que cette légèreté imprègne tout le livre. Il me semble en effet que Jean-Philippe Toussaint, dans ses trois derniers opus, explore avec beaucoup de minutie une forme de « consommation amoureuse ». Celle-ci se caractérise, à mon sens, par une attitude très extrémiste dans la relation. Ou bien on en a une. Ou bien on n’en a pas. Il n’y a pas de juste milieu.
C’est donc un travers de société que l’auteur tente d’approcher au plus près mais en multipliant les points de vue. Un peu comme si la vérité ne pouvait faire l’économie de contre-champs. C’est peut-être dans ces écrits que l’on découvre un Jean-Philippe Toussaint cinéaste – tout comme j’avais découvert le Jean-Philippe Toussaint écrivain en voyant le film Monsieur avant de lire le livre -.
« Je savais qu'il y avait sans doute une réalité objective des faits – ce qui s'est réellement passé cette nuit-là dans l'appartement de la rue de La Vrillière -, mais que cette réalité me resterait toujours étrangère, je pourrais seulement tourner autour, l'aborder sous différents angles, la contourner et revenir à l'assaut, mais je buterais toujours dessus, comme si ce qui s'était réellement passé cette nuit-là m'était pas essence inatteignable, hors de portée de mon imagination et irréductible au langage. J'aurais beau reconstruire cette nuit en images mentales qui auraient la précision du rêve, j'aurais beau l'ensevelir de mots qui auraient une puissance d'évocation diabolique, je savais que je n'atteindrais jamais ce qui avait été pendant quelques instants la vie même, mais il m'apparut que je pourrais peut-être atteindre une vérité nouvelle, qui s'inspirerait de ce qui avait été la vie et la transcenderait, sans ce soucier de vraisemblance ou de véracité, et ne viserait qu'à la quintessence du réel, sa moelle sensible, vivante et sensuelle, une vérité proche de l'invention, ou jumelle du mensonge, la vérité idéale. »
Je suis très sensible, par ailleurs, au fait que Jean-Philippe campe ses livres dans la réalité sans avoir recours à un maximum d’artifices d’écrivain. S’il était metteur en scène de théâtre, je veux croire qu’il privilégierait l’épure. Cette notion qu’aiment tant les Japonais. Pas étonnant d’ailleurs que les romans de cet écrivain dont l’œuvre est tellement attachante aient beaucoup de succès au pays du Soleil Levant.
Bonne lecture !

