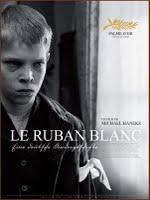 Un ruban blanc. Il aura suffi de ce si simple objet pour nier à un cinéaste français la Palme d’Or pour la deuxième année consécutive. Si l’exploration fascinante du milieu carcéral par Jacques Audiard dans Un prophète a dû « se contenter » du Grand Prix cannois, c’est au bénéfice du Ruban Blanc de l’autrichien Michael Haneke.
Un ruban blanc. Il aura suffi de ce si simple objet pour nier à un cinéaste français la Palme d’Or pour la deuxième année consécutive. Si l’exploration fascinante du milieu carcéral par Jacques Audiard dans Un prophète a dû « se contenter » du Grand Prix cannois, c’est au bénéfice du Ruban Blanc de l’autrichien Michael Haneke.Il me faut confesser que j’ai tardé à aller voir la Palme 2009 (un mois après sa sortie), et qu’il est fort probable que s’il n’avait pas glané la suprême récompense je n’eusse jamais eu le courage de m’installer 2h30 durant devant Le Ruban Blanc. Il faut dire que le cinéma de Michael Haneke, à la base, ce n’est pas franchement ma tasse de thé… Ce qui se rapproche le plus d’un film m’ayant plu, dans sa filmographie, est sans doute Caché, malgré son dénouement décevant à souhait.
Le Ruban Blanc est un ambitieux film plongeant dans une Allemagne sur le point de déclencher les premières hostilités de 14-18. Dans un petit village campagnard, une série d’accidents perturbe la sérénité locale. S’il est vite évident que ces chères petites têtes blondes apparemment si innocentes n’y sont pas étrangères, ce qui intéresse Haneke n’est pas d’expliquer ces accidents, mais plutôt de montrer, à travers le comportement des adultes d’un côté et des enfants de l’autre, comment un peuple a pu, deux décennies plus tard, être amené à suivre avec conviction un petit leader moustachu aux idées nauséabondes.
L’examen est plus qu’intéressant, et le noir et blanc pour lequel a opté le cinéaste est splendide. Le Ruban Blanc demeure tout de même à mes yeux un objet bien long, bien austère, et bien maniéré. Mais il ne fait aucun doute qu’il marque la rétine bien après la sortie de la salle. La Palme n’est absolument pas scandaleuse, même si elle n’aurait pas dépareillé dans les mains de Jacques Audiard…
Au moment du palmarès cannois justement, de nombreuses voix se sont élevées lorsque le Jury
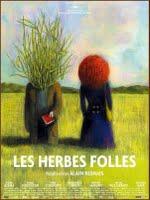 présidé par Isabelle Huppert a décerné un Prix Exceptionnel à Alain Resnais et ses Herbes Folles. « Quoi ? Mais c’est quoi ce faux prix ?! Pfff, ils n’ont pas osé lui offrir la Palme alors qu’il la méritait !! ».
présidé par Isabelle Huppert a décerné un Prix Exceptionnel à Alain Resnais et ses Herbes Folles. « Quoi ? Mais c’est quoi ce faux prix ?! Pfff, ils n’ont pas osé lui offrir la Palme alors qu’il la méritait !! ».Lors de sa sortie en salles il y a quelques semaines, rebelote, presse dithyrambique louant la vivacité du film du vétéran du cinéma français. J’y suis allé convaincu que le pâle Cœurs, son précédent, n’aura donc été qu’un faux pas après cette décennie merveilleuse qui l’avait vu réaliser les grandioses Smoking / No Smoking, On connaît la chanson ou Pas sur la bouche (ce dernier étant mineur mais fort sympathique).
La vision des Herbes Folles m’a, contre toute attente, plongé dans une incompréhension totale. J’ai peiné, pendant toute la durée de l’œuvre, à y voir un grand film. A y voir un bon film. A y voir un film regardable. L’excitation a vite laissé la place à l’atterrement. Où se trouvaient la folie, l’inventivité, le tonus tant annoncés ? Oui Alain Resnais sait tenir sa caméra, il l’a toujours su et le saura jusqu’au dernier souffle. Mais venant d’un tel cinéaste, j’attends plus que quelques beaux plans.
J’attends une richesse scénaristique. J’attends des personnages palpables, dessinés de manière à ce qu’on ait envie de se plonger dans l’écran. J’attends que l’écriture soit au diapason de la réputation du cinéaste, et de ses qualités de metteur en scène. Or Les Herbes Folles n’apporte rien de tout ça. C’est un film maîtrisé visuellement, mais n’ayant aucune consistance. Les personnages sont plats, sans queue ni tête. Le scénario trace des ébauches d’intrigues et de traits qui ne vont jamais nulle part. Jamais, jamais, jamais je ne me suis intéressé à un seul personnage. Ils sont fades, comme écrits sur un coin de table, prétextes à une course dans tous les sens aboutissant au néant le plus total.
Si Resnais a voulu divertir, c’est raté. S’il a voulu raconter quelque chose, c’est raté. S’il a voulu dresser un quelconque portrait de son époque, c’est également raté. La déception fût le seul apport de ces Herbes Folles.
 L’un des films reparti sans prix de la Croisette et qui a plus certainement souffert d’injustice s’intitule A l’origine. Bien sûr il est difficile de juger puisque la version sortie en salle en novembre est différente de celle présentée à Cannes en mai (le film a entre temps été raccourci). Néanmoins, il ne fait aucun doute que François Cluzet n’aurait pas volé un Prix d’interprétation, tant sa composition est saisissante. Le comédien incarne un escroc montant une arnaque dans une commune du nord de la France. Il fait croire à la communauté que la construction de l’autoroute qui avait été interrompue quelques années plus tôt va bientôt reprendre. Au départ, il pense seulement empocher des pots de vin de contractants locaux. Mais peu à peu, l’escroc se prend au jeu et met vraiment en branle les travaux.
L’un des films reparti sans prix de la Croisette et qui a plus certainement souffert d’injustice s’intitule A l’origine. Bien sûr il est difficile de juger puisque la version sortie en salle en novembre est différente de celle présentée à Cannes en mai (le film a entre temps été raccourci). Néanmoins, il ne fait aucun doute que François Cluzet n’aurait pas volé un Prix d’interprétation, tant sa composition est saisissante. Le comédien incarne un escroc montant une arnaque dans une commune du nord de la France. Il fait croire à la communauté que la construction de l’autoroute qui avait été interrompue quelques années plus tôt va bientôt reprendre. Au départ, il pense seulement empocher des pots de vin de contractants locaux. Mais peu à peu, l’escroc se prend au jeu et met vraiment en branle les travaux.Xavier Giannoli semblait se chercher jusqu’ici (Les corps impatients, Quand j’étais chanteur, bof), mais avec A l’origine, l’homme s’est trouvé un sujet lui offrant une carrure de cinéaste impressionnant. Son film fascine par ses deux points de vue. Le premier c’est celui de l’arnaqueur, un mec un peu paumé attirant à la fois la pitié et la sympathie, une figure de bandit un peu minable dont le cinéma aime tant s’amouracher. Le second c’est celui de la communauté, cette petite ville frappée de plein fouet par les maux sociaux actuels, vivotant, attendant le messie pour les sortir de leur marasme quotidien.
Le messie, c’est donc cet escroc, ce mec encore plus paumé qu’eux, en qui ils voient un leader. A l’origine peut se lire comme une parabole religieuse autant que politique, comme l’adoption d’un messie ou d’un leader presque charismatique. L’histoire que nous conte Giannoli, au plus près des visages et des corps, les mains et les yeux dans la bout, en alchimie parfaite avec cette frange de la société, c’est celle d’une population en proie à une situation de crise prête à confier ses vies au premier venu, du moment que celui-ci a une bonne tête et un beau discours. Tout comme Giannoli parvient à nous attirer et nous fasciner de bout en bout, nous contant un récit tellement énorme et pourtant terriblement réaliste.
Il y a parvient car devant sa caméra, homme fatigué et avide, dépassé et ambitieux, pathétique et obsessionnel, il a un comédien en adéquation parfaite avec son personnage, lui donnant corps avec une conviction absolue, François Cluzet. L’acteur nous avait déjà gratifiés il y a deux mois d’une performance remarquable dans Le dernier pour la route. La différence c’est qu’ici, c’est au service d’un film à la hauteur de son talent, et de tous ceux, formidables, qui l’entourent.
Séances de rattrapage à suivre…

