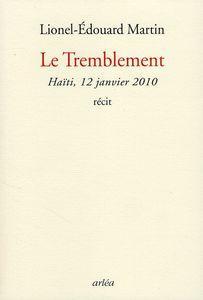&宋体&
Dans le chœur du chaos
« C’est cela, cela seul, le travail de l’écrivain : creuser sa terre, désenfouir le fragment, reconstituer les formes et la mémoire, et taire le fracas du monde. Béla Bartók, mieux que le bruit. » (L’Homme hermétique, L.-E. Martin, Arléa, 2007, p.81)
« Tout homme est bâti sur un gouffre : Padirac en son ventre et l’architecture calcaire de son squelette ; c’est en cela qu’il parle, sa pierre héberge une parole de rivière, aveugle dans l’argile, un chant d’aède sous terre.» (Dire Migrateur, L.-E. Martin, Tarabuste, 2008, p. 41)
Poète, écrivain mais aussi professeur d’université en Martinique, Lionel-Édouard Martin est régulièrement missionné en Haïti depuis plus de 10 ans pour y développer des programmes de coopération. La force, le fourmillement vital inextinguible du pays, la ténacité et la dignité de la population malgré les effroyables tragédies qui s’abattent sur elle avec un acharnement répété, ont nourri son inspiration et marqué de manière persistante son écriture – tel un leitmotiv dans une partition musicale – atteignant souvent le nerf de son phrasé, déchaînant toujours des images d’une beauté sidérante dans son œuvre poétique et narrative.
Qu’il s’agisse de textes comme Ulysse au seuil des îles (2004), Arrimages (2005), Vu en Haïti (2006), Corps de pierre (2007), Dire Migrateur (2008), Miroirs des Jardins tropicaux (2008), lorsque surgit Haïti, le pays apparaît soit comme l’univers de l’énonciation où se façonnent les mots soit comme une réminiscence, un écho à ce qui est vu et vécu si l’écriture se fabrique d’un autre endroit. Haïti, comme une voix à l’ombilic, impressionne la pupille, « (…) prend le regard pour ne plus le quitter », comme il l’écrit dans Vers la Muette (p.132), son dernier roman sorti en mars, en même temps que Le Tremblement, et dont l’histoire se déroule en grande partie dans le Port-au-Prince d’avant le cataclysme. Mais un roman dans lequel on sent sourdre la colère tapie de la terre et l’imprégnation intense que produit la rencontre avec l’île.
Entre l’élaboration de ces deux livres publiés simultanément, un homme a pourtant dû se reconstruire.
Lorsqu’il atterrit en Haïti le 8 janvier dernier dans le cadre de son travail d’enseignant, Lionel-Édouard Martin n’imagine pas encore la portée que prendront a posteriori certaines phrases de ses ouvrages cités plus haut. Des mots aux allures, désormais, de chants prémonitoires… :
« Le grand fouillis de la caillasse roule sur les dévers. Alors on essaie d’endiguer, de retenir ce qui pourrait sombrer. Les murs ont des épaules, cela pousse à la roue ; des murs de pierre, musclés, de longs hauts murs de pierre, d’un calcaire veiné de fougères, incrustés de fossiles. Ils ceignent les rues de part et d’autre, l’encaissement suscite des résonances, on marche dans les échos, la parole, réverbérée, bégaie ; de nuit, les aboiements des chiens se désordonnent bien plus qu’ailleurs ; à l’aube, les cris des coqs répercutés par les moellons. Tout cela se trame, tisse une toile de bruits, à quoi s’ajoute la rumeur constante de la ville parcourue de klaxons, du tremblement des véhicules. C’est une sorte de filet, comme ceux dont on bâche la benne des camions pour maintenir la charge, éviter qu’elle ne vire dans les cahots. Comme ça peut, cela retient. Mais la catastrophe est imminente qui surgira du silence et laissera libre cours à l’effondrement.» (à propos de Port-au-Prince in Corps de pierre, p. 103)
« Les morts remontent, j’interprète, moi qui vois, leur cheminement dans la nature morte. Les morts remontent, l’arbre est leur route vertébrale, chaque masque un bivouac. // Les morts remontent, puissants d’os et d’écorce, de cuir et de sommeil, parleurs muets, mangeurs d’argile ; et le fruit tombe, et boucle par sa chute le cycle interminable.» (Vu en Haïti, in revue Riveneuve Continents)
Le 12 janvier, l’auteur, voyageur invétéré, espèce d’oiseau migrateur toujours en mouvement entre plusieurs pays, va se trouver, lui, homme du ciel, bousculé par une terre en colère, pris dans les secousses d’une Gaïa mugissante. L’ire de la terre s’incarne en de terrifiants spasmes, s’écroulant sur les corps pour faire entendre ses vibratos monstrueux. Lyre de la terre. Musique abominable des tressaillements telluriques qui va choisir pourtant de lui laisser la vie sauve.
Le Tremblement, Haïti 12 janvier 2010 évoque les trois jours qui ont suivi le séisme. Lionel-Édouard Martin a volontairement rejeté l’angle du voyeurisme facile et de la spectacularisation de l’événement. Il leur a préféré un discours, un regard sur la faille intérieure, la fracture de l’être, provoquées par la catastrophe. En se servant de la littérature aussi bien dans le fond que dans la forme, il livre un récit tout en retenue, en sensibilité, en humanité et réussit de manière exceptionnelle à dépasser le stade du simple témoignage.
À travers la secousse des mots que l’écrivain orchestre entre Fort-de-France et le XXe arrondissement de Paris, les journées défilent sur la ligne d’un temps déréglé, où les secondes durent l’éternité. C’est un auteur dans la genèse de son écriture que l’on observe aussi, s’évertuant à remettre de l’ordre dans le chaos d’un monde jeté par terre, à faire appel à des résurgences, des souvenirs pour tenter de donner du sens aux éléments disparates d’un environnement qu’il ne reconnaît plus.
Le texte transpire l’urgence de dire la stupeur et l’engourdissement qui saisissent les corps épargnés par le tremblement de terre. De dire aussi l’impuissance face à la mort démultipliée qui rappelle sa présence aux vivants avec l’implacabilité du balancement d’un métronome et qu’il va falloir apprendre à gérer et à digérer sans y avoir été préparé. On flotte dans une espèce de bulle à travers laquelle se désagrège en même temps qu’il se concrétise aussi, l’extérieur provenant par touches comme dans un tableau impressionniste qui aurait oublié de jeter de la lumière dans sa composition.
« Nous étions plongés dans l’irréalité d’un rêve sans sommeil, où le temps bousculé n’a plus sa durée commune, ni l’environnement ses formes habituelles.» (p.125)
Une échappée se profile lorsque les connexions Internet ou téléphoniques (cordons ombilicaux invisibles mais pourtant bien tangibles ?) tentent de s’agripper à quelques bribes de réseaux aléatoires. Mais il n’est pas si facile de communiquer lorsqu’on se trouve sur une île des morts, au milieu d’un Styx…
Le récit s’organise comme dans une transe. La syntaxe semble imprégnée des pulsations de la terre, pétrie d’ébranlements. Les phrases courtes, saccadées, accidentées par instants, laissent aussi le relai à des moments de respiration où se ménagent alors des questionnements fondamentaux sur la place de l’Homme dans l’univers, sur sa position face aux éléments, sur son existence. Des interrogations qui sont à chaque fois convoquées par des références littéraires subtiles, comme très souvent d’ailleurs dans les écrits de Lionel-Édouard Martin. Pour rester debout, il faut « tuer le temps, discuter de littérature » (p.57). Au delà de la voix des écrivains du festival « Étonnants Voyageurs » avec lesquels il s’est retrouvé sur le terrain de tennis de son hôtel écroulé, ce sont aussi celles de Flaubert, Cicéron, Tertullien, Saint-Exupéry (cet homme du ciel, lui aussi…), Giono, Gailly, Toussaint, Oz…qui arrivent à la conscience et qui aident à donner du sens à une situation où tous les repères aussi bien spatiaux, physiques que psychologiques ont été pulvérisés.
Face à la déstructuration des êtres et des lieux, l’image protéiforme du cercle se répand de manière obsédante à l'intérieur du Tremblement, dans une tentative pour cerner et comprendre le désordre.
La circularité est figurée par l’île tout d’abord, une masse baignant dans une mer/mère, ventre monstrueux en travail dont les contractions écrasent les individus, dans « un accouchement à rebours » (p.49) mais qui, ironiquement, laisse absolument intacts une tasse de porcelaine, un citron, des œufs durs et un verre de bière… Haïti endosse ici le double visage de Janus : une terre à la fois enchanteresse et devenue tout à coup redoutable. Son image se superpose de manière troublante à celle de la divinité romaine associée par Ovide à l’état de confusion chaotique du monde :
« Apprends sans crainte ce que tu désires, chantre laborieux de l'année : ouvre ton esprit à mes discours. On m'appelait Chaos, dans les anciens jours; car je suis chose antique. Vois à quelle époque lointaine remontent mes récits. Cet air lumineux, et les trois autres éléments, le feu, l’eau, la terre, ne formaient qu'une seule masse. Le choc de tant de principes opposés amena leur séparation ; les éléments divisés prirent de nouvelles places. Le feu s'élança dans les régions supérieures; au second rang fut l'air; immobile, la terre avec les eaux se fixa au centre. C'est alors que, cessant d'être une masse informe et grossière, je repris une figure et un corps dignes d'un dieu. Trace légère de la confusion de mon premier état, mes traits maintenant présentent le même aspect par devant et par derrière. Voici une autre cause de cette conformation; en l'apprenant tu connaîtras aussi mon pouvoir. Tout ce que tes yeux embrassent de tous côtés, ciel, mer, nuages, terre, tout se ferme ou s'ouvre à mon gré. Sur moi seul repose la garde de ce vaste univers, et le droit de faire tourner son axe m'appartient tout entier. Lorsqu'à ma voix la paix a quitté son heureux séjour, elle marche sans entrave par des voies toujours unies. Le monde entier sera couvert d'un crêpe funèbre et sanglant, si je cesse de tenir sous la clef les guerres enchaînées. Je préside aux portes de l'Olympe avec les Heures paisibles ; Jupiter même ne peut entrer ni sortir sans moi. De là mon nom de Janus. » (Ovide, Les Fastes, livre I, chant 1er, traduction de Théodose Burette, 1860.)
La forme circulaire se retrouve également dans la zone close, circonscrite, du terrain de tennis où les survivants de l’hôtel Karibé se sont réfugiés. Espace insulaire sécurisant au sein même de l’île, il permet un retrait, une projection dans un retour à l’origine. La mention de la position horizontale, larvaire, embryonnaire, fœtale presque, qui ouvre le récit, nous projette vers un ciel dévoré par les mâchoires des arbres. C’est dans cette trouée céleste qu’il faudra se précipiter, au sortir de l’utérus géant figuré par l’enceinte du cours, mais dans lequel devront s’opérer d’abord une nécessaire transformation, une résurrection à soi. Ce n’est donc pas un hasard si les thématiques de la grossesse, de la venue au monde reviennent inexorablement dans le récit, trouvant leur pendant dans la forme même de celui-ci puisqu’il fonctionne comme une boucle de mots. En effet certains passages sont repris à l’identique dans le dernier tiers du texte, mais remis en perspective pour comprendre la renaissance des êtres, le ren-chairissement des disparus et la manière dont ceux-ci nourrissent et font se relever les vivants dans l’énergie d’un cycle perpétuel. Ce sujet n’est pas très surprenant sous la plume de l’écrivain. S’il atteint l’acmé de son traitement dans Le Tremblement, il constitue un véritable fil d’Ariane dans l’ensemble de son œuvre.
Pour l’auteur, l’acte d’écriture est inséparable de la mise en mouvement du corps menant à sa nécessaire métamorphose. Dans son texte, cela n’est rendu possible, dans le même temps, que par la convocation de rituels rassurants, permise par des objets a priori banals. Ainsi cette « urne » (un terme utilisé pour désigner aussi le contenant des cendres funéraires) à café inespérée, porteuse de réconfort, permet-elle le rattachement avec « l’avant ». Cependant ce détail en apparence anecdotique revêt une symbolique bien plus forte qu’il n’y paraît à première vue. La boisson chaude partagée est évoquée juste après ces propos :
«(…) les morts de longue mémoire, (…) demeurent investis par une forme de vie tant qu’on peut les évoquer, prononcer leur nom. Les morts sont en nous, en nous autres les vivants. Nous les portons comme des enfants » (p.78)
Ce café pris en commun pourrait presque rappeler un cérémonial fréquent dans les veillées funèbres, bien qu’ici l’acte se réalise en matinée. Mais le moment de la journée où l’on se réunit pour évoquer et accompagner les disparus importe peu, après tout: la mort infatigable, elle, n’a pas choisi son heure pour frapper partout, de nuit comme en plein soleil, bousculant la logique du déroulé du temps.
Puisque le texte de Lionel-Édouard Martin s’offre aussi tel un pont jeté vers la Littérature, ce passage en appelle un autre en miroir, issu cette fois d’un roman d’Henri Thomas, Le Promontoire, paru en 1961. Le narrateur, un traducteur coupé du monde dans un village insulaire, consigne son quotidien dans une parole qui semble s’élaborer en même temps que nous la déchiffrons. L’épisode pivot du roman tient tout entier dans la reconstruction par les mots du transport fortuit, par ce narrateur, de la grande cafetière blanche utilisée pendant les veillées funèbres, avec laquelle il se réchauffe et qu’il porte aux habitants de Lormia déjà installés autour de la dépouille de l’aubergiste venant de mourir. Cet événement, dont il ne mesure pas immédiatement la portée, transformera définitivement sa relation aux vivants, aux morts et sa vision de l’existence.
Persistance de l’image du cercle disions-nous. C’est elle aussi qui permet de contenir la souffrance de la perte de l’Autre, non pas pour l’évincer ou la refouler mais bien pour la transcender. Il faut bien accepter cet « enfant, métisse d’apaisement et d’angoisse » (p.98) qui stagne et se fossilise au creux du ventre. L’écrivain apparaît alors ici comme une sorte de Saint-Christophe décliné: un être voyageur, porte-cri de douleur et d’amour aussi, passeur de mots plutôt que de maux. Dire, écrire pour ne pas oublier aussi que « la pire des morts : non pas la mort biologique, celle des organes et du sang, [est](…)cette mort plus insidieuse, plus malsaine : la mort vivante –la mort du cœur. » (p. 99)
Traversé par un souffle poétique indéniable, apanage des œuvres qui marquent profondément les lecteurs, Le Tremblement bouleverse absolument. Loin de se réduire à une simple écriture uniquement cathartique et solitaire, le matériau textuel se modèle, se transforme sous nos yeux comme une glaise et livre, empathique et clairvoyant, toute sa générosité dans une rencontre qui ne peut s'oublier et qui permet aussi à l'auteur d’accéder enfin au repos, au requiem, donc.
« Je chanterai, parce qu’il le faudra, je le sens bien, Le Tremblement de Port-au-Prince, et ce sera, ce chant, mon requiem. Je n’ai rien d’autre à chanter – rien d’autre qu’un requiem. » (p.115)
Irma Vep
Le Tremblement, Haïti 12 janvier 2010 a été chroniqué aussi par le blog littéraire "Le Livraire" ici.