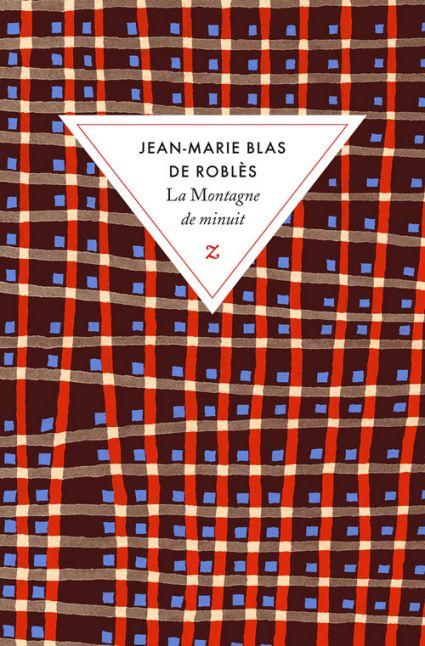
Certains de mes confrères sont parfois curieux. Ils soulignent que deux auteurs connus pour avoir écrit des pavés les années précédentes reviennent en cette rentrée littéraire avec des livres plus courts. Parmi ces deux hommes de lettres, il y a Mathias Enard et Jean-Marie Blas de Roblès.
Cette remarque m'étonne pour deux raisons. D'abord, je ne peux imaginer que les romanciers apprécient de se voir coiffer d'une casquette d'épicier. « Remettez-moi donc un kilo et demi d'histoire ». Ou bien : « Non, non, je suis chargé aujourd'hui, mettez m'en seulement une livre ».
Enfin, ces propos journalistiques sont absurdes si – et c’est parfois le cas -ils font l'assimilation sournoise entre l’épaisseur d'un roman et sa qualité littéraire. En regard de À la recherche du temps perdu de Proust, La métamorphose de Kafka ressemble à une feuille volante. Et pourtant, il ne viendrait à l'esprit de personne de contester, pour des raisons différentes, les très nombreuses vertus de ces deux œuvres.
Petite digression pour arriver au cas qui m'intéresse aujourd'hui : celui de Jean-Marie Blas de Roblès, lauréat du Prix Médicis 2008 pour, vous vous en souvenez sans doute, Là où les tigres sont chez eux, roman qui m'avait emballé et dont j'avais parlé dans ce blog.
Cette année, donc, l'auteur revient avec un livre qui s’intéresse aux rapports entre le réel et la fiction. N'est-ce pas une hérésie de parler de véracité d'un roman ? Rappelons-nous la fameuse controverse qui avait opposé Yannick Haenel et Claude Lanzmann à propos de la figure du résistant polonais Jan Karski.
Cette histoire met en scène plusieurs personnages dont Bastien Lhermine, gardien d'un collège jésuite, à Lyon, sur les hauteurs de Fourvière, sa voisine Rose ainsi que le fils de cette dernière, Paul. En quelques pages, Jean-Marie Blas de Roblès resserre la focale sur ce Bastien, homme énigmatique qui semble trouver refuge dans la lenteur du monde, sa contemplation.
Bastien ne se lassait pas de cette vision, une sorte de mirage dont la beauté culminait avec l'apparition du soleil ; par les belles journées d'hiver, comme celle qui s'annonçait, lorsque son premier rai frappait la masse byzantine de Notre-Dame, blanchissait sa muraille et détachant ses tours crénelées sur le bleu profond du ciel, il transfigurait sa lourdeur de pachyderme renversé.
Le roman a beau être bref, il donne beaucoup à voir. À entendre aussi. On en prend toujours plein les yeux et les oreilles, je trouve, avec Jean-Marie Blas de Roblès. Après la forêt amazonienne, l’auteur nous emmène au Tibet pour des raisons que vous découvrirez seuls.
Les lignes suivantes sont du pur reportage comme j’aimerais en lire plus souvent. On imagine bien l’auteur ancré à son poste d’observation. Chez Jean-Marie Blas de Roblès, j’aime cette dépossession de soi, condition sine qua non pour embrasser la réalité, la digérer et tenter de la restituer le plus fidèlement possible. Il y a beaucoup d’humanisme chez cet écrivain.
Sur le Barkhor, la voie circulaire qui entoure le temple, une foule d'hominiens semble en route vers sa dernière migration. Il y a bien quelques zazous chinois, casquettes de travers, dont l'habit indigo détonne avec le reste, mais surtout des Tibétains descendus des montagnes. Rose écarquille les yeux ; elle discerne ce qu'un surcroît de lumière lui a caché jusqu'à présent. Des Khampas vêtus de peau de mouton retournée, l'épaule droite découverte, avancent fièrement dans la foule. Mêlées à leus longs cheveux ramassés en chignon, des torsades de fils rouge pendent sur le côté. Nodules de corail et de turquoise aux oreilles, on dirait ces clochards célestes grimés d'une crasse fossile que la blancheur des dents éclaire. Les femmes ont le teint cuivré des squaws, elles en ont également les nattes où s'enfilent parfois des kilos de grosses perles rouges et bleues. Elle se poussent en riant, tirent la langue, chahutent entre elles ou avec les hommes. Des sortes d'adultes morveux et rétrécis courent entre leurs jupes. Les Menpus portent des houppelandes en tissu de laine rouge foncé qui laissent voir leurs bottes joliment brodées. Sur les robes, des tabliers striés de bandes colorées font songer aux harmonies du Blaue Reiter : Paul Klee s'y mêle sans se confondre à Macke ou Kandinsky.
Mais revenons à ce Bastien. Qui est-il réellement ? Un passionné ou un calculateur aux multiples zones d’ombres ? C’est là que le roman prend une autre dimension.
Car selon que Bastien est vu avec les yeux de Paul, de sa mère ou de Tom – autre personnage du livre -, la restitution du personnage diffère. Chacun « s’accapare » différemment ce gardien de collège jésuite. L’un ne verra en lui qu’un homme épris de sagesse asiatique. L’autre en fera un portrait plus sombre. Soit parce qu’il a des éléments pouvant l’affirmer, soit parce qu’il extrapole à partir d’une réalité.
Le Bastien trouble nous conduit ainsi à :
des orientalistes passionnés qui œuvraient au sein des Brigades tibétaines de la SS. L'objectif était de contribuer par l'intelligence au renouveau des forces aryennes, d'apporter sa part dans le domaine de la spiritualité. Rien n'était à négliger. Pour ceux-là, pas d'uniforme, nulle autre armure que celle du savoir ; je ne mettrais jamais les pieds sur un champ de bataille.
Plus loin :
C'est en 1935 qu'Heinrich Himmler fonde le Deutsches Ahnenerbe, Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte ou « Héritage des ancêtres, Société pour l'étude de l'histoire des idées premières ». Son objectif est de promouvoir la science de l'histoire intellectuelle ancienne, c'est-à-dire d'accumuler les preuves archéologiques des hauts faits germains depuis le paléolithique. Bref, de reconstituer la mémoire perdue de la race aryenne.
Je suis ressorti interloqué, angoissé à l’idée de ne pas pouvoir trancher, de ne pas accepter la pluralité des points de vue. Comme s’il fallait toujours se déterminer. Je pense que notre pensée cartésienne y est pour beaucoup.
Le roman m’a rappelé un entretien avec Alberto Manguel qui citait Borges. L’illustre écrivain, dont il avait été le lecteur, aurait dit qu’une chose peut être ET ne pas être. En littérature s’entend. N’est-ce pas là le prolongement de la sagesse asiatique ? Cette dernière ne prétend-elle pas, par exemple, que le bouddhisme est à la fois religion et philosophie ?
Je vois dans ce roman un prolongement de cette interrogation.
On peut faire court et poser de grandes questions.

