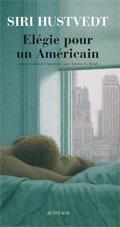
S'il y a au moins une chose qu'on ne peut s'empêcher de faire en lisant un livre de Siri Hustvedt, c'est de comparer. Alors, on se dit, est-ce que ça ressemble à un roman de Paul Auster ? Pas que ça ait la moindre importance en réalité, simplement que c'est humain de se poser la question. Et si la réponse paraissait claire lors de ses deux premières tentatives (en l'occurrence, la réponse de l'époque était non), elle se brouille nettement plus au fil du temps. Tout ce que j'aimais ressemblait déjà par endroit à une fiction austerienne et notre Élégie pour un américain semble dès les premières pages en prendre le tournant. Étrange impression, peut-être due, en partie tout du moins, au fait que l'habituelle narratrice des romans d'Hustevdt se mue à présent en voix masculine. En l'occurrence : Erik Davidsen, psychiatre d'une cinquantaine d'années, divorcé, sur les pas de son père décédé plusieurs mois plus tôt. Un personnage de l'errance qui traverse les destins croisés de sa soeur, de sa nièce, de sa voisine et de son entourage proche et, bien sûr, de ses patients. Un destin a priori très austerien...
Autant le dire d'entrée de jeu : l'intrigue déroute. On sent qu'Hustvedt reprend un peu la même recette que pour Tout ce que j'aimais, à savoir assembler des moments, des situations et des personnages parfois hétéroclites. Cela fonctionnait bien dans ce roman précédent, qui tirait justement sa cohérence de son aspect patchwork. C'est plus délicat dans The Sorrows of an American qui vire parfois à l'inégalité, puisqu'il arrive qu'on se perde dans des entrelacements souvent hétérogènes. Cela ne gène que rarement le plaisir de lecture en revanche, puisque le narrateur canalise en lui tous les enjeux de l'intrigue. On suit alors avec plaisir l'avancement de ce que j'aurais envie d'appeler un « scénario », un peu à la manière de AM. Homes dans le très plaisant This Book Will Save Your Life, chroniqué l'année dernière.
Parler de scénario n'est par ailleurs pas trop éloigné de la réalité du livre : de cinéma il en est question, par l'intermédiaire du personnage de Max Blaustein, marié à la soeur du narrateur, mais décédé depuis plusieurs années. Blaustein : écrivain à succès qui s'essaye parfois à l'écriture de scénario de films. Mouais, pense-t-on. L'ombre de Paul Auster plane de plus en plus sur le livre et le malaise devient parfois pesant, notamment lorsque la veuve de Blaustein déclare en substance que depuis la mort de son mari, leurs anciens amis ne la reconnaissent plus et ne lui accordent plus le moindre intérêt. Mise en fiction ou peurs légitimes de l'autrice, je ne sais pas, mais on ne peut s'empêcher de se poser la question et de voir l'ombre d'un « roman à clef » (à prononcer avec l'accent américain) se dessiner entre les mots, entre les phrases.
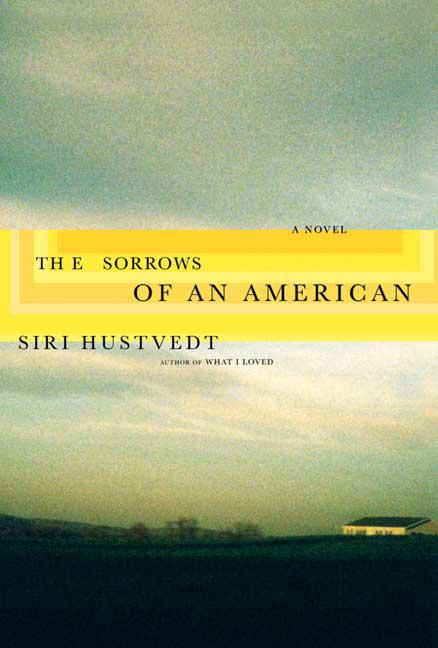
Les déambulations du narrateur sont pour autant agréables à suivre (malgré quelques faiblesses de scénario, justement). De part son métier, il est quotidiennement amené à trifouiller dans l'intimité des gens qu'il croise (qu'il s'agisse de ses patients ou non par ailleurs), à dépister le sens, à interpréter les signes, à traquer les problème, à les reconnaître également. Et via cette confrontation permanente, on le sent rapidement basculer au devant de ses propres démons personnels. Chaque échange avec l'autre se change alors en fragment de sa thérapie privé. Ce rapport là au moi et au vide qui l'entoure est bien appréhendé. C'est ce qui fait tenir le lecteur, c'est ce qui donne du liant au roman.
Les « à-côté », en revanche, virent parfois à l'anecdotique. Certains personnages semblent transparents ou sous exploité (alors que What I Loved excellait justement dans l'exactitude de ses personnages secondaires). C'est d'autant plus dommage qu'on a l'intime conviction, en parcourant ces trois cent et quelques pages, que le livre passe à côté de quelque chose.
Je ne saurai d'ailleurs pas quel passage joindre à cette chronique ; aucun en particulier ne m'a sauté aux yeux pendant ma lecture (ce qui est rare). Certains rêves retranscris par le narrateur peuvent bien devenir intéressants, mais ils ne se déclenchent que timidement. D'autres scènes sont agréables, mais ne déclenchent aucun enthousiasme en particulier. C'est la raison pour laquelle je ne citerai rien entre ces lignes.
Ma chronique est sévère, je m'en rends compte en l'écrivant. Étrange, puisque ma lecture n'était pas désagréable ou ennuyeuse, loin de là. J'ai pris du plaisir à suivre les errances d'Erik Davidsen, j'ai agréablement été porté par les détours qu'il empreinte ou les évènements qu'il subit. Mais ce roman ne prolonge pas la bonne qualité de Tout ce que j'aimais. Un roman plaisant mais trop inégal pour véritablement séduire. Dans les mêmes thématiques (et chez le même éditeur) du deuil, de poids du secret familial et de l'émigration, je lui préfère largement l'excellent Lignes de faille de Nancy Huston.
[Article également disponible sur Culturopoing]
