Je m'assieds à la table de la cuisine, blanc beige beige blanc c'est machinal, encore, décompter les carreaux de faïence au-dessus de l'évier. Moi assise là dans l'odeur du lait tiède, le matin, coudes collant à la toile cirée, les yeux à refaire le décompte, encore une fois, horizontalement blanc beige beige blanc puis de nouveau blanc beige beige beige. Percer le sens de cette suite logique.
Lise Benincà, Balayer fermer partir, Déplacements Seuil, P.9.
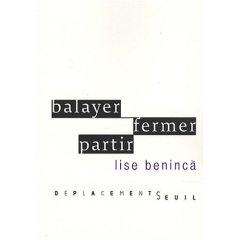
Le premier paragraphe du livre est relativement représentatif du texte en son ensemble. Durant le parcours (souvent figé, rarement dynamique) de la narratrice, on s'enfonce lentement dans le labyrinthe de l'espace. L'espace intérieur surtout : comment explorer les pièces successives d'un appartement que l'on hante et celles enfouies d'une maison qui nous hante. Ce regard que porte la narratrice sur l'espace qui l'entoure est principalement motivé par un événement majeur : la mort du père. L'héritage et la vente de la maison paternelle. Et avec ça, une plongée répulsive dans quelques souvenirs qui tapissent les murs, qui coulent depuis l'appartement du dessus, qu'on subit plus qu'on provoque.
Le téléphone se met justement à sonner. La vie reprend son cours. Je me dépêche de tourner la clé, je jette mon sac dans le noir, je cours jusqu'au combiné. Au bout du fil d'un autre téléphone, ma soeur dit : Maintenant je me mets à y penser. J'avais caché un sac en tissu dans la cabane à outils, avec des objets dedans. Tu crois qu'il y est toujours ? Je ne peux pas m'empêcher d'y penser.La langue est concise, elle cisèle les gestes, souvenirs, pensées. La narratrice flotte contre le texte comme un ectoplasme. On ne décèle pas réellement de personnalité sinon un vertige qui se manifeste de temps à autre. On n'est parfois gêné par cette froideur permanente qui en découle. Je suis parfois gêné. Pourtant la langue est terriblement juste, précise, essentielle. Jamais abstraite. Mais parfois tellement distante qu'on en perd un peu le contact. Que j'en perds le contact. Il me manque ce petit quelque chose qui me séduit bien plus, par exemple, dans les livres d'Emmanuelle Pagano. Me manque le personnage. Pourtant la narration coule juste. On la sent se plaquer contre les lieux qu'elle habite, attirer vers elle les (rares) paroles qui seraient susceptibles de la déséquilibrer (pas de dialogue en tant que tel, par exemple, mais des répliques isolées, absorbées par la narration). Par ce biais, le texte apparaît donc comme cohérent, limpide, évident.
Je raccroche lentement. Je m'applique à penser à autre chose. Je résiste aux assauts. On n'est pas obligé de se sentir concerné.
J'essaye de reconstruire mentalement certains moments, jusqu'à mon installation dans cet appartement, jusqu'à mon corps assis au rebord du lit. La matérialité des heures de travail, oui, je la perçois. Une valeur sûre. Des journées. Cinq jours de travail. La mort de mon père, certainement. Sa maison. J'ai contacté une agence, je leur ai demandé d'aller eux-mêmes faire un état des lieux. Un brocanteur va venir la vider de tout ce qu'elle contient. Je ne toucherai à rien. Je ne veux pas ouvrir les tiroirs. Je ne veux pas gravir les marches qui montent à l'étage, entrer dans les chambres, voir ce qu'il en reste. Ses affaires seront éparpillées. Celles qui ont de la valeur vendues, les autres jetées. L'estimation du brocanteur est dérisoire, évidemment. Je m'en moque, qu'il fasse son affaire. J'ai regardé sur le site Internet de l'agence, la maison vient d'être mise en vente. Il y a un descriptif qui en vante l'emplacement, la fonctionnalité, l'état de suite habitable, quatre photos mal cadrées. Sur l'une d'elles on voit le tilleul derrière lequel se dissimule la fenêtre de ma chambre. Je ramassais ses feuilles comme une aile pour les laisser tomber en tourbillonnant depuis la fenêtre. En bas, ma soeur courait dans tous les sens pour les rattraper.
Elle a dit : Dans le sac en tissu, je ne me souviens plus de tout ce qu'il y a. J'imagine les choses.
Elle ne m'a pas demandé d'y retourner. Je ne l'ai pas proposé. Je ne vais pas aller déterrer les souvenirs. Je ne déterrerai rien. Je ne toucherai à rien. Je n'ouvrirai pas les tiroirs. Je ne monterai pas les marches qui mènent à l'étage.
Ibid., P. 48-50.
A quoi tient le souvenir d'un lieu ? dit la quatrième de couverture. Cette question seule flotte, décentrée, sur le blanc du livre au verso. A l'autre bout, une citation de Georges Perec tient le rôle d'épigraphe. L'ombre de Pérec, on la retrouve dans la quasi totalité du livre. Parfois cité directement, parfois simplement apparent, muet. Parfois trop ; en tant que lecteur, je n'aime pas toujours qu'un auteur me montre ses références en permanence. Mais la démarche est logique, c'est presque un prolongement de. Mais les références sont multiples, parmi lesquelles un passage déjà cité sur le blog il y a de cela quelques semaines seulement. Et si la démarche est logique, le rôle de la postface, relativement conséquente, qui vient compléter le livre, me paraît, lui, plus contestable. Tout du moins : je ne le comprends pas. Mais c'est une broutille.
Balayer fermer partir est le premier livre de la collection Déplacements au Seuil que je découvre. J'ai longtemps tourné autour de cette collection sans jamais franchir le pas. C'est désormais chose faite.
Balayer fermer partir est un texte fort, incisif, à la langue agréable, mais quelque part cette froideur dont je parlais plus haut m'a tenu à distance, m'a empêché de véritablement m'y fondre. Dommage, parce que j'ai tout de même eu le temps, au travers de ces cent pages, d'entrevoir une issue qui me plaisait. Je suis resté sur le seuil.
Au-delà :
- La présentation de la dernière fournée Déplacements sur le Tiers Livre
- La page de Libr-critique
- Un extrait cité sur Lignes de fuite
- Un autre extrait, à lire dans le jardin maternel
[Article également disponible sur Culturopoing]
