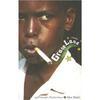« Elle non plus ne connaissait pas le mot «génocide», mais en Kinyarwanda il y avait depuis longtemps un mot pour désigner ce qui se passait chez elle, gutsembatsemba, un verbe qui était employé à propos des parasites et des chiens enragés qu’il fallait éradiquer et qui s’appliquait aux Tutsi qu’on appelait justement les Inyenzi, les cafards, et qui étaient, eux aussi, à éliminer. » p. 101, Le deuil.
Chaque phrase, chaque mot composant les cinq nouvelles de ce recueil, L’Iguifou, nouvelles rwandaises, empoigne notre cœur aux battements saccadés par l’angoisse, amène un trop plein de sang qui fait bourdonner nos oreilles de plaintes venant d’un petit pays, le Rwanda, où le peuple tutsi est massacré. Rien de plus logique, pied de nez fait aux assassins, qu’une rescapée à la plume faite de retenue et de sobriété poétique écrive ce qu’elle a vécu lors de ces années d’apocalypse, et que ses cinq sens continuent à vivre en dépit du temps qui s’écoule. Scholastique Mukasonga est née en 1956, dans la province de Gikongoro, dans le sud-ouest du Rwanda. Elle appartient aux Tutsis que les Hutus veulent définitivement éliminer lors du génocide, en 1994, programmé par le président Kayibanda. Plus de 800 000 mort seront décomptés. Parmi les victimes, la plus grande partie de sa famille, environ 37 personnes. Avant le massacre, elle et les siens seront déportés et parqués dans une réserve à Tutsi, Nyamata, où la faim, l’iguifou, et la peur, seront les compagnes assassines du quotidien. Scholastique Mukasonga aura la chance de se réfugier dans le Burundi voisin en 1973, puis à Djibouti et enfin en France. Pour l’auteur, écrire, c’est témoigner et ainsi faire vivre dans les mémoires le souvenir des assassinés jetés dans les anonymes fausses communes. Rien de plus opportun à cela que de nommer les victimes, de rappeler leur histoire et ainsi de leur rendre leur personne. Il en va de ce jeune pâtre, Kalissa, qui, dans La gloire de la vache, se rappelle ses sept ans, âge où enfin il eut l’honneur de rejoindre son père dans le travail auprès des vaches et de devenir avec cette initiation un homme, un authentique Tutsi. Que dire de la fierté de son père et des siens ne pouvant vivre que parmi ses déesses, les vaches, sur lesquelles est fondée leur culture ? Une culture que les barbares ont voulu tuer à jamais en leur interdisant tout élevage excepté celui des chèvres, entreprise dégradante pour tout Tutsi se respectant. Toujours identifier les victimes, travail nécessaire pour personnaliser l’inimaginable : il en va de la belle Nyamata dans la nouvelle, Le malheur d’être belle. Terrible singularité en effet que la beauté pour une Tutsi par ces temps de malheurs : ne pouvant ni travailler à cause des mesures discriminatoires, ni se marier - la beauté rendant la dot pour un Tutsi bien trop lourde à payer alors que pour un Hutu épouser une Tutsi est inimaginable -, il ne lui reste plus que la prostitution qui des palais la conduit aux gargotes où l’infortune est compagne du sida. Scholastique Mukasonga n’oublie pas non plus dans son témoignage deux autres personnages criminels, bêtes féroces du quotidien infernal : la faim et la peur. L’iguifou – la faim – est cette tumeur maligne se faisant partenaire abrutissante d’une mort presque salvatrice. Et que dire de la peur de chaque instant de voir les tueurs arriver munis de leur machette pour accomplir leur promesse, les tuer ! Toujours être prêt dès lors à fuir au plus vite dans la brousse… mais pour aller où ? Maintenant que le crime a eu lieu, le devoir de deuil s’apparente au devoir de mémoire. Dans la dernière nouvelle, Le deuil, l’auteur se rend sur les lieux du génocide, pèlerinage indispensable pour honorer les siens mais aussi pour faire taire ce sentiment douloureux, le remords d’avoir survécu. L’oubli ne se fera jamais tant que Scholastique Mukasonga continuera à écrire : témoigner toujours témoigner pour que les victimes continuent à vivre ; que jamais ne puissent se faire entendre ces mots :
« Un jour, un enfant demanderait à sa mère : Dis-moi, maman, qui étaient ces Tutsi dont j’ai entendu parler ? A quoi pouvaient-ils bien ressembler ? _ Ce n’était rien, mon fils, répondrait sa mère, ce n’était qu’une légende. », p. 101, Le deuil.
Dans un style volontairement simple, dépouillé, où pudeur rime avec recueillement et veillée des siens, L’Iguifou, nouvelles rwandaises fait partie de ces écrits où le lecteur se fait le témoin de la douleur des rescapés et dans les limites qui s’imposent, la partage. Voici un livre grave à lire et à relire.
Mukasonga Scholastique, L’Iguifou, nouvelles rwandaises, Continents Noirs, Gallimard, 2010, 122 p
 « Elle non plus ne connaissait pas le mot «génocide», mais en Kinyarwanda il y avait depuis longtemps un mot pour désigner ce qui se passait chez elle, gutsembatsemba, un verbe qui était employé à propos des parasites et des chiens enragés qu’il fallait éradiquer et qui s’appliquait aux Tutsi qu’on appelait justement les Inyenzi, les cafards, et qui étaient, eux aussi, à éliminer. » p. 101, Le deuil.
« Elle non plus ne connaissait pas le mot «génocide», mais en Kinyarwanda il y avait depuis longtemps un mot pour désigner ce qui se passait chez elle, gutsembatsemba, un verbe qui était employé à propos des parasites et des chiens enragés qu’il fallait éradiquer et qui s’appliquait aux Tutsi qu’on appelait justement les Inyenzi, les cafards, et qui étaient, eux aussi, à éliminer. » p. 101, Le deuil.