 C'est un passage du dernier Houellebecq, la Carte et le Territoire, qui m'a mis la puce à l'oreille. Un passage absolument passé sous silence par les pléthoriques critiques de ce dernier opus de l'enfin Prix Goncourt. Et pour cause, il ne prend que quelques lignes du roman et ne recèle pas beaucoup d'intérêt dans la construction de l'histoire (ainsi que la 3ème partie du livre, mais ceci est un autre débat). Jed, le héros, se trouve dans un aéroport et voici que… « Devant lui, un blondinet d'environ quatre ans geignait, réclamant on ne savait trop quoi, puis d'un seul coup il se jeta à terre en hurlant, tremblant de rage ; sa mère échangea un regard épuisé avec son mari, qui tenta de relever la vicieuse petite charogne. Il est impossible d'écrire un roman, lui avait dit Houellebecq la veille, pour la même raison qu'il est impossible de vivre : en raison des pesanteurs qui s'accumulent. Et toutes les théories de la liberté, de Gide à Sartre, ne sont que des immoralismes conçus par des célibataires irresponsables. Comme moi, avait-il ajouté en attaquant sa troisième bouteille de vin chilien. »Tiens, voilà un point de vue intéressant : pour bien philosopher, pour être un héraut de la littérature, faut-il demeurer célibataire et sans enfants ? Auquel cas, on se trouverait confronté ici à un irréconciliable fossé entre philosophie et judaïsme, puisque le premier commandement biblique exprimé par la Thora est le fameux « Perou Ourbou » : croissez et multipliez.
C'est un passage du dernier Houellebecq, la Carte et le Territoire, qui m'a mis la puce à l'oreille. Un passage absolument passé sous silence par les pléthoriques critiques de ce dernier opus de l'enfin Prix Goncourt. Et pour cause, il ne prend que quelques lignes du roman et ne recèle pas beaucoup d'intérêt dans la construction de l'histoire (ainsi que la 3ème partie du livre, mais ceci est un autre débat). Jed, le héros, se trouve dans un aéroport et voici que… « Devant lui, un blondinet d'environ quatre ans geignait, réclamant on ne savait trop quoi, puis d'un seul coup il se jeta à terre en hurlant, tremblant de rage ; sa mère échangea un regard épuisé avec son mari, qui tenta de relever la vicieuse petite charogne. Il est impossible d'écrire un roman, lui avait dit Houellebecq la veille, pour la même raison qu'il est impossible de vivre : en raison des pesanteurs qui s'accumulent. Et toutes les théories de la liberté, de Gide à Sartre, ne sont que des immoralismes conçus par des célibataires irresponsables. Comme moi, avait-il ajouté en attaquant sa troisième bouteille de vin chilien. »Tiens, voilà un point de vue intéressant : pour bien philosopher, pour être un héraut de la littérature, faut-il demeurer célibataire et sans enfants ? Auquel cas, on se trouverait confronté ici à un irréconciliable fossé entre philosophie et judaïsme, puisque le premier commandement biblique exprimé par la Thora est le fameux « Perou Ourbou » : croissez et multipliez. Commençons l'enquête par expliciter ce que dit Houellebecq : pour créer une œuvre intellectuelle digne de ce nom, il faut pouvoir être maître de son emploi du temps. Il faut pouvoir se dégager un maximum des contraintes matérielles pour faire évoluer son esprit dans un monde d'intellect, pouvoir être ouvert aux rencontres impromptues et se laisser guider par elles et ne pas laisser perturber la construction laborieuse d'un système conceptuel par un recours trivial aux objections émises par le quotidien : « Msieur le Philosophe, comment peut-on parler d'engagement et de liberté quand on doit s'occuper des gosses toute la journée et qu'on est ravi de pouvoir s'affaler sur un canapé devant un bon film avant d'aller dormir ? »
Pour approfondir, et comme nous sommes au XXIème siècle, siècle de la performance et du traitement optimum de l'information, il nous faut des statistiques pour étayer notre thèse. D'abord, rejeter l'objection selon laquelle notre objet d'enquête serait un partage entre la philosophie et la religion de manière générale. L'attitude du catholicisme romain par exemple tient plus de l'attitude philosophique que du judaïsme : pour pouvoir correctement évoluer dans les sphères spirituelles et s'attacher au Seigneur, mieux vaut lui vouer un culte exclusif sans s'encombrer ni de femmes ni d'enfants (officiels bien sûr). Il ne s'agit pas d'un dogme théologique (puisque les Eglises d'Orient ordonnent des prêtres mariés) mais d'un principe bien constitué et sur lequel le Vatican ne semble pas pouvoir renoncer, d'autant que le programme est déjà annoncé par l'Evangile de Luc : « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple ».(la différence avec l'Islam est plus subtile mais mériterait un développement séparé).
 Ensuite, aller voir la presse philosophique people pour vérifier si les philosophes en général sont bien comme le pense Houellebecq des « célibataires irresponsables ». Ca tombe bien, une des dernières moutures de Philosophie Magazine est consacrée plus ou moins à ce thème : « La famille est-elle insupportable ?». Et entre autres contributions brillantes, le magazine a fait l'exercice pour nous. Le résultat est édifiant : 75% des plus grands philosophes du patrimoine de l'humanité étaient célibataires ! Et pour ceux qui se sont finalement mariés, la plupart (comme Hegel) l'ont été tardivement. Certains philosophes ont défendu l'institution du mariage et de la famille, comme Voltaire ou Kant, mais se sont bien gardés de s'encombrer avec de telles futilités.
Ensuite, aller voir la presse philosophique people pour vérifier si les philosophes en général sont bien comme le pense Houellebecq des « célibataires irresponsables ». Ca tombe bien, une des dernières moutures de Philosophie Magazine est consacrée plus ou moins à ce thème : « La famille est-elle insupportable ?». Et entre autres contributions brillantes, le magazine a fait l'exercice pour nous. Le résultat est édifiant : 75% des plus grands philosophes du patrimoine de l'humanité étaient célibataires ! Et pour ceux qui se sont finalement mariés, la plupart (comme Hegel) l'ont été tardivement. Certains philosophes ont défendu l'institution du mariage et de la famille, comme Voltaire ou Kant, mais se sont bien gardés de s'encombrer avec de telles futilités. Il semble donc s'agir d'un invariant, comme le pose Mathilde Lequin dans son article sur les liens entre philosophes et famille : « Des Grecs à l'après-68 en passant par la chrétienté, le constat semble quasi unanime parmi les philosophes : la famille est ce qui empêche la vie authentique ».
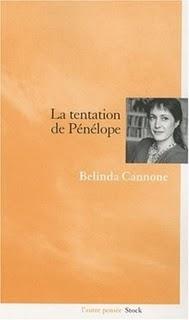 Il n'est pas anodin qu'on retrouve cette pensée dans les développements les plus contemporains. Je viens de finir un essai à la fois brillant et presque terrifiant de Belinda Cannone, qui a fait grand bruit chez les universitaires et les spécialistes des « Gender Studies », vous savez cette nouvelle discipline importée des Etats-Unis par Judith Butler (je vous laisse deviner ses origines….) consistant à séparer la notion de sexe (qui est une distinction biologique) et la notion de genre (masculin/féminin, qui est une notion sociale et construite). Jusque là pourquoi pas, sauf qu'évidemment, à partir du moment où on fait cette distinction, la tentation prométhéenne de détruire la notion de genre ou de les fusionner est trop forte. C'est en partie donc ces sujets qu'aborde Belinda Cannone dans La tentation de Pénélope. En résumé (très bref, parce que le livre est dense et franchement intelligent), elle veut contrer les hommes mais aussi les femmes qui considèrent encore, y compris dans certains milieux féministes, qu'il existe des différences irréductibles entre l'homme et la femme qui doivent se traduire dans la vie sociale. Ce qui m'a personnellement horrifié dans ce bouquin, c'est l'angle mort. Nulle part on n'y trouve l'idée de responsabilité envers la société. Nulle part, Belinda Cannone n'envisage qu'une modification radicale de la perception des genres puisse entraîner des conséquences extrêmement dangereuses pour l'évolution de l'humanité. C'est d'autant plus frappant que l'auteur(e ?) parle longuement de sa situation intime personnelle. Et qu'apprend-on ? Que depuis très tôt, elle a fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Pour quelle raison ? Parce que cela allait l'empêcher d'écrire. Parce que les pesanteurs du quotidien allaient forcément réduire à presque néant la nécessaire quantité de concentration indispensable pour l'œuvre future. Exactement ce qu'explique Houellebecq. Peut-on prendre au sérieux une pensée voulant se projeter dans le futur de l'humanité tout en ne voulant pas participer intimement de cet avenir ? C'est peut-être une des questions cruciales que le judaïsme peut objecter à la philosophie, ou plutôt, aux philosophes.
Il n'est pas anodin qu'on retrouve cette pensée dans les développements les plus contemporains. Je viens de finir un essai à la fois brillant et presque terrifiant de Belinda Cannone, qui a fait grand bruit chez les universitaires et les spécialistes des « Gender Studies », vous savez cette nouvelle discipline importée des Etats-Unis par Judith Butler (je vous laisse deviner ses origines….) consistant à séparer la notion de sexe (qui est une distinction biologique) et la notion de genre (masculin/féminin, qui est une notion sociale et construite). Jusque là pourquoi pas, sauf qu'évidemment, à partir du moment où on fait cette distinction, la tentation prométhéenne de détruire la notion de genre ou de les fusionner est trop forte. C'est en partie donc ces sujets qu'aborde Belinda Cannone dans La tentation de Pénélope. En résumé (très bref, parce que le livre est dense et franchement intelligent), elle veut contrer les hommes mais aussi les femmes qui considèrent encore, y compris dans certains milieux féministes, qu'il existe des différences irréductibles entre l'homme et la femme qui doivent se traduire dans la vie sociale. Ce qui m'a personnellement horrifié dans ce bouquin, c'est l'angle mort. Nulle part on n'y trouve l'idée de responsabilité envers la société. Nulle part, Belinda Cannone n'envisage qu'une modification radicale de la perception des genres puisse entraîner des conséquences extrêmement dangereuses pour l'évolution de l'humanité. C'est d'autant plus frappant que l'auteur(e ?) parle longuement de sa situation intime personnelle. Et qu'apprend-on ? Que depuis très tôt, elle a fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Pour quelle raison ? Parce que cela allait l'empêcher d'écrire. Parce que les pesanteurs du quotidien allaient forcément réduire à presque néant la nécessaire quantité de concentration indispensable pour l'œuvre future. Exactement ce qu'explique Houellebecq. Peut-on prendre au sérieux une pensée voulant se projeter dans le futur de l'humanité tout en ne voulant pas participer intimement de cet avenir ? C'est peut-être une des questions cruciales que le judaïsme peut objecter à la philosophie, ou plutôt, aux philosophes. 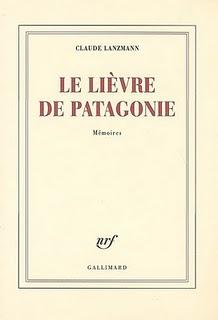 Dans un autre style et pour se rapprocher progressivement du judaïsme, il est aussi notable de constater que Claude Lanzmann, dans ses magnifiques Mémoires (Le lièvre de Patagonie), s'il avoue avoir eu de nombreuses femmes dans sa vie, s'il admet également s'être marié, n'a finalement jamais eu d'enfants. Il ne s'en explique pas vraiment. Mais la question est légitime : aurait-il réalisé l'œuvre de sa vie s'il avait eu à s'occuper d'enfants ? Shoah aurait-il vu le jour si l'inquiétude de mourir qu'amplifie forcément la parentalité avait happé Lanzmann au quotidien ?Même si la réponse à cette dernière question est négative, il semble que la tradition juive pose l'exact inverse de ce que prônent les philosophes : un homme n'est complet que s'il a trouvé une femme. Parce que l'union avec une femme est la condition indispensable à l'atteinte d'une forme de plénitude spirituelle. C'est un thème qui traverse tout la littérature rabbinique, qu'elle soit midrachique, halakhique ou même (ou plutôt surtout) kabbalistique. Et bien entendu, même si la relation homme-femme n'est pas limitée par la procréation, elle contient absolument cet impératif. Avoir des enfants est donc le premier commandement biblique et d'autres commandements « collatéraux » s'y rattachent : la circoncision (Brit-Mila), l'étude, enseigner un métier, voire la natation (si, si).
Dans un autre style et pour se rapprocher progressivement du judaïsme, il est aussi notable de constater que Claude Lanzmann, dans ses magnifiques Mémoires (Le lièvre de Patagonie), s'il avoue avoir eu de nombreuses femmes dans sa vie, s'il admet également s'être marié, n'a finalement jamais eu d'enfants. Il ne s'en explique pas vraiment. Mais la question est légitime : aurait-il réalisé l'œuvre de sa vie s'il avait eu à s'occuper d'enfants ? Shoah aurait-il vu le jour si l'inquiétude de mourir qu'amplifie forcément la parentalité avait happé Lanzmann au quotidien ?Même si la réponse à cette dernière question est négative, il semble que la tradition juive pose l'exact inverse de ce que prônent les philosophes : un homme n'est complet que s'il a trouvé une femme. Parce que l'union avec une femme est la condition indispensable à l'atteinte d'une forme de plénitude spirituelle. C'est un thème qui traverse tout la littérature rabbinique, qu'elle soit midrachique, halakhique ou même (ou plutôt surtout) kabbalistique. Et bien entendu, même si la relation homme-femme n'est pas limitée par la procréation, elle contient absolument cet impératif. Avoir des enfants est donc le premier commandement biblique et d'autres commandements « collatéraux » s'y rattachent : la circoncision (Brit-Mila), l'étude, enseigner un métier, voire la natation (si, si).A première vue, on pourrait se féliciter de la position juive : plus proche des contingences matérielles, c'est une spiritualité qui ne fait jamais l'impasse sur les contraintes de la vie mais au contraire qui cherche à les sublimer. L'ascétisme, s'il existe dans le judaïsme, n'a pas bonne presse. La Thora s'en méfie, comme elle se méfie de ces volontés d'atteindre une forme de pureté absolue dans le service divin. Elle préfère ne pas se laisser duper par l'hypocrisie consistant à se croire au-dessus des problèmes de factures, de business ou d'entente familiale. De nombreuses blagues juives sont en fait des variations sur ce thème central. Encore une fois, on pourrait arrêter là et se féliciter d'appartenir à une tradition qui nous permet (pardon, qui nous oblige !) à manger du couscous boulettes tous les vendredi soirs plutôt que de se flageller tous les matins avec un martinet en acier traité.
Mais si l'on se veut cohérent et prendre au sérieux la position philosophique, il faut reconnaître que le mode de vie juif n'est pas propice à la création d'une grande œuvre. C'est d'ailleurs une remarque que j'ai souvent entendue : les Juifs ont certainement fait avancer la science, ils ont plein de prix Nobel, mais la plupart sont en fait des Juifs assimilés ou s'étant sensiblement éloignés de la tradition juive. Einstein, Freud, Spinoza, Marx, sans parler de Jésus n'habitaient ni Méa Shéarim, Bné Brak ou même Meknès.
Sans vouloir répondre définitivement à cette vaste question (d'abord j'en serais incapable et ensuite il faut que je m'occupe de 3 gosses tous excités en cette période de vacances scolaires, sans compter ma femme qui veut obstinément que je fasse la vaisselle, bref j'ai aucune chance d'être philosophe), je proposerais bien une piste : le judaïsme ne cherche pas à ce que l'homme produise une œuvre. Qui dit œuvre, dit un ensemble finalisé, un aboutissement, un système. Parfois ce système est tellement brillant qu'on le dit inadapté à la vie prosaïque de l'homme (c'est la fameuse formule de Péguy : le kantisme a les mains purs, mais il n'a pas de main). Or, la Thora ne cherche pas à systématiser (le Talmud en est un exemple évident) et préfère mettre l'accent sur la dynamique de l'Etude. Sur ce que celle-ci provoque de façon existentielle chez l'homme, de ce qu'elle éveille de façon spécifique chez chacun de ses acteurs, surtout lorsque ceux-ci sont au moins deux à « réveiller » un texte, chacun avec son histoire et sa subjectivité. Que parfois, une étude soit stérile du point de vue utilitaire (question rituelle : « pourquoi étudier un passage bizarre comparant les 4 types de mises à mort possibles ? »), c'est une évidence. Et pourtant, ce qui a perduré pendant des siècles chez les Juifs, c'est cette Etude pharisienne. Dont on peut légitimement penser que d'un strict point de vue matérialiste, elle n'est pas étrangère à la destinée du peuple Juif, ni à ce qu'ont produit ses fruits les plus éloignés rappelés plus haut. Mais le cœur du peuple juif n'avait pas vocation à créer une œuvre. Il devait vivre selon des modalités définies par une transcendance qui ne se soucie ni d'Histoire, ni de Progrès, ni de Science, uniquement pour qu'un homme, sa famille et son peuple puisse accomplir une forme de projet divin qui passe par une sensibilité particulière à l'intériorité de chacun, révélée par l'Etude et une forme d'orthopraxie.
Je ne pourrais cependant pas finir ce post sans mentionner que la Thora est pleinement consciente de ce paradoxe : la famille permet de vivre mais elle est parfois inhibitrice quant à la grandeur d'une œuvre.
Deux exemples :1) La Michna raconte que Ben Azzaï, un temps marié avec la fille de Rabbi Akiva, n'a pu assumer cette charge. Il préférait en effet se consacrer corps et âme à l'étude de la Thora. Ce qui n'était pas compatible avec une charge de famille. Complètement contraire au message divin ? Certes, mais le reproche fait à Ben Azzaï n'est finalement pas catégorique. Rabbi Akiva lui-même a délaissé sa femme pendant plusieurs années pour aller étudier la Thora alors même que c'est elle qui l'a poussé à l'étude et à devenir le Maître qu'il est ensuite devenu.2) L'épisode de Bamidbar (Les Nombres) où Myriam attrape la maladie appelée Tzaraat. Le texte littéral nous dit que cette punition est due à certains mots malheureux qu'elle aurait prononcés à propos de la femme éthiopienne de Moïse, Tzipora. Le grand commentateur devant l'Unesco qu'est Marek Halter y a trouvé la première trace de racisme anti-black et a fait comme si Dieu avait accroché un badge Touche pas à mon pote pour défendre Tzipora (par pitié, arrêtez de lire Marek Halter, vous ferez une grande Mitzva). Les Sages de la Tradition orale nous enseignent autre chose. Myriam aurait en fait médit sur son frère Moïse. Celui-ci, monopolisé par sa fonction de leader du peuple juif, aurait délaissé son épouse, ce qui provoqua les reproches de Myriam. Ce qui est étonnant, c'est que non seulement Dieu ne reproche rien de tel à Moïse, mais en plus il punit Myriam pour ce geste. Moïse, le plus grand prophète du peuple juif, qui délaisse son épouse et dont le midrach nous rapporte que ses enfants n'ont pas très bien tourné…Certains destins peuvent-ils se passer d'une femme et d'enfants ? Faut-il systématiser et trouver une réponse ou laisser la question ouverte ?
