 Présenté sans mention précise de genre sur la couverture ou la page de titre, on trouvera tout de même dans la critique les qualificatifs allant de roman à essai-récit — car il a fallu que je fouine avec ténacité les entrailles du net pour en savoir plus sur ce surprenant poète, essayiste, traducteur, linguiste né en 1961 à Santiago au Chili et découvert, discret, au bas d'une étagère de la 14e Feria del Libro de La Paz en 2009. El entrevero excède toute loi possible de genre ou catégorie pour élaborer son propre espace, tant géographique que linguistique, sans parler d'un temps propre, de la langue et de l'écriture (donc de la pensée) qui, problème essentiel de El entrevero, est justement lié aux langues et aux espaces. Empruntant à toute forme de narration (roman, essai, document, histoire, (auto-)biographie, journal, correspondance, traduction, poème — forme primordiale de l'écriture chez Ajens...), se jouant formellement des conventions tout en leur témoignant du respect, El entrevero intègre des pièces manuscrites, des retranscriptions, des poèmes typographiques, des dialogues, des notes de pied de page et de fin de volume, des gras, des italiques, des barrés et des soulignés, au coeur du corps du texte qui déborde à un point tel qu'il est difficile de séparer le corps normal des excroissances anormales : ce sera en fin de compte la voix (multiple & multipliée) émise par le texte qui donnera au corps sa forme a priori monstrueuse, domesticable cependant si l'on prend la peine de l'écouter et de s'y frotter.
Présenté sans mention précise de genre sur la couverture ou la page de titre, on trouvera tout de même dans la critique les qualificatifs allant de roman à essai-récit — car il a fallu que je fouine avec ténacité les entrailles du net pour en savoir plus sur ce surprenant poète, essayiste, traducteur, linguiste né en 1961 à Santiago au Chili et découvert, discret, au bas d'une étagère de la 14e Feria del Libro de La Paz en 2009. El entrevero excède toute loi possible de genre ou catégorie pour élaborer son propre espace, tant géographique que linguistique, sans parler d'un temps propre, de la langue et de l'écriture (donc de la pensée) qui, problème essentiel de El entrevero, est justement lié aux langues et aux espaces. Empruntant à toute forme de narration (roman, essai, document, histoire, (auto-)biographie, journal, correspondance, traduction, poème — forme primordiale de l'écriture chez Ajens...), se jouant formellement des conventions tout en leur témoignant du respect, El entrevero intègre des pièces manuscrites, des retranscriptions, des poèmes typographiques, des dialogues, des notes de pied de page et de fin de volume, des gras, des italiques, des barrés et des soulignés, au coeur du corps du texte qui déborde à un point tel qu'il est difficile de séparer le corps normal des excroissances anormales : ce sera en fin de compte la voix (multiple & multipliée) émise par le texte qui donnera au corps sa forme a priori monstrueuse, domesticable cependant si l'on prend la peine de l'écouter et de s'y frotter.
 El entrevero comme récit nous emmène dans les Andes, de Charazani à Sorata, de Santiago à La Paz, dessinant une géographie dont le texte reprend les formes et les routes : pics, crevasses, plateaux et pentes, lignes droites et courbes. Ces Andes fantasmées deviennent l'Ande qui reconstruit, resitue ce qui fait un lieu, une zone : celui qui l'habite et la pratique comme langue, capable de prendre des détours jusqu'en Europe et Paris, entre autres. Cette voix, dont je parlais plus haut, est à lier à la mention de l'auteur qu'il a l'habitude de poser à l'ouverture de ses ouvrages : « Andrés Ajens et al. est la marque de l'auteur. L'abréviation canonique, pour et alii, “et autres”, signe à son tour l'hétérogénéité — et je crois qu'il faudrait dire l'hétérogenèse — du texte, qui, pour cela même, n'est pas d'un seul, mais de plusieurs, de beaucoup, entremêlés, appelés par leurs noms et surnoms (leurs alias, comme cela apparaît déjà dans le masque anagrammatique de Ajens pour Asenjo, qui accentue l'altérité [ajeno signifie en espagnol « autre, étranger »]), convoqués pour une comparution fugace ou soutenue : Puba omniprésente, Humberto Quino, Jaime Saenz, Huidobro et Mistral, et aussi Vallejo, et Neruda, Bollack et Derrida, la persistante évocation de feu Germán Bravo, les quatre-cents nominations qui rendent compte des mémoires et références, et qui sont – toutes et chacun, chacune – d'autres très nombreuses voix qui ne se concertent pas en polyphonie, mais plutôt en un boucan babélique. » (Pablo Oyarzun, à propos de El entrevero).
El entrevero comme récit nous emmène dans les Andes, de Charazani à Sorata, de Santiago à La Paz, dessinant une géographie dont le texte reprend les formes et les routes : pics, crevasses, plateaux et pentes, lignes droites et courbes. Ces Andes fantasmées deviennent l'Ande qui reconstruit, resitue ce qui fait un lieu, une zone : celui qui l'habite et la pratique comme langue, capable de prendre des détours jusqu'en Europe et Paris, entre autres. Cette voix, dont je parlais plus haut, est à lier à la mention de l'auteur qu'il a l'habitude de poser à l'ouverture de ses ouvrages : « Andrés Ajens et al. est la marque de l'auteur. L'abréviation canonique, pour et alii, “et autres”, signe à son tour l'hétérogénéité — et je crois qu'il faudrait dire l'hétérogenèse — du texte, qui, pour cela même, n'est pas d'un seul, mais de plusieurs, de beaucoup, entremêlés, appelés par leurs noms et surnoms (leurs alias, comme cela apparaît déjà dans le masque anagrammatique de Ajens pour Asenjo, qui accentue l'altérité [ajeno signifie en espagnol « autre, étranger »]), convoqués pour une comparution fugace ou soutenue : Puba omniprésente, Humberto Quino, Jaime Saenz, Huidobro et Mistral, et aussi Vallejo, et Neruda, Bollack et Derrida, la persistante évocation de feu Germán Bravo, les quatre-cents nominations qui rendent compte des mémoires et références, et qui sont – toutes et chacun, chacune – d'autres très nombreuses voix qui ne se concertent pas en polyphonie, mais plutôt en un boucan babélique. » (Pablo Oyarzun, à propos de El entrevero). Difficile de préciser dans quel mouvement se déplace la narration, bien qu'il soit possible de figer des scènes, des tableaux qui seront cependant liés entre eux par une autre matière que le narré, par une méditation sur la linguistique, sur la poésie, sur la philosophie, sur la traduction... Le personnage principal est évidemment la langue elle-même, langue véhicule et source de la poésie et de la pensée, donc langue composée de langues, mais laisse l'espace à des personnages réels (Puba et tutti cuanti sont des poètes, essentiellement, personnalités réelles qui jouent les premiers rôles, mais l'on trouve aussi certaines figures typiques de la cambrousse andine, ou de la ville de La Paz, ainsi que des lieux bien existants : bistrots, places, rues, quartiers nommés... ce qui permet de remettre en cause et taquiner à l'aide d'une certaine trivialité et contingence l'approche si sérieuse que l'on peut avoir de la chose intellectuelle, de la poésie en particulier).
Je ne tenterai pas de résumé, ce qui ne ferait que paraphraser les séquences qui n'ont entre elles quelquefois que peu de chose à voir sinon un saut de puce ou de géant, ou plutôt s'éclairent rétrospectivement mais pas toujours d'une lumière directe, disons liées par le pas en tant que tel de la puce ou du géant. Un résumé ne ferait qu'appuyer l'emmêlement, l'entremêlement, la mêlée, cet entrevero d'histoires et de séquences narratives qui occulterait la force poétique et l'intelligence critique qui sont pourtant à l'égal du récit, deux formes essentielles du livre, en tout cas leur direction.
El entrevero comme essai : pour exemple, la première phrase (« De Charazani, apersonado, a Sorata » [De Charazani, le voilà, à Sorata]) est décomposée (narrativement) pour permettre d'en approcher le sens et la portée. Les histoires et les personnages s'engouffrent dans la réflexion que fait surgir la première phrase. Tout le long des 150 pages du livre, on peut apprécier les réflexions subtiles et profondes à propos de Heidegger, Derrida, des grands poètes (Celan, Mallarmé, Rimbaud, Pessoa, que Ajens a par ailleurs traduits, Huidobro, Neruda, Saenz...) jusqu'à pénétrer l'essence des langues et des identités, touchant à des domaines aussi fascinants que la linguistique ou la sémiotique. C'est lorsque Ajens s'empare d'objets rares chez nous qu'il devient absolument indispensable : le regard poétique et réflexif qu'il porte sur les langues, mots et poèmes aymara, quechua, mapuche ou d'autres langues devenues mineures sous le joug des langues colonisatrices, se transforme alors en regard politique. Allant plus loin dans la longue bataille qui fait s'affronter les langues nationales institutionnalisées et académiques aux langues mineures du peuple, aux argots, registres familiers, parlés, oraux, dérivés, il confronte dominantes et dominées pour tenter de redéfinir l'espace aujourd'hui complètement régi par une vision occidentalo-centrée (à l'Ande, il confronte l'occidentalie). La réflexion, comme l'expérimentation technique et poétique d'une globalisation des langues, surgit de cette babel magmatique qu'est notre monde contemporain, pour lequel l'unique boussole des colonisateurs ne suffit plus. Mais son approche se fait sans prise de position tranchée, idéologique, morale. C'est son esthétique qui parle et qui propose de réagencer, de désembobiner et réemmêler les éléments d'un rapport de force entre les langues et les espaces.
El entrevero comme poème me pousse à citer ce que la littérature du XXe siècle a pu donner de plus radical et de plus beau : Ajens se situe dans la tradition de ces érudits forcenés curieux et ludiques, totalisateurs et expérimentateurs qui proposaient la lecture d'un roman comme un long poème. Il est indéniable en pratiquant la prose de Ajens qu'elle rappelle par son étrangeté, sa folie, sa liberté, son inspiration, son érudition et son humour celles d'un Joyce et d'un Lezama, exemples très rares de langues propres et extraordinaires, d'histoires et de réflexions infinies. Il faut noter par ailleurs que El entrevero, reprenant quantités de faits et éléments autobiographiques, recompose aussi le parcours d'écriture et de traduction, comme de conversations et entretiens de Ajens. A s'approcher du parcours de Ajens, El entrevero apparaît comme l'aboutissement d'un long travail de maturation poétique et théorique, et qu'il le rassemble et le condense dans un texte qu'on peut qualifier de pièce maîtresse de son oeuvre. Son baroquisme ludique, musical et multilingue nous mène des Cantos de Pound au Larva de Rios (mois long que ces deux-là, il n'en est pas moins dense, riche et ambitieux).
Déroutant à la première lecture et pourtant déjà fascinant, El entrevero donne l'impression tourbillonnante de se trouver face à un texte d'une originalité et d'une force rare ; les lectures successives ne font que la renforcer.
La prose d'Ajens est cabotine, ludique, brisée et pourtant fluide, elle agglutine les jeux de palabres au sein du castillan, mais propose aussi des doubles ou triples lectures dans le spectre de l'anglais, du français, du brésilien, de l'italien, et surtout de l'aymara, du quechua qui viennent innerver la première, langue du pouvoir. Lorsqu'Ajens insère des citations, phrases ou passages dans des langues étrangères, ils sont explicités en fin d'ouvrage où une partie intitulée « Translucines [traslaciones, diferidas, deferencias] » (« Translucinations [translations, différées, déférences] ») poursuit les jeux non comme des résolutions mais comme de nouvelles énigmes poétiques. Les références (culturelles, littéraires, philosophiques, linguistiques...) sont nombreuses, presque à saturation, mais pour autant, qu'on connaisse ou non la littérature et les poètes boliviens, les fondements de la philosophie heideggerienne, la poétique mallarméenne ou les troquets perdus de La Paz, il suffit au lecteur de passer d'un fil d'Ariane à l'autre et s'agripper au filet tendu par Ajens comme un piège poétique autant qu'une maille de protection ou de retenue. Et l'un des points essentiels dans le travail de couture d'Ajens, est la jubilation langagière qui à chaque noeud de la toile tire un éclat de rire ou un frisson à son lecteur.
L'acte de traduire et le passage ou le mouvement d'une langue à l'autre (ou de l'indicible à l'explicite) est le sujet principal du livre, son moteur, son mouvement, énoncé dès le début : « De Charazani, le voilà, à Sorata : […] pour traduire les Variations sur un sujet en aymara. ». Le défi à relever confine à la folle gageure pour le personnage qui vit, qui existe dans cette traduction, comme pour le lecteur obligé de modifier substantiellement ses paradigmes de lecture et de fait, son mode de penser. Toutefois, le défi est payant : Andrés Ajens propose le même voyage que celui des écrivains du XXe siècle tels que José Lezama Lima, João Guimãres Rosa, Ezra Pound, Carlos Emilio Gadda, Arno Schmidt, Julian Rios, James Joyce, tous ces écrivains libres d'esprit et d'écrit, enfants de l'imparable triade des papas du roman de la modernité que sont Rabelais, Cervantes et Sterne — petits fils des magiciens du verbe de Dante à Góngora, en passant par tous les mineurs (de langue et de culture que notre hagiographie littéraire ne connaît pas) qui n'ont pas moins de puissance à déplacer les montagnes et les cours du verbe. *
De Charazani, le voilà, à Sorata : village, chef-lieu de la localité homonyme, qu'on peut dire enraciné sur le contrefort oriental de la Cordillère Royale des Andes, ou Ande. Autrefois le chemin de La Paz laissait abruptement l'Altiplano avant Tiwanaku et, en dents de scie, pénétrait les zones chaudes ; aujourd'hui, il faut faire une série de tours et détours, courbes anguleuses, tournants et lacets, traverser des ponts pré- et post-révolutionnaires, des passes, des vallées, et des falaises aveugles qui modèrent la somnolence lors de l'entrée en matière. Les premiers occidentaux qui empruntèrent Sorata le firent par la voie ouest, par Cuzco, et, avant cela, par la Cité des rois, plus broussailleuse : un lot basco-andalous ébahi par les fabulations dorées et les oiseaux d'argent, par d'impossibles déplacements d'oiseaux phénix ayant lieu dans la candeur de leurs cendres. Même Cervantes – qui sollicita au Conseil des Indes, entre sa captivité à Alger et la première livraison du Quichotte, une affectation de corrégidor à La Paz (factum, de plus, abondamment documenté) – enquêta sur Sorata et ses oiseaux cinéraires auprès des péruviens tout juste rentrés de l'Ande. On pourrait sans fin parler de Sorata, il existe une bibliographie variée.
De Charazani, pas loin de l'actuelle frontière boliviano-péruvienne. Combien de temps, d'heures, de jours, d'années il s'y était arrêté ? À quatre mille mètres d'altitude, ivre d'alcool et de langues. Comment savoir ? Comment relever le temps l'horloge le calendrier ? Pour traduire, dit-il apparemment à Puba en guignant la statue de Colomb sur l'avenue du Prado à La Paz, pour traduire les Variations sur un sujet en aymara. Comme Puba s'était jurée de ne plus tou c her de prose (tout ce qui ne brille pas est prose, ce sont ses mots), même la mallarméenne – laquelle à strictement parler, on le sait, n'en est pas une –, et comme de l'aymara elle s'en moquait à ce moment-là, elle n'eut pas fini d'assimiler ce qu'il lui disait en disant qu'il allait à Charazani traduire en aymara les susdites Variations. Sans je ni moi ni nom de baptême ni prénom ou surnom ni nom humain : le voilà. À Sorata [...]
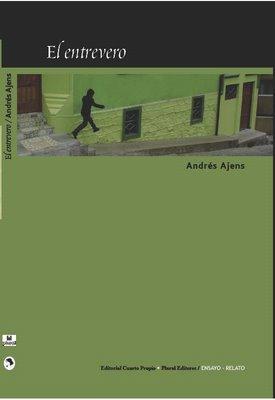 On peut lire ici ou très récemment là quelques poèmes d'Ajens traduits en français, ainsi qu'un entretien paru en 1998 dans la revue Prétexte. Je découvre aussi, qu'un nouvel ouvrage vient tout juste de paraître... si ce n'était l'océan qui m'en empêchait, je courrais chez le premier libraire de Santiago ou Buenos Aires et me délesterais de ces 50 petits pesos. Et puis, qu'on tolère le français de ces premières lignes d'un Entrevero emmêlé, la translucination est de mon triste (mé)fait.
On peut lire ici ou très récemment là quelques poèmes d'Ajens traduits en français, ainsi qu'un entretien paru en 1998 dans la revue Prétexte. Je découvre aussi, qu'un nouvel ouvrage vient tout juste de paraître... si ce n'était l'océan qui m'en empêchait, je courrais chez le premier libraire de Santiago ou Buenos Aires et me délesterais de ces 50 petits pesos. Et puis, qu'on tolère le français de ces premières lignes d'un Entrevero emmêlé, la translucination est de mon triste (mé)fait.
