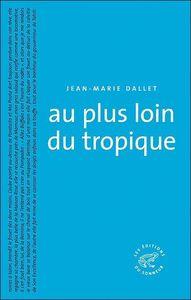 À quoi reconnaît-on un grand roman ? Au fait, répondait Gracq en substance, que retirée du texte la matière purement narrative il demeure quelque chose, souvent mal définissable, presque impalpable, mais quelque chose de bien présent dans chacune des pages où pourra s'investir le plaisir d'une relecture aléatoire hors de tout souci d'intrigue, pour le simple enchantement des retrouvailles avec ce " je ne sais quoi " qu'il faut bien pourtant nommer une esthétique - parce que tout grand roman est nécessairement une œuvre d'art où un artiste - le romancier - s'est engagé.
À quoi reconnaît-on un grand roman ? Au fait, répondait Gracq en substance, que retirée du texte la matière purement narrative il demeure quelque chose, souvent mal définissable, presque impalpable, mais quelque chose de bien présent dans chacune des pages où pourra s'investir le plaisir d'une relecture aléatoire hors de tout souci d'intrigue, pour le simple enchantement des retrouvailles avec ce " je ne sais quoi " qu'il faut bien pourtant nommer une esthétique - parce que tout grand roman est nécessairement une œuvre d'art où un artiste - le romancier - s'est engagé.
Appliquons donc à Au plus loin du tropique l'axiome de Gracq.
Matière narrative ? Elle se résume à peu de chose. Recluse sur un îlot pénitencier du Pacifique, une poignée de fripons décrépits, barbons bien typés, mal épargnés par la vie, vivote en ressassant ses souvenirs sous le cagnard des tropiques. Passe un cyclone dévastateur : un navigateur fait naufrage à proximité des côtes, et se voit secouru, " mal en point ", par cette communauté de vieux gredins au cœur finalement tendre ; laquelle - " amnistie ! " - quitte bientôt l'atoll où le naufragé, un certain Kerlan, décide quant à lui de rester pour parfaire sa solitude et mieux se retrouver.
Et c'est à peu près tout.
Enlevons donc ce peu de chose, curons le " roman " jusqu'à l'os. Que reste-t-il ?
Mais l'essentiel : des images, fortes, où le stéréotype tropical n'est pas de mise, ou se voit bousculé cul par-dessus tête, non sans ironie, en deux temps trois mouvements : certes " [on] court sur la plage de Pernabaco au pied de la forêt vierge où disparaissent les chasseurs aux arcs de bambou, où feulent les tigres roux " - oui, mais dans ses rêves, et vite on " émerge d'un cauchemar plein de lions d'Abyssinie " pour retomber dans le " grumeleux concassage de corail blanc sur lequel [...] progressent les bernard-l'hermite " ; des images, fortes, poussant comme la tempête en bourrasques drues la narration, servies par un lexique sans chichi ni tralala où un chat s'appelle un chat, où les corps se disent crûment, accablés de vieillesse, de maux et de luxure : " mais cela fait mal ? Oui, je sais, mais il faut bien nettoyer la viande râpée, les coupures du corail mon Dieu tu nous en donnes du tracas, mais tais-toi donc j'attaque maintenant ton malheureux bigoudi, ne gueule pas, j'ai de la douceur - on a de la douceur nous autres femmes et quand on est pute on en a plus encore, ce n'est pas comme les hommes qui n'ont rien que du désir brutal ".
Cela qui reste, ces intensités constantes, et surtout - surtout, me semble-t-il - le phrasé de Jean-Marie Dallet.
Le phrasé plus que la phrase, oui : Dallet vous rythme à la diable ses courts chapitres, vous les ponctue comme il lui chante, au grand dam de la virgule attendue, du point en souffrance, dans une respiration globalisante où tout se mêle, s'emmêle - présent, passé, ici, là-bas, haut, bas, devant, derrière, monologues intérieurs et poussée narrative, etc. - pour mieux se confondre, s'inclure, s'agglutiner, créant continuité fluide des espaces et des temps, des voix[1], sans rien qui semble pouvoir l'arrêter : pas un détail - ils foisonnent, pourtant ! - plus gros que l'autre - ou alors ils sont tous gros -, pas de ces focalisations théâtrales sur les drames passés, présents - les fameuses " scènes fortes " des romans d'opérette - qui pourtant ne manquent pas, mais qui surviennent et puis s'en vont comme si de rien n'était, ne créant pas plus l' événement que les autres petits faits de vie ponctuant les mornes existences des personnages.
L'épisode, le jour du cyclone, de la mort - de l'exécution ? - du Chinois (le dénommé Ah You, vidangeur condamné bien des années plus tôt à la guillotine pour avoir trucidé quelqu'un de ses confrères), illustre à mon sens particulièrement bien cette écriture de l'emmêlement lyrique. Qu'on en juge sur pièce : " alors qu'Ah You vient de se redresser une rafale emporte dans les airs la dernière tôle de l'église, elle vole, elle vrille, elle plonge comme un avion de guerre droit sur l'homme enfin debout : Seigneur, pitié pour lui, mais tu sais bien, Trinité, qu'il n'y a pas de pitié, et d'un coup précis, juste comme un couperet, la tôle tranche le cou du Chinois - maintenant un corps sans tête titube au cœur de l'ouragan dans une lumière grise de fin des temps, une tôle monte vers les nuages chargée en son centre de la tête sanglante[2] du vieil Ah You [...] " Mélodrame ? La séquence pourrait facilement s'y prêter. Mais allons donc ! - " il n'y a pas de pitié " : juste une scène magistralement orchestrée, vigoureusement visuelle, et comme sonorisée par des répétitions impulsant un rythme de tumulte à cette page comme aux autres, et qui nous emporte et nous transporte sans lourdeur descriptive, narrative ou psychologisante : l'habituellement compact - église, corps d'homme - se désagrège, comme Dallet désagrège l'habituelle compacité romanesque, pesante et mollasse de tout son héritage littéraire, pour la recomposer à sa manière dans un phrasé tout de rapidité, vaguant de terre en ciel, et qui capte l'œil autant que l'oreille en confusion des sens, en méli-mélo lyrique.
Lyrique, Dallet ? Magnifiquement, rythmiquement lyrique ! Mais d'un lyrisme âpre, sans concession pour les mignardises ni pour les pleurnicheries, à l'ancre du concret, d'un réel non expurgé ; une poésie, oui, de la dureté, du vrai rugueux contre lequel les hommes se frottent et s'écorchent, et chargée d'une empathie comme distanciée qui souvent nous donne à rire ou à sourire, comme aussi rit Kerlan, naufragé, à demi mort sur la plage et grignoté déjà par les crabes, " d'un rire aigu, d'un rire meurtrier " ; d'un rire, somme toute, baroque - car Dallet est baroque, fondamentalement baroque, si, en littérature, c'est, le baroque tel que le définit Jean Rousset, " l'instabilité (les équilibres défaits, refaits, gonflés en courbes et spirales), la mobilité (visions et points de vue multiples [...], la métamorphose (unité mouvante des ensembles qui se transforment), et la domination du décor "[3] ; voire d'un rire burlesque, si le style burlesque est un des avatars du style baroque, l'un n'excluant pas l'autre, bien au contraire, dans ce petit chef d'œuvre qu'on lit dans un emportement jubilatoire, puis qu'on relit au hasard des pages comme on suce lentement le bonbon gardé tout au long de la journée dans le creux de sa joue.[4]
Pour une autre analyse, convergente avec la mienne, du roman de Jean-Marie Dallet, je me permets de renvoyer le lecteur au bel article de Marc Villemain, paru sur le blog de ce dernier.
