Quelques sensations, émotions, envies, pour clore une semaine plutôt agréable et en commencer une autre. Histoire de parler de tout et de rien, de musique, de cinéma, de théâtre ou de danse, de genres qui se confondent et s'expriment dans la musicalité.
Il y a peu, Brad Mehldau ouvrait, à la Cité de la Musique, le Festival Jazz à la Villette. C'était un concert en solo et, certes, le Festival a aujourd'hui fermé ses portes, mais le musicien est toujours sur les routes et j'ai envie de vous en dire deux mots, amicaux et admiratifs.

Malgré ce qui a pu être dit ici ou là, ce toujours grand jeune homme au romantisme d'éternel étudiant aux Beaux Arts montre une virtuosité rare, mais jamais pesante, jamais écrasante pour le public. Le label "surdoué" qui colle au personnage Mehldau n'alourdit sa musique d'aucune forme d'élitisme agaçant. Son truc, c'est la simplicité (une facilité apparente à nous chavirer, résultat, on l'imagine, d'un travail de forçat, enchaîné des milliers d'heures à son clavier) et un jeu tout en nuances harmonieuses, respectant la joliesse de certaines mélodies sans jamais verser dans le décoratif. BM joue simple, ne refusant aucune sentimentalité, acceptant d'enrouler ses notes dans la complexité sans payer son tribut à la complication. Il joue juste, tout simplement, à égale distance du coeur et de l'oreille.
En reconnaissant l'attrait de cette simplicité, je ne mets en rien en cause la musique savante, expérimentale ou classique, que j'adore par ailleurs. On reconnait d'ailleurs chez Mehldau des influences multiples dont il est également l'interprête reconnaissant, de Debussy à Art Tatum. Mais ces influences, intégrées à sa culture musicale, sont au service d'un style unique, savant et sensible, comme d'un Keith Jarrett modeste, qui respecterait autant son public que lui-même.
Le concert déroule un répertoire sans concession aux modes, sans facilité (les standards ne viennent qu'en toute fin, comme pour remercier les auditeurs) très adapté à la formule solo. Un trait tout à fait caractéristique : seul, il ne se croit pas obligé d'en faire des tonnes (contrairement à, par exemple, des types aussi considérables que Michel Petrucciani ou Michel Portal qui, pour de bonnes ou mauvaises raisons, ont pu se croire obligés, en solo, de faire vrombir la machine à sensations pour combler l'espace) ; il joue, il fait le job, même si ses capacités de claviériste peuvent donner parfois l'impression qu'il joue plusieurs pianos à la fois. Et plonger dans sa musique c'est nager en pleine harmonie, là où le jazz vogue de conserve avec la musique classique.
Voici pour illustrer, un peu loin de ce concert inoubliable, une version de River Man, dans une vidéo très moyenne, mais il est difficile de trouver mieux sur le net (ou donnez-moi les adresses, merci).
Brad Mehldau - River Man par mark-krisky
Le concert se termine par quatre ou cinq rappels, ce qui ne signe pas un manque de générosité. Là, s'imposent les standards, tant du jazz que de la pop musique. Le souvenir, le temps d'un God only knows déstructuré, que Brian Wilson a montré en son temps un vrai talent de musicien. Black bird, dont la délicate mélodie (Lennon- Mac Cartney oblige) est peu malmenée et la douce harmonie simplement restituée. It's all right with me, qui donne envie de rester encore un peu. Mais quand la lumière se rallume, on se rend compte qu'on a passé deux belles heures avec cet ami. Oui, Brad Mehldau, outre un musicien exceptionnel d'intelligence et de sensibilité, ferait un ami plus qu'acceptable. Sa gentillesse, qui perce peu à peu sous la réserve timide, est au final la signature d'un très grand artiste. De ceux qui ne se prennent pas pour, car ils sont.
Le site de Brad Mehldau (avec ses dates, de Nantes à San Francisco)
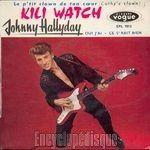
Mes parents avaient accepté d'emboiter un jeu musical dans le jeu de petits chevaux qui nous tenait tranquilles, parfois le soir, loin des orages. J'étais préposé aux disques et tous les trois 45 tours (pour les 33, il y en avait, mais pas beaucoup, et ils étaient trop longs pour le jeu, bref, surtout, moi je n'en avais pas), entre les chansons d'Edith Piaf ou d'Yves Montand pour ma mère et d'André Verchuren ou Aimable pour mon père, je mettais un disque de rock. Enfin, mon disque de Johnny.
C'était en 1960 et, pour les photos (pour avoir des photos de mon idole), j'achetais ce qu'on appelait des Petits formats, des partitions comme on en voit dans Sous les toits de Paris de René Clair, quand Albert Préjean, chanteur de rue, entonne la chanson-titre tout en surveillant du coin de l'oeil un pickpocket qui trousse sa clientèle. La presse de l'époque faisait le blocus autour des premiers chanteurs rocks (ou supposés tels) et pour coller les photos de Johnny dans mon cahier, celui avec Marilyn (la célèbre photo de calendrier, un peu leste), mes acteurs de cinéma et les autres images qui me facilitaient l'adolescence, il me fallait passer par ce subterfuge.
Johnny enregistrait chez Vogue, un label moderniste, qui allait accueillir Jacques Dutronc et Françoise Hardy (se sont-ils rencontrés en studio, les bougres ?), mais s'était révélé au public grâce au jazz. C'est sur le label Vogue que le fameux concert de Dizzy Gillespie à Pleyel, qui a initié en 1948 une europe incrédule à l'énergie du bebop, déstabilisante pour le jazz établi (les spectateurs de Chico et Rita s'en souviendront) a été enregistré et est parvenu jusqu'à nous.
Dans les années 70, Vogue a sorti en France les disques 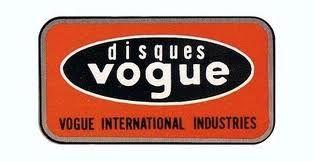
Vogue, au fait, rien à voir avec le magazine de même nom.
Toujours plus musical, le cinéma.

Voici, réalisé pour la FNAC, un digest de cette rencontre, centré sur sa première partie. Le montage ne rend pas compte de la touche décontractée de l'événement, due en grande partie à l'humour foldingue et volontiers persifleur de Jérémie.

Le prochain Donzelli-Elkaïm, film entièrement dansé, nous dit-on et largement tourné à l'Opéra Garnier, est titré Main dans la main. Joli programme, non ?
La danse, l'Opéra m'amènent à ma grande émotion du weekend en forme de privilège. Samedi, à Chaillot, Mikhaïl Baryshnikov montait sur la scène de la salle Jean Vilar pour la dernière fois de la saison pour In Paris, inspiré de l'écrivain russe Yvan Bounine, dans une mise en scène du très avant-gardiste Dmitry Krymov. J'aurais dû assister à la première, mais c'est une autre histoire.

Quand, dans les dernières minutes, il esquisse quelques pas de danse, on a envie de remercier, de saluer l'artiste, celui qu'on a eu la chance de côtoyer dans un rôle nouveau, celui qu'on a raté quand il caressait les étoiles.
Un dernier mot pour souligner l'humour du personnage, son élégance courtoise, le raffinement qu'il a consenti, un soir encore, à partager.
Bonne semaine, bonne rentrée à ceux qui rentrent, bon anniversaire à celles et ceux qui célèbrent un anniversaire, bons films aux heureux qui vont découvrir le cinéma de Bertrand Bonello, mercredi, ou un nouveau Skolimowsky comme Le départ, avec un Léaud en 5ème vitesse, sinon Bon appétit, Bonne nuit les petits (et Adieu à Claude Laydu), bon courage aux travailleurs, bonne chance aux gratteurs, bonne lecture, bons baisers de Lucy, in the sky with diamonds.
