 François Marius Granet (Aix-en-Provence,
1775-1849),
François Marius Granet (Aix-en-Provence,
1775-1849), La Trinité des Monts et la Villa Médicis, 1808.
Huile sur toile, 48,5 x 61,5 cm, Paris, Musée du Louvre.
 Le concours du prix de Rome de musique, institué par Napoléon en 1803 et supprimé par André Malraux en 1968, a donné lieu, tout au long des 165 ans de son histoire,
à des prises de position extrêmement contrastées. Moqué par nombre d’observateurs et de musiciens comme un bastion de l’académisme le plus frileux et le plus stérile, son caractère de Sésame
destiné à ouvrir les portes du succès, en particulier lyrique, ce domaine ayant longtemps été le seul à garantir une véritable reconnaissance sociale, n’en a pas moins excité les plus grandes
convoitises, comme le démontre l’acharnement de certains compositeurs, et non des moindres, de Berlioz à Ravel en passant par Saint-Saëns, à s’y présenter. Par un curieux paradoxe, aucun
travail d’envergure n’avait été entrepris, à ce jour, sur une institution qui pourtant contribua largement à structurer le milieu musical français tout en nourrissant maints débats en son
sein ; c’est aujourd’hui chose faite avec la somme coordonnée par Julia Lu et Alexandre Dratwicki que publient, avec le soutien du Palazzetto Bru Zane, les éditions Symétrie, dont il convient de souligner le courage éditorial ainsi que la haute et
constante qualité des productions.
Le concours du prix de Rome de musique, institué par Napoléon en 1803 et supprimé par André Malraux en 1968, a donné lieu, tout au long des 165 ans de son histoire,
à des prises de position extrêmement contrastées. Moqué par nombre d’observateurs et de musiciens comme un bastion de l’académisme le plus frileux et le plus stérile, son caractère de Sésame
destiné à ouvrir les portes du succès, en particulier lyrique, ce domaine ayant longtemps été le seul à garantir une véritable reconnaissance sociale, n’en a pas moins excité les plus grandes
convoitises, comme le démontre l’acharnement de certains compositeurs, et non des moindres, de Berlioz à Ravel en passant par Saint-Saëns, à s’y présenter. Par un curieux paradoxe, aucun
travail d’envergure n’avait été entrepris, à ce jour, sur une institution qui pourtant contribua largement à structurer le milieu musical français tout en nourrissant maints débats en son
sein ; c’est aujourd’hui chose faite avec la somme coordonnée par Julia Lu et Alexandre Dratwicki que publient, avec le soutien du Palazzetto Bru Zane, les éditions Symétrie, dont il convient de souligner le courage éditorial ainsi que la haute et
constante qualité des productions.
Depuis sa création, le Centre de musique romantique française a fait des musiques composées pour le prix de Rome un de ses champs de recherches d’élection. Après avoir initié, en collaboration avec le label Glossa, le Brussels Philharmonic, le Flemish Radio Choir et le chef d’orchestre Hervé Niquet, une série d’enregistrements dont des extraits accompagnent votre lecture, il lui aura fallu pas moins de sept années pour que ce livre impressionnant, regroupant 36 contributions (en comptant l’introduction) dues à 32 auteurs, puisse être proposé au public. Les cinq parties qui le composent nous permettent de comprendre la structure et l’évolution des différentes phases du concours du prix de Rome ainsi que la façon dont ce dernier s’est inscrit dans ou au rebours des tendances de son temps, puis d’observer s’il a constitué ou non cette citadelle si souvent décriée du conservatisme musical et quelles garanties réelles il pouvait offrir pour la future carrière des lauréats, et enfin les adhésions et les résistances qu’il a suscitées non seulement auprès des musiciens, mais aussi des critiques et, à travers eux, des audiences. Fort judicieusement, le cœur de l’ouvrage accueille un dossier complet consacré au « cas Berlioz » qui illustre parfaitement, à lui seul, l’ambivalence des attitudes à l’égard du prix de Rome, dont le compositeur se fit un détracteur particulièrement virulent tout en ne s’y présentant pas moins de cinq fois entre 1826 et 1830, année où on lui décerna, presque de guerre lasse et du bout des lèvres, un premier premier prix pour sa cantate Sardanapale.

Parmi les autres révélations à mettre au crédit de cette somme passionnante qui n’en est pas avare, on notera la richesse insoupçonnée des partitions produites non seulement pour le concours lui-même, dont le stade suprême, la cantate, ne pouvait être brigué qu’après réussite à l’épreuve de la composition d’une fugue et d’un chœur avec orchestre, certains de ces derniers se révélant de fort belle facture, mais aussi par les lauréats durant leur séjour à la Villa Médicis. La partie de ces envois de Rome destinée à être exécutée « lors de la séance publique de l’Académie des Beaux-Arts, après la cantate qui a remporté le prix de l’année », ainsi que le mentionne le règlement de 1821, est majoritairement constituée d’ouvertures orchestrales ; ce fait présente un intérêt tout particulier lorsque l’on sait la place d’honneur qui était alors réservée à l’opéra, cette voie royale que devait ouvrir l’obtention du prix de Rome, promesse qui, ainsi que le prouve également cet ouvrage, fut loin d’être toujours tenue, malgré la création, en 1851, du Théâtre-Lyrique dont un des objectifs était d’offrir un débouché aux ouvrages scéniques des jeunes musiciens couronnés. En apportant la confirmation de l’existence, longtemps sous-estimée voire ignorée, et de la vitalité de la pratique de la musique instrumentale en France dès le début du XIXe siècle, ce livre ouvre de vastes et palpitantes perspectives que l’on espère voir se concrétiser, dans un temps pas trop lointain, au travers d’études spécifiques et d’enregistrements discographiques dont sa lecture donne irrépressiblement l’envie.

Par la diversité des sujets qu’il traite comme par sa volonté, malgré son haut niveau d’exigence scientifique, de toujours demeurer accessible, ce remarquable Concours du prix de Rome de musique s’adresse aussi bien au chercheur qu’au chroniqueur ou au mélomane soucieux d’acquérir des connaissances ou de compléter celles qu’il détiendrait déjà sur le prix de Rome et, plus largement, sur la musique française du XIXe et d’une partie du XXe siècle. Somme incontournable par la richesse des informations qu’il contient, par les idées reçues qu’il bat en brèche et les multiples de pistes de réflexion qu’il ouvre, cet ouvrage de référence s’affirme donc comme un instrument de travail indispensable, mais aussi comme un fantastique support pour la rêverie de qui brûle d’entendre les œuvres encore inédites dont il fait mention. Puisse la collaboration entre le Palazzetto Bru Zane et les éditions Symétrie nous réserver encore de nombreux ouvrages de ce type, qui font honneur à la recherche et à ceux qui, souvent inconnus du grand public, œuvrent dans l’ombre pour que des pans entiers de notre culture ne sombrent pas dans l’oubli.
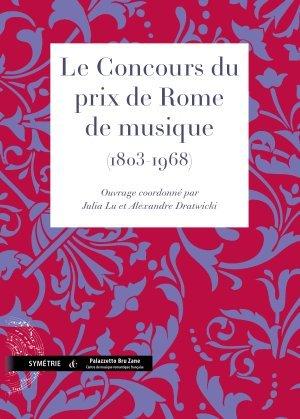
Collection « Musiques du prix de Rome » :
Dans tous les volumes, le Brussels Philharmonic et le Flemish Radio Chor sont dirigés par Hervé Niquet.
Volume 1, Claude Debussy (1862-1918) :
1. L’Enfant prodigue, cantate (premier prix de Rome, 1884) : Prélude
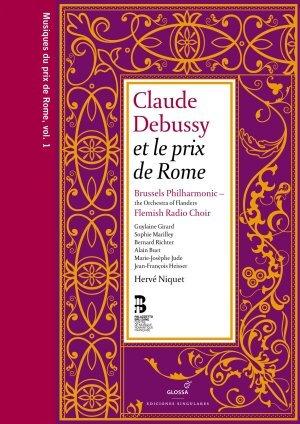
Volume 2, Camille Saint-Saëns (1835-1921) :
2. Chœur de Sylphes (concours d’essai pour le prix de Rome, 1852)
Julie Fuchs, soprano, Solenn’ Lavanant Linke, mezzo-soprano
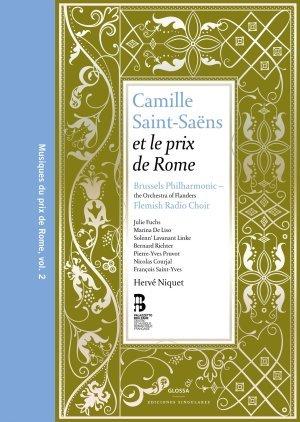
Volume 3, Gustave Charpentier (1860-1956) :
3. Didon, cantate (premier prix de Rome, 1887) :
Trio : « Prends pitié de mes alarmes »
Manon Feubel, soprano (Didon), Julien Dran, ténor (Énée), Marc Barrard, baryton (Anchise)
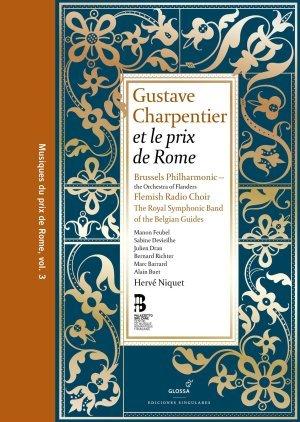
Illustrations complémentaires :
Baron François Pascal Simon Gérard (Rome, 1770-Paris, 1837), Le Génie s’élevant malgré l’Envie, 1831. Huile sur toile, 260 x 142 cm, Versailles, Châteaux de Versailles et de Trianon.
Léon Cogniet (Paris, 1794-1880), L’Artiste dans sa chambre à la Villa Médicis, 1817. Huile sur toile, 44,5 x 37 cm, Cleveland, Museum of Art.

