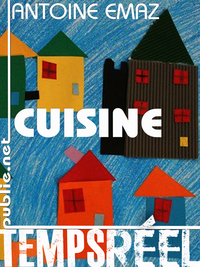 Avec Cuisine, Antoine Emaz choisit de publier un recueil de notes sous une forme électronique ; François Bon, qui l’avait déjà reçu pour un livre de même nature dans la collection Déplacements qu’il dirigeait au Seuil (Cambouis, 2009 – repris chez publie.net), édite ce texte inédit pour un prix très modique ; notons que la mise en page aérée facilite la lecture sur écran, même lorsqu’on ne dispose pas d’une tablette spécifique (laquelle propose un système d’indexation repéré par l’éditeur) ou qu’on n’est guère habitué à lire des textes longs à l’ordinateur.
Avec Cuisine, Antoine Emaz choisit de publier un recueil de notes sous une forme électronique ; François Bon, qui l’avait déjà reçu pour un livre de même nature dans la collection Déplacements qu’il dirigeait au Seuil (Cambouis, 2009 – repris chez publie.net), édite ce texte inédit pour un prix très modique ; notons que la mise en page aérée facilite la lecture sur écran, même lorsqu’on ne dispose pas d’une tablette spécifique (laquelle propose un système d’indexation repéré par l’éditeur) ou qu’on n’est guère habitué à lire des textes longs à l’ordinateur.
Dans la ligne de Lichen Lichen (Rehauts, 2003), Lichen encore (Rehauts, 2009) et Cambouis, Cuisine est un recueil de notes tirées des carnets de travail de ces dernières années. Si les échos avec ces publications sont de principe, puisqu’il s’agit d’un même travail, ce livre ne les redouble pas, non seulement parce que les années diffèrent, mais aussi parce qu’on entre un peu plus dans la matière du « vivre » de l’auteur, pour reprendre un verbe nominalisé qu’il affectionne. Alternent donc des notes sur la poésie, les lectures, le quotidien, la famille, le métier d’enseignant, le jardin, soi : autant de champs d’expérience que le temps conjugue dans l’espace de la vie mais aussi dans l’espace de la poésie, puisque celui-ci demeure le point nodal de cette vie. De la pratique avant toute chose : ainsi, les images qu’emploie l’auteur pour évoquer le travail d’écriture sont-elles toujours aussi concrètes, essentiellement articulées autour de l’atelier, du bricolage (y compris le chalumeau oxhydrique) ou de la mécanique (et la thermodynamique), car Antoine Emaz interroge la fabrication du poème plus que sa conception : « Ecrire est une démarche empirique », qui naît de l’émotion et de l’intuition, pas d’une théorie esthétique qui précéderait l’œuvre. Cela ne signifie pas qu’il y ait refus d’une vision esthétique, au contraire : la place importante de la lecture critique permet de choisir, hiérarchiser et classer les œuvres ; la récurrence de certains auteurs - Baudelaire, Rimbaud (dans une couleur nuancée), Reverdy, Lowry, du Bouchet, James Sacré, Valérie Rouzeau, par exemple – exprime des prises de position qui, si elles sont bienveillantes à l’égard des auteurs nommés (l’auteur s’en explique), ne sont ni fades ni complaisantes. C’est dire que la poésie est exigeante, et qu’on différencie l’exigence vis-à-vis de son propre travail, sorte d’insatisfaction motrice (comme le dit aussi Baudelaire dans La Beauté), et celle du lecteur qu’on est du travail des autres.
Les carnets qu’on croise dans Cuisine sont contemporains de la parution de Plaie (Tarabuste, 2009) – livre singulier qui permet aussi à l’auteur d’interroger le risque et la pratique du poème - et d’une panne d’écriture poétique, d’où le grand champ laissé libre à l’exercice critique. Le livre s’achève avec un projet de réédition chez Tarabuste (parution toute récente sous le titre Sauf) et la saisie des notes qui font Cuisine. Cette panne de poèmes n’ôte en rien la préoccupation permanente du travail poétique, comme s’il y avait une sorte de travail intérieur, invisible, qui ne donnait rien en apparence : jachère ouverte : « Ce n’est pas que j’ai rien à dire, c’est que rien ne se dit, pas même ce rien ». Pas vraiment d’inquiétude, plutôt une attente qui oscille entre confiance souterraine et résignation : l’essentiel est qu’il y ait de l’écrit, et les carnets en sont la preuve, comme l’activité critique. Autant celle-ci se pense et se construit, autant le poème peut surgir à tout moment : « Le poème fait irruption [dans le moi intérieur] à l’occasion d’une collision avec l’extérieur », laquelle ouvre un espace neuf puisque « La poésie est une activité primaire qui va vers ce qu’elle ne sait pas ». Pas non plus d’hypertrophie de la poésie ou de l’écriture poétique : elle demeure ce qu’elle est : un centre, qui accompagne et recueille la vie, permet de la dire – puisque la poésie est bien, dans la littérature, l’espace du dire.
Dire la vie, c’est mettre en forme ce qu’elle est : du quotidien, un métier de professeur, des activités littéraires (lectures publiques, rencontres), la présence de la famille, des lieux de vie avec le rythme travail/vacances, la mémoire et tout ce qui vous appartient qui croise tout cela : un corps, des souvenirs, des sensations, des sentiments – autant d’éléments que rassemblent la coïncidence du temps et la coïncidence de l’écriture. Si la part subjective opère constamment, elle n’est elle non plus jamais hypertrophiée ; une forme de modestie ou d’humilité veille, d’autant que l’auteur délimite les champs : peu d’intime, pas de confession ou d’aveu, peu de jugements sauf sur le rapport au travail par exemple : plusieurs notes évoquent les suicides à France-Télécom et les nuisances de la rentabilité financière contre l’humain, ou la difficulté accrue du métier d’enseignant. Conscience ancrée dans la vie qui bruit, loin des tours d’ivoire, ce qui rapproche Cuisine du journal, c’est la tenue d’éléments qui renvoient à la sphère privée, comme je l’ai dit, mais je pense aussi à l’importance du végétal, dont on sait qu’elle est associée chez Antoine Emaz à une forme de sérénité, qui se fait parfois réflexive, de même qu’à la thématique du vieillissement, posé comme un constat et un bénéfice possible pour l’écriture qui ne se sépare pas de l’angoisse qu’il porte. Qu’il s’agisse de ces notes-miroir ou d’analyses d’éléments extérieurs, on ne peut qu’être saisi par une mise à distance, froide, nette, précise, quasiment clinique, et une grande proximité, une attention exigeante à soi, à la complexité de ce qui se vit, à son relief d’émotions et de matière organique. Cuisine interne, pas intime. « Ma vie va sans moi, et je ne veux pas de cela ni ne peux aller contre. (…) Qu’est-ce qui bloque ? C’est cela que la nuit ramène dans son filet. Et je ne peux simplement répondre aliénation ou vieillir, c’est plus opaque et plus dense. Je ne sais pas, je ne vois pas. (…) C’est peut-être ce que je viens chercher ici, une réponse que je ne trouve pas, ou trop partiellement, parce que je ne vois pas assez bien la question. »
Il y a chez Antoine Emaz, une sorte de mélancolie maîtrisée, non dans l’émotion mais dans la formulation. Dans ses poèmes, la peur et l’impasse qui la génère sont des éléments centraux, mais la peur et la mélancolie sont deux sentiments distincts, qui ne se chevauchent pas. Le vide peut susciter l’un ou l’autre, selon les circonstances, sans que l’un taise l’autre. L’avant-dernier fragment, magnifique, à la résonance pascalienne - « Le silence de cet espace fini qu’est le jardin m’apaise (…) » - est à la mesure de cette retenue qui n’est pas sans lien avec certains moralistes du 17ème. Ailleurs, l’évocation des Rêveries de Rousseau est l’occasion de redire, a contrario, ce poids de vivre, cette inquiétude non pas métaphysique mais d’une existence liée au présent qui s’enchaîne : figure du manque indissoluble, de la mémoire d’un moi articulé à la peur/perte originelles, que le poème, par sa capacité à compresser ou à rompre de la forme, est à même d’exprimer. On voit à quel point la note, ici encore, se tient à la périphérie du poème, lorsque celui-ci est sourd ou muet. « Parfois, la note comme minime saisie d’expérience, instantané de rythme ou arrangement de langue. »
Cette attention à l’émotion et aux espaces quotidiens de la vie que beaucoup de ces fragments (j’emploie le mot fragment pour éviter une répétition, mais c’est absurde, car il s’agit bien de notes – voilà la répétition -, pas de fragments : ce sont deux attitudes d’écriture différentes) traversent, de même que les réflexions sur l’écriture et la poésie, plus largement la littérature, sont autant de propositions données au lecteur ; la simplicité de la phrase, qui n’exclut jamais son exigence et sa précision, porte aussi à cause de l’efficacité des images concrètes : la note se déroule et circonscrit : elle ne tient que très rarement de la maxime ou de l’aphorisme. C’est une des grandes forces de ce livre comme des précédents livres de notes d’Antoine Emaz. Cela n’empêche pas qu’elle puisse ouvrir des perspectives morales ou philosophiques par exemple, mais ça n’est pas son intention première. Le lecteur s’y retrouvera d’autant mieux : à l’instar du poème, la note propose, elle n’impose pas. « Directement, par l’écriture, ou indirectement par la lecture, il s’agit toujours de se rejoindre, de s’éclairer. » On sait aussi la portée commune, à tous les sens du terme, que veut véhiculer la poésie de l’auteur : elle est indissociable de la prise en compte du lecteur, destinataire du poème et juge à sa manière de ce qu’il en lit : on ne lit qu’avec soi. Désir de « travailler au plus profond ma part commune », dit Antoine Emaz : c’est une attitude esthétique autant qu’humaine, puisque le « but final » du poème est « une émotion commune ».
La langue est par principe au cœur de ce processus. Celle dont le travail permet de faire tenir le poème, celle qui permet d’écrire la note et de venir jusqu’au lecteur. Beaucoup de notes évoquent le travail du vers, du poème – style ou voix -, et la nécessité d’essayer des oreilles : « Pour bien se relire, il faut être entièrement soi, et plusieurs lecteurs différents, à la fois. » D’autres s’interrogent sur la nature poétique : « ce qui reste d’un poète, c’est un bougé de langue. » D’ailleurs, ce qui prime, c’est bien l’écriture, pas la figure du poète : les seules révérences sont faites aux maîtres ou aux livres des contemporains dont la spécificité de l’écriture échappe, et questionne sa propre pratique. Cet effacement du poète a la valeur d’une leçon : « Le poète n’a pas à convaincre si le poème n’a pas convaincu. »
Recueil de notes sur la vie, la poésie, Cuisine interroge plus largement tout ce qu’écrire implique, à commencer par soi, non dans le sacrifice ou la posture mère pélican, mais dans la simple évidence que c’est le seul moyen pour cet homme et ce poète qu’est Antoine Emaz de trouver une justesse qui permette à la fois de vivre et de dire cette vie. Justesse, équilibre, maîtrise : on pourrait multiplier les mots ; il s’agit au fond d’écrire ce drôle de décalage qui permet d’atteindre ce qui est si bien calé et qu’on ne voit plus parce que cela vous aveugle. « Où soulever quoi pour que ça déplace de la langue ? » Cette question, simple et fondamentale, qui exprime autant l’impuissance que la nécessité est à la hauteur de ce livre important qui donne à son auteur une autorité, pas une posture.
[Ludovic Degroote]
Antoine Emaz, Cuisine, publie.net, 2011, 3, 99 €

