 Tradition oblige, les membres du Fric-Frac Club vous proposent une fois de plus, en complément de leur top officiel sorti des urnes, un petit Mulligan Stew que chacun a concocté en remontant non sans émotion ses listes de lectures, en excavant sa mémoire à la recherche de chocs tous personnels, ou en suivant le simple fil de sa remémoration tranquille. Il n'y a pas, après tout, un seul et unique flux de lectures qui occupe notre existence, que l'on écrive ou pas sur le Wouaib : il y a les nouveautés de l'année, pierres milliaires rythmant la route de leur mystère attirant ( plaisir du pionnier !), mais il y a tout aussi bien les rattrapages des années précédentes, tristement exclus des classements à quelques mois près, ou ces antiquités qui émergent brusquement au bord du chemin, qui nous saissisent par le paletot et ne nous lâchent plus jusqu'à ce qu'on leur ai rendu les honneurs. L'Autre 2011, c'est le moment où, après la belle voie royale des rois de l'an passé, les membres du FFC lèvent, rien qu'un tout petit peu, le voile sur leurs constellations personnelles, qui ne cessent de tourner en coulisses, et qui surtout informent et nourrissent en permanence cette pointe de l'iceberg que vous connaissez mieux, ces papiers dont nous scandons ici l'année. Sur ce : place aux plaisirs coupables et aux émerveillements princiers.
***
Tradition oblige, les membres du Fric-Frac Club vous proposent une fois de plus, en complément de leur top officiel sorti des urnes, un petit Mulligan Stew que chacun a concocté en remontant non sans émotion ses listes de lectures, en excavant sa mémoire à la recherche de chocs tous personnels, ou en suivant le simple fil de sa remémoration tranquille. Il n'y a pas, après tout, un seul et unique flux de lectures qui occupe notre existence, que l'on écrive ou pas sur le Wouaib : il y a les nouveautés de l'année, pierres milliaires rythmant la route de leur mystère attirant ( plaisir du pionnier !), mais il y a tout aussi bien les rattrapages des années précédentes, tristement exclus des classements à quelques mois près, ou ces antiquités qui émergent brusquement au bord du chemin, qui nous saissisent par le paletot et ne nous lâchent plus jusqu'à ce qu'on leur ai rendu les honneurs. L'Autre 2011, c'est le moment où, après la belle voie royale des rois de l'an passé, les membres du FFC lèvent, rien qu'un tout petit peu, le voile sur leurs constellations personnelles, qui ne cessent de tourner en coulisses, et qui surtout informent et nourrissent en permanence cette pointe de l'iceberg que vous connaissez mieux, ces papiers dont nous scandons ici l'année. Sur ce : place aux plaisirs coupables et aux émerveillements princiers.
***
 Moins écrit mais pas moins lu, en cette année 2011. Moins de nouveautés que les quatre ou cinq années passées, plutôt un sacré retard rattrapé sur des gros morceaux à ce point intimidant qu'ils ont freiné toute velléité d'en parler. Pourtant, j'ai bien tenté de révéler Hugo, de faire leur compte à Gombrowicz et Dostoievski, de titiller Gaddis, mais c'est sans compter la liste des monstres sacrés pour lesquels on n'a souvent d'autre choix que de s'incliner et se clouer soi-même le bec. 2011 était pour moi la rencontre irréversible avec le Volcan de Lowry, la flamboyante rue berlinoise de Döblin, l'oeuvre en long et large de Flaubert (Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet, Salammbô, la Correspondance, etc.), Hugo à nouveau et son maximaliste Homme qui rit, les Reconnaissances géniales et ardues de Gaddis, et Escuela de mandarines de l'Espagnol Espinosa, un livre d'il y a quarante ans, inédit en français et pour lequel j'ai même commencé à me faire sauter quelques neurones, Dosto encore, Gadda toujours, Macedonio Fernandez enfin, et quelques autres encore. A côté de ceux-ci, il y avait ceux-là dont les livres crevaient les bacs de nouvelles sorties : l'hypnotique Krasznahorkai, deux Sorokine (dont on préfèrera largement la Tourmente au Kremlin en sucre), l'excellent Dans la nuit de samedi à dimanche de Nicole Caligaris, et le terriblement fort Désert et sa semence de Jorge Baron Biza. Mention spéciale à l'inédit de Bolano paru chez Anagrama au printemps : Los sinsabores del verdadero policia, qui doit être l'une des plus émouvantes lectures de 2011. Et forcément, plusieurs des romans de la bibliothèque FFC 2011.
Moins écrit mais pas moins lu, en cette année 2011. Moins de nouveautés que les quatre ou cinq années passées, plutôt un sacré retard rattrapé sur des gros morceaux à ce point intimidant qu'ils ont freiné toute velléité d'en parler. Pourtant, j'ai bien tenté de révéler Hugo, de faire leur compte à Gombrowicz et Dostoievski, de titiller Gaddis, mais c'est sans compter la liste des monstres sacrés pour lesquels on n'a souvent d'autre choix que de s'incliner et se clouer soi-même le bec. 2011 était pour moi la rencontre irréversible avec le Volcan de Lowry, la flamboyante rue berlinoise de Döblin, l'oeuvre en long et large de Flaubert (Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet, Salammbô, la Correspondance, etc.), Hugo à nouveau et son maximaliste Homme qui rit, les Reconnaissances géniales et ardues de Gaddis, et Escuela de mandarines de l'Espagnol Espinosa, un livre d'il y a quarante ans, inédit en français et pour lequel j'ai même commencé à me faire sauter quelques neurones, Dosto encore, Gadda toujours, Macedonio Fernandez enfin, et quelques autres encore. A côté de ceux-ci, il y avait ceux-là dont les livres crevaient les bacs de nouvelles sorties : l'hypnotique Krasznahorkai, deux Sorokine (dont on préfèrera largement la Tourmente au Kremlin en sucre), l'excellent Dans la nuit de samedi à dimanche de Nicole Caligaris, et le terriblement fort Désert et sa semence de Jorge Baron Biza. Mention spéciale à l'inédit de Bolano paru chez Anagrama au printemps : Los sinsabores del verdadero policia, qui doit être l'une des plus émouvantes lectures de 2011. Et forcément, plusieurs des romans de la bibliothèque FFC 2011. J'ai fini l'année avec Nuit d'Edgar Hilsenrath, à paraître dans les jours qui viennent chez Attila, et je peux vous dire que c'est un des livres dont on se souviendra lorsqu'on fera le bilan de l'année prochaine... et pour démarrer 2012 en beauté et volupté, c'est un autre chef d'oeuvre auquel je me coltine qu'on ne peut pas dire tout frais puisqu'il a été publié pour la première fois en 1979, mais en aucun cas du réchauffé : Marinus et Marina de Claude Louis-Combet, puissante mystique du corps dans une langue flamboyante sans pareil. —AW.
 On ne saurait commencer une année sous des signes aussi différents. Mon premier livre de 2011 était une sélection de textes de John Gray, une dissection philosophique et politique de toutes nos illusions particulièrement bienvenue à l'aube d'une année dont le seul mérite aura été d'être moins dure que la suivante. Mon second livre était The Gentleman's Companion, an exotic drinking book de Charles H. Baker Jr., tout de suite bien plus joyeux. Baker, correspondant gastronomique d'Esquire ramène des recettes des quatre coins du globe et nous en fait l'histoire dans un très beau style légèrement suranné. Tout cela nous vient d'une époque où l'on pouvait écrire des choses comme "ce cocktail a été inventé dans l'hôtel X où nous étions réfugiés alors que la marine bombardait la ville". Entre la vision sans complaisance et souvent plutôt déplaisante de Gray et les effluves éthyliques de Baker, on m'excusera d'avoir traversé l'année à tâtons, d'autant plus qu'avec deux traductions, mon temps de lecture s'est tout de même réduit presque exclusivement à ces deux livres. Heureusement, avant et après, j'ai quand même pu glisser, comme l'ami Pierre, du Gadda (je suis revenu à la surface pour respirer un coup avant, je l'espère, de m'y replonger en 2012) et du Coover (le chef-d'œuvre John's wife, monument trop ignoré de la fin du XXe). J'ai aussi enfin lu Le temps où nous chantions de Richard Powers, un des écrivains préférés du FFC (preuve en est donnée encore et encore au long de cet autre 2011). Soyons honnêtes : avec un tel pitch (si vous ne l'avez pas lu, google is your friend), hors de question de l'acheter s'il n'y avait pas ce nom sur la couverture. De ce qu'un autre aurait fait un mélo familial bien pensant, Powers compose un roman d'une finesse et d'une beauté absolument inouïe, juste, pointu et exigeant d'un bout à l'autre. Mais la surprise de l'année, c'est le Zazen de Vanessa Veselka. Sur deux cents pages impeccables, le récit de la pré-apocalypse liberal hipster. Hilarant, foutrement intelligent, une ballade dans le passé, le présent et même le futur de la fringe politique américaine, une radioscopie jamais malveillante, jamais complaisante dont je ne désespère pas de vous parler plus en détail dans les semaines qui viennent. Je n'ai rien lu de plus politiquement subtil depuis Lydia Millet. Ce n'est peut-être pas un hasard : l'éditeur de Veselka a longtemps été celui de Millet. Enfin, beaucoup de ciné cette année. Je me suis prêté pour Juan Francisco Ferré à l'exercice des listes.
—FM.
On ne saurait commencer une année sous des signes aussi différents. Mon premier livre de 2011 était une sélection de textes de John Gray, une dissection philosophique et politique de toutes nos illusions particulièrement bienvenue à l'aube d'une année dont le seul mérite aura été d'être moins dure que la suivante. Mon second livre était The Gentleman's Companion, an exotic drinking book de Charles H. Baker Jr., tout de suite bien plus joyeux. Baker, correspondant gastronomique d'Esquire ramène des recettes des quatre coins du globe et nous en fait l'histoire dans un très beau style légèrement suranné. Tout cela nous vient d'une époque où l'on pouvait écrire des choses comme "ce cocktail a été inventé dans l'hôtel X où nous étions réfugiés alors que la marine bombardait la ville". Entre la vision sans complaisance et souvent plutôt déplaisante de Gray et les effluves éthyliques de Baker, on m'excusera d'avoir traversé l'année à tâtons, d'autant plus qu'avec deux traductions, mon temps de lecture s'est tout de même réduit presque exclusivement à ces deux livres. Heureusement, avant et après, j'ai quand même pu glisser, comme l'ami Pierre, du Gadda (je suis revenu à la surface pour respirer un coup avant, je l'espère, de m'y replonger en 2012) et du Coover (le chef-d'œuvre John's wife, monument trop ignoré de la fin du XXe). J'ai aussi enfin lu Le temps où nous chantions de Richard Powers, un des écrivains préférés du FFC (preuve en est donnée encore et encore au long de cet autre 2011). Soyons honnêtes : avec un tel pitch (si vous ne l'avez pas lu, google is your friend), hors de question de l'acheter s'il n'y avait pas ce nom sur la couverture. De ce qu'un autre aurait fait un mélo familial bien pensant, Powers compose un roman d'une finesse et d'une beauté absolument inouïe, juste, pointu et exigeant d'un bout à l'autre. Mais la surprise de l'année, c'est le Zazen de Vanessa Veselka. Sur deux cents pages impeccables, le récit de la pré-apocalypse liberal hipster. Hilarant, foutrement intelligent, une ballade dans le passé, le présent et même le futur de la fringe politique américaine, une radioscopie jamais malveillante, jamais complaisante dont je ne désespère pas de vous parler plus en détail dans les semaines qui viennent. Je n'ai rien lu de plus politiquement subtil depuis Lydia Millet. Ce n'est peut-être pas un hasard : l'éditeur de Veselka a longtemps été celui de Millet. Enfin, beaucoup de ciné cette année. Je me suis prêté pour Juan Francisco Ferré à l'exercice des listes.
—FM.
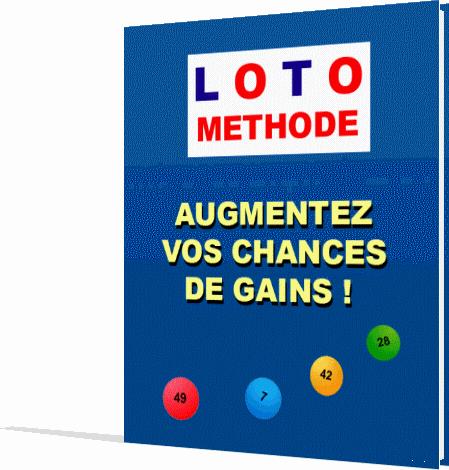 Émerveillement princier, elle ne croit pas si bien dire la voix off, là-haut. Parce que pour ne rien vous cacher, c'est la première fois que j'ai six bons numéros au Loto !
Le seul problème, et là ça devient nettement moins princier, c'est que comme 100% des perdants nationaux, je n'ai rien gagné - pour une fois que j'avais six numéros sur les douze de la bibliothèque Fric-Frac 2011 (je ne dirai rien du numéro complémentaire J.R que tout le monde m'a refusé même si, soi-disant, il aurait dû figurer parmi les gagnants, qu'ils m'ont dit - je n'ai pas tout saisi. ça, en revanche, ça ne change jamais - passons.)
Ouaip, six sur douze !
Pas peu fier je suis, serais-je tenté de yoder (j'en ai l'âge mais pas les oreilles).
Ah.
On me souffle dans l'oreillette - une voix grave, asthmatique (pour laquelle je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue aujourd'hui que Luke est orphelin) - que OK, c'est bon, là. Maintenant tu embrayes sur ton autre 2011.
Dont acte.
Hormis les six (1 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11), 2011 aura été l'année des lectures denses (voir Les Instructions du côté de la bibliothèque Fric-Frac 2011 - pas franchement un livre de poche ) et des lectures claques.
En claques, me reviennent Les Foudroyés, de Paul Harding, même si y entrer demande d'ouvrir ses chakras, Tout et plus encore une histoire compacte de l'infini (parce que David Foster Wallace aux commandes d'un, disons, cours de maths, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner), Richard Powers avec son Générosité. Et j'en oublie (ce n'est pas que ma mémoire défaille, mais plutôt que j'ai dû ranger ma bibliothèque et que du coup je ne m'y retrouve plus - Mme g@rp, en revanche, trouve ça nettement mieux...
Un que je suis incapable d'oublier, c'est le trop méconnu Werner Kofler.
Découvert pendant l'année avec Derrière mon bureau, son triptyque alpestre
Émerveillement princier, elle ne croit pas si bien dire la voix off, là-haut. Parce que pour ne rien vous cacher, c'est la première fois que j'ai six bons numéros au Loto !
Le seul problème, et là ça devient nettement moins princier, c'est que comme 100% des perdants nationaux, je n'ai rien gagné - pour une fois que j'avais six numéros sur les douze de la bibliothèque Fric-Frac 2011 (je ne dirai rien du numéro complémentaire J.R que tout le monde m'a refusé même si, soi-disant, il aurait dû figurer parmi les gagnants, qu'ils m'ont dit - je n'ai pas tout saisi. ça, en revanche, ça ne change jamais - passons.)
Ouaip, six sur douze !
Pas peu fier je suis, serais-je tenté de yoder (j'en ai l'âge mais pas les oreilles).
Ah.
On me souffle dans l'oreillette - une voix grave, asthmatique (pour laquelle je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue aujourd'hui que Luke est orphelin) - que OK, c'est bon, là. Maintenant tu embrayes sur ton autre 2011.
Dont acte.
Hormis les six (1 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11), 2011 aura été l'année des lectures denses (voir Les Instructions du côté de la bibliothèque Fric-Frac 2011 - pas franchement un livre de poche ) et des lectures claques.
En claques, me reviennent Les Foudroyés, de Paul Harding, même si y entrer demande d'ouvrir ses chakras, Tout et plus encore une histoire compacte de l'infini (parce que David Foster Wallace aux commandes d'un, disons, cours de maths, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner), Richard Powers avec son Générosité. Et j'en oublie (ce n'est pas que ma mémoire défaille, mais plutôt que j'ai dû ranger ma bibliothèque et que du coup je ne m'y retrouve plus - Mme g@rp, en revanche, trouve ça nettement mieux...
Un que je suis incapable d'oublier, c'est le trop méconnu Werner Kofler.
Découvert pendant l'année avec Derrière mon bureau, son triptyque alpestre  J'avais des tonnes de chiffres sous le coude, des pourcentages, au quintal, sur des lectures croisées. J'avais aussi une liste complète des livres lus en 2011, presque 50 dont 4 abandonnés avant la trentième page (le ratio n'est pas mauvais), commençant par Goliath de Borgese, écrit en 37, en plein exil, pour atterrir sur l'énorme Motorman qui ne fit que 164 pages d'émerveillement. Au milieu de tout ça pas mal de bandes dessinées dont la découverte tardive de Brecht Evens. Lisez Les Amateurs si vous voulez sauver votre âme. Un David Foster Wallace en roi tout pâle. Gadda + Volponi + Les Écrits Corsaires = le combo spaghetti magique, sublime en tout point. Pas mal de merdes aussi, souvent en français. Des bons trucs en français quand même... ça arrive. Bref, j'avais de quoi faire un machin maousse, avec des cris de guerre & tout.
J'avais des tonnes de chiffres sous le coude, des pourcentages, au quintal, sur des lectures croisées. J'avais aussi une liste complète des livres lus en 2011, presque 50 dont 4 abandonnés avant la trentième page (le ratio n'est pas mauvais), commençant par Goliath de Borgese, écrit en 37, en plein exil, pour atterrir sur l'énorme Motorman qui ne fit que 164 pages d'émerveillement. Au milieu de tout ça pas mal de bandes dessinées dont la découverte tardive de Brecht Evens. Lisez Les Amateurs si vous voulez sauver votre âme. Un David Foster Wallace en roi tout pâle. Gadda + Volponi + Les Écrits Corsaires = le combo spaghetti magique, sublime en tout point. Pas mal de merdes aussi, souvent en français. Des bons trucs en français quand même... ça arrive. Bref, j'avais de quoi faire un machin maousse, avec des cris de guerre & tout.
Mais avez-vous lu Great Jones Street de DeLillo ? Parce que je voudrais parler de ce livre plutôt que du reste en fait. Un livre tout à fait indiqué par les temps qui courent.
J'ai entendu dire que Great Jones Street (que nous appellerons GJS par égard pour mon canal carpien) était un roman sur le rock. Bêtise. J'ai aussi entendu dire que ce troisième roman de DeLillo (paru en 73, faites le calcul... ça fait presque 40 ans de retard) était touffu, labyrinthique, baroque. Couillonade. Tout bavard qu'il est c'est l'un des plus beaux livres jamais écrits sur le silence. Sur sa perfection rédemptrice. C'est aussi un truc bien foutu sur la fin annoncée d'une période bénie qui tenait en équilibre sur un bon kilo d'herbe. A l'époque où Houghton Mifflin sort le bouquin les Beatles s'étaient déjà mis à l'envers pour d'horribles histoires de fric & de pomme moisie. Deux hippies allaient bientôt vendre des litrons de Cookies Dough à la terre entière & Kissinger, qui n'a jamais eu les cheveux longs, obtenir un prix Nobel de la paix pour l'ensemble de son œuvre. Roman à clés pop, cartographie géniale d'un monde qui s'est pourri tout seul, GJS est d'une beauté sèche troublante à bien des égards. On y trouve des dialogues somptueux enroulés autour d'une paranoïa presque apaisante. Transformer une heure de lecture en retraite lointaine est une chose sans prix. Si en plus ça redonne confiance en un auteur qu'on avait un peu perdu de vue, on pourra se dire que 2011 n'aura pas été vain. Bon allez, je vais aller écouter Glory Be pour le trentième fois de la journée. —LB.
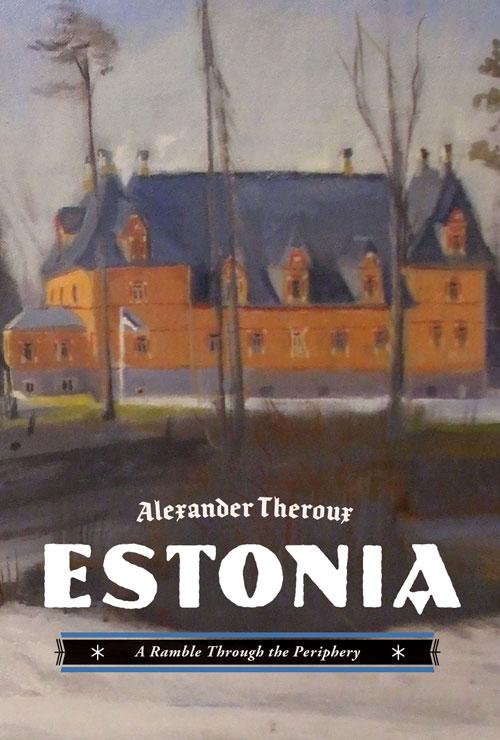 Alexander Theroux est l'un de mes auteurs préférés, toutes littératures, tous pays, toutes époques confondues. Sorte de croisement inouï entre les grands érudits britanniques (Burton, Browne), les pré-modernistes truculents (Ronald Firbank, Baron Corvo), ses collègues de chaire postmodernistes (Guy Davenport, Gass et Pynchon) et bien sur Borgès et Melville, il illustre exactement ce que Barthes entendait, je crois, par “paradis lisible”. C'est le maximaliste ultime, un collectionneur insatiable de mots rares qui concentre et emmêle tous les paradoxes de la modernité et de la postmodernité dans une oeuvre qui fait mine de ne regarder que vers le passé. Un certain Proust a bien sûr tissé quelque chose de similaire avec cette singularité. Proustophile obsessionnel, érudit de la Bible du roi Jacques (il fut séminariste dans sa jeunesse), Alexander Theroux a écrit plusieurs grands livres qui “épuisent les superlatifs” dont au moins un chef d'oeuvre historique et incontestable, Darconville's Cat en 1981. Mais l'histoire de la littérature a ses voies inexplicables, et ses petits frères Paul et Peter, pourtant auteurs de livres médiocres, se trouvent bien plus facilement en librairie que lui : Darconville's Cat n'a jamais été republié, et l'immense, monstrueux Laura Warholic, “le Moby Dick de la misanthropie” a été publié en dernier recours par Fantagraphics, éditeur bien connus de comics alternatifs. Estonia, que publie également Fantagraphics, n'est pas un roman ; c'est un livre de voyages, dans la lignée évidente du Voyage Sentimental de Sterne. L'Estonie est moins son sujet que son prétexte, ou la flamme qui a embrasé sa mêche : Theroux s'est trouvé habiter dans le petit État balte en y suivant sa femme, récipiendaire “bienheureuse” d'une bourse Fulbright, et écrit au moins autant sur le pays, sa culture et ses habitants que sur lui-même. “I daresay my Estonia is as much about me and my crochets as it is about anything else“. Point d'entrée magique précisée dans le tout dernier chapitre, l'Estonie est un pays très essentiellement “elliptique” et c'est en soulevant autant de pierres qu'il a pu trouver que Theroux a opèré son paradoxal détour en lui-même. Au premier plan, donc, Estonia est une petite encyclopédie démente et immensément détaillée sur le petit pays, pleine de faits, de légendes et de funny facts sur son histoire, sa langue, ses moeurs, sa nourriture, ses bars, ses habitants, ses expats, ses bars et ses librairies ; au deuxième, les tours d'esprit si singuliers de Theroux (avalanches de citations plus ou moins incongrues, d'élucubrations, digressions et songeries tumorales), déforment bien sûr les faits compilés dans des proportions endémiques jusqu'à submerger le sujet sous la focale et faire ployer la colonne vertébrale du livre. Le sous-titre, “A Ramble Through The Periphery”, évoque autant les circonvolutions de Theroux dans ce petit État de la marge que dans le monde de sa littérature. C'est le livre le plus drôle et le plus intelligent que j'ai lu en 2011. C'est un modèle absolu de littérature, hardi jusqu'à la démence, dont l'audace est une revendication, une protestation, un manifeste de tous les instants. Je recopie pour finir ces propos de l'auteur, extraits d'un entretien avec Steven Moore dans les années 80, parce qu'ils disent mieux que je ne pourrais le faire le genre de modèle dont on parle : I put the writers of bumphable, ready-to-wear prose, calculated to sell, guaranteed not to shock, in the same category as artists who can't draw. There is a lack of bravery and a lot of fraud in them. I have never tried to write a book that didn't attempt something new in the way of narrative technique. Writing is an assault on cliché.”
—OL.
Alexander Theroux est l'un de mes auteurs préférés, toutes littératures, tous pays, toutes époques confondues. Sorte de croisement inouï entre les grands érudits britanniques (Burton, Browne), les pré-modernistes truculents (Ronald Firbank, Baron Corvo), ses collègues de chaire postmodernistes (Guy Davenport, Gass et Pynchon) et bien sur Borgès et Melville, il illustre exactement ce que Barthes entendait, je crois, par “paradis lisible”. C'est le maximaliste ultime, un collectionneur insatiable de mots rares qui concentre et emmêle tous les paradoxes de la modernité et de la postmodernité dans une oeuvre qui fait mine de ne regarder que vers le passé. Un certain Proust a bien sûr tissé quelque chose de similaire avec cette singularité. Proustophile obsessionnel, érudit de la Bible du roi Jacques (il fut séminariste dans sa jeunesse), Alexander Theroux a écrit plusieurs grands livres qui “épuisent les superlatifs” dont au moins un chef d'oeuvre historique et incontestable, Darconville's Cat en 1981. Mais l'histoire de la littérature a ses voies inexplicables, et ses petits frères Paul et Peter, pourtant auteurs de livres médiocres, se trouvent bien plus facilement en librairie que lui : Darconville's Cat n'a jamais été republié, et l'immense, monstrueux Laura Warholic, “le Moby Dick de la misanthropie” a été publié en dernier recours par Fantagraphics, éditeur bien connus de comics alternatifs. Estonia, que publie également Fantagraphics, n'est pas un roman ; c'est un livre de voyages, dans la lignée évidente du Voyage Sentimental de Sterne. L'Estonie est moins son sujet que son prétexte, ou la flamme qui a embrasé sa mêche : Theroux s'est trouvé habiter dans le petit État balte en y suivant sa femme, récipiendaire “bienheureuse” d'une bourse Fulbright, et écrit au moins autant sur le pays, sa culture et ses habitants que sur lui-même. “I daresay my Estonia is as much about me and my crochets as it is about anything else“. Point d'entrée magique précisée dans le tout dernier chapitre, l'Estonie est un pays très essentiellement “elliptique” et c'est en soulevant autant de pierres qu'il a pu trouver que Theroux a opèré son paradoxal détour en lui-même. Au premier plan, donc, Estonia est une petite encyclopédie démente et immensément détaillée sur le petit pays, pleine de faits, de légendes et de funny facts sur son histoire, sa langue, ses moeurs, sa nourriture, ses bars, ses habitants, ses expats, ses bars et ses librairies ; au deuxième, les tours d'esprit si singuliers de Theroux (avalanches de citations plus ou moins incongrues, d'élucubrations, digressions et songeries tumorales), déforment bien sûr les faits compilés dans des proportions endémiques jusqu'à submerger le sujet sous la focale et faire ployer la colonne vertébrale du livre. Le sous-titre, “A Ramble Through The Periphery”, évoque autant les circonvolutions de Theroux dans ce petit État de la marge que dans le monde de sa littérature. C'est le livre le plus drôle et le plus intelligent que j'ai lu en 2011. C'est un modèle absolu de littérature, hardi jusqu'à la démence, dont l'audace est une revendication, une protestation, un manifeste de tous les instants. Je recopie pour finir ces propos de l'auteur, extraits d'un entretien avec Steven Moore dans les années 80, parce qu'ils disent mieux que je ne pourrais le faire le genre de modèle dont on parle : I put the writers of bumphable, ready-to-wear prose, calculated to sell, guaranteed not to shock, in the same category as artists who can't draw. There is a lack of bravery and a lot of fraud in them. I have never tried to write a book that didn't attempt something new in the way of narrative technique. Writing is an assault on cliché.”
—OL.
 Dans l'ordre chronologique de lecture, choisis parmi bien d'autres, il y a d'abord eu les Trois fermiers s'en vont au bal de Richard Powers, dont l'extraordinaire entrelacement du passé et du présent, de l'essai et de la fiction, de l'Histoire et des sentiments humains, m'a laissé stupéfait – d'une force qui, s'ils étaient raisonnables et clairvoyants, pousserait bien des apprentis-sorciers de l'écriture à poser le crayon et fermer l'ordi. Ensuite j'ai fais connaissance avec la prose compacte, irriguée de courants sombres, noire et cassante comme du charbon, de La Connaissance de la douleur de Carlo Emilio Gadda, roman hautain, mystérieux, mais d'une splendeur ténébreuse qui ne vous lâche pas, et dont l'inachèvement ne préjuge en rien de son caractère magistral (bien supérieur, à mon sens, au pourtant plus célèbre Affreux pastis de la rue des Merles). Une fois Gadda lu, la célébrité française d'Umberto Eco paraît presque un scandale : je ne vois pas de manière moins abrupte de le dire.
Les essais-promenades autour des couleurs écrits par Alexander Theroux (The Primary Colors et son jumeau The Secondary Colors) ne sont pas seulement l'occasion de saisir, fut-ce de biais, que Theroux est un maître de la prose anglaise et que sa culture littéraire, en particulier poétique, est d'une immensité prodigieuse : ces inlassables variations autour de l'orange ou du vert sont aussi, pour le lecteur français, de voir s'entrouvrir d'innombrables portes sur des poètes ou des romanciers, anciens ou modernes, encore trop méconnus par ici. Une manière comme une autre d'arpenter sa bibliothèque et sa mémoire (les deux vont ensemble), et qui n'apporte à son lecteur que de la joie émerveillée. La grande lecture de l'année a été celle des Reconnaissances de William Gaddis (en anglais, s'il-vous-plait), petit Everest personnel dont je n'ai pas encore réalisé que je l'avais enfin escaladé. Nul besoin de maîtriser du premier coup tous les tunnels secrets de cette inépuisable montagne littéraire à la descendance prestigieuse : il suffit, dans un premier temps, d'en avoir apprécié les phrases extraordinairement souples et variées, hautement musicales, jusqu'à sonner comme du Schönberg dans les longues discussions des "parties" qui rythment le livre ; d'en avoir effleuré les multiples implications littéraires, religieuses, voire même politiques ; et surtout d'en être ressorti avec au cœur la récompense de se sentir la respiration un peu plus vaste et l'esprit beaucoup plus élargi. Le Ville Fantôme de Robert Coover n'est certainement pas la énième creuse démonstration postmoderne que certains y voient : c'est, au contraire, un des livres les plus séduisants, et à la fois le plus picaresque et le plus mélancolique, que j'aie lu cette année. Peu importe que son héros, un "Kid" anonyme et désabusé dont on se prend vite à imiter les répliques laconiques (des "chaipas" et des "pourkoipas" irrésistibles, mille mercis au traducteur Bernard Hoepffner), n'ait pas l'épaisseur psychologique soi-disant requise. Silhouette fragile parmi les faux-semblants du mythe far-westien revisité, il n'en est pas moins présent et émouvant, comme lorsqu'il console comme un animal errant, au fond d'une mine, une locomotive rebelle presque douée d'une âme – une scène magnifique parmi bien d'autres. Je n'oublie pas Les Mêmes yeux que Lost, l'essai de Pacôme Thiellement consacré à la célèbre série américaine, et qui, avec la dextérité du magicien qui vous transforme un banal chiffon en tapisserie mille-fleurs via son chapeau sans fond, a réussi à mes yeux cet exploit : transformer en monument fictionnel imagé, fabuleusement séduisant et enthousiasmant, riche de ramifications insoupçonnées et d'une construction interne imparable, une série qui n'a jamais réussi à me convaincre totalement par elle-même.
Enfin, j'ai terminé 2011 et commencé 2012 en ayant une grande, une immense chance : lire pour la première fois Arno Schmidt, celui des Scènes de la vie d'un faune et du Cœur de pierre, avec ses kaléïdoscopes de sensations, ses fragments acérés de paysages, ses diatribes politiques et ses digressions savantes, son ton fantasque et électrisant qui séduit et étonne en permanence. Plus qu'une envie maintenant : lire la suite et vite !
-PP
Dans l'ordre chronologique de lecture, choisis parmi bien d'autres, il y a d'abord eu les Trois fermiers s'en vont au bal de Richard Powers, dont l'extraordinaire entrelacement du passé et du présent, de l'essai et de la fiction, de l'Histoire et des sentiments humains, m'a laissé stupéfait – d'une force qui, s'ils étaient raisonnables et clairvoyants, pousserait bien des apprentis-sorciers de l'écriture à poser le crayon et fermer l'ordi. Ensuite j'ai fais connaissance avec la prose compacte, irriguée de courants sombres, noire et cassante comme du charbon, de La Connaissance de la douleur de Carlo Emilio Gadda, roman hautain, mystérieux, mais d'une splendeur ténébreuse qui ne vous lâche pas, et dont l'inachèvement ne préjuge en rien de son caractère magistral (bien supérieur, à mon sens, au pourtant plus célèbre Affreux pastis de la rue des Merles). Une fois Gadda lu, la célébrité française d'Umberto Eco paraît presque un scandale : je ne vois pas de manière moins abrupte de le dire.
Les essais-promenades autour des couleurs écrits par Alexander Theroux (The Primary Colors et son jumeau The Secondary Colors) ne sont pas seulement l'occasion de saisir, fut-ce de biais, que Theroux est un maître de la prose anglaise et que sa culture littéraire, en particulier poétique, est d'une immensité prodigieuse : ces inlassables variations autour de l'orange ou du vert sont aussi, pour le lecteur français, de voir s'entrouvrir d'innombrables portes sur des poètes ou des romanciers, anciens ou modernes, encore trop méconnus par ici. Une manière comme une autre d'arpenter sa bibliothèque et sa mémoire (les deux vont ensemble), et qui n'apporte à son lecteur que de la joie émerveillée. La grande lecture de l'année a été celle des Reconnaissances de William Gaddis (en anglais, s'il-vous-plait), petit Everest personnel dont je n'ai pas encore réalisé que je l'avais enfin escaladé. Nul besoin de maîtriser du premier coup tous les tunnels secrets de cette inépuisable montagne littéraire à la descendance prestigieuse : il suffit, dans un premier temps, d'en avoir apprécié les phrases extraordinairement souples et variées, hautement musicales, jusqu'à sonner comme du Schönberg dans les longues discussions des "parties" qui rythment le livre ; d'en avoir effleuré les multiples implications littéraires, religieuses, voire même politiques ; et surtout d'en être ressorti avec au cœur la récompense de se sentir la respiration un peu plus vaste et l'esprit beaucoup plus élargi. Le Ville Fantôme de Robert Coover n'est certainement pas la énième creuse démonstration postmoderne que certains y voient : c'est, au contraire, un des livres les plus séduisants, et à la fois le plus picaresque et le plus mélancolique, que j'aie lu cette année. Peu importe que son héros, un "Kid" anonyme et désabusé dont on se prend vite à imiter les répliques laconiques (des "chaipas" et des "pourkoipas" irrésistibles, mille mercis au traducteur Bernard Hoepffner), n'ait pas l'épaisseur psychologique soi-disant requise. Silhouette fragile parmi les faux-semblants du mythe far-westien revisité, il n'en est pas moins présent et émouvant, comme lorsqu'il console comme un animal errant, au fond d'une mine, une locomotive rebelle presque douée d'une âme – une scène magnifique parmi bien d'autres. Je n'oublie pas Les Mêmes yeux que Lost, l'essai de Pacôme Thiellement consacré à la célèbre série américaine, et qui, avec la dextérité du magicien qui vous transforme un banal chiffon en tapisserie mille-fleurs via son chapeau sans fond, a réussi à mes yeux cet exploit : transformer en monument fictionnel imagé, fabuleusement séduisant et enthousiasmant, riche de ramifications insoupçonnées et d'une construction interne imparable, une série qui n'a jamais réussi à me convaincre totalement par elle-même.
Enfin, j'ai terminé 2011 et commencé 2012 en ayant une grande, une immense chance : lire pour la première fois Arno Schmidt, celui des Scènes de la vie d'un faune et du Cœur de pierre, avec ses kaléïdoscopes de sensations, ses fragments acérés de paysages, ses diatribes politiques et ses digressions savantes, son ton fantasque et électrisant qui séduit et étonne en permanence. Plus qu'une envie maintenant : lire la suite et vite !
-PP
 A l'inverse de certains de mes petits camarades, je ne tiens pas de listes de mes lectures de l'année. Je ne fais donc que jeter un vague regard sur ma bibliothèque dans l'espoir qu'une tranche, qu'un nom d'auteur ou d'ouvrage s'impose à moi et se rappelle à mon bon souvenir pour avoir été lu dans l'année. Je n'ai donc pas lu l'intégralité de la Recherche cette année, mais au moins les 4 premiers volumes, trébuchant sur La prisonnière à l'orée du mois de décembre. Entre temps, on aura lu le dernier roman de Colson Whitehead, Zone One, brillant roman de zombies qui montre que la mollesse et l'indolence de Walking Dead (la série télé, pas le comics) n'est pas la seule manière d'aborder le genre. On a attaqué un rattrapage en grands maitres pomos, avec du Delillo (End Zone et Underworld (pas encore terminé celui-là), et Richard Powers avec le génialissime Gain, que l'on espère très prochainement traduit. On a fait des découvertes, comme Patrick Deville avec Pura Vida, qui retrace quelques unes des épopées révolutionnaires foirées en Amérique latine, et portrait en creux de losers héroïques (pas tous, en réalité). On a repris le flambeau en se pâment devant Iain Sinclair (London Orbital) et Reinhard Jirgl (Les Inachevés),et enfin on a un peu baillé devant Le lièvre de Patagonie de Claude Lanzmann, même si la matière de cette egohistoire reste passionnante. En 2012, l'on continuera donc ce qui a été semé, se promettant une fois de plus de ne pas tenir ses promesses.
-T
A l'inverse de certains de mes petits camarades, je ne tiens pas de listes de mes lectures de l'année. Je ne fais donc que jeter un vague regard sur ma bibliothèque dans l'espoir qu'une tranche, qu'un nom d'auteur ou d'ouvrage s'impose à moi et se rappelle à mon bon souvenir pour avoir été lu dans l'année. Je n'ai donc pas lu l'intégralité de la Recherche cette année, mais au moins les 4 premiers volumes, trébuchant sur La prisonnière à l'orée du mois de décembre. Entre temps, on aura lu le dernier roman de Colson Whitehead, Zone One, brillant roman de zombies qui montre que la mollesse et l'indolence de Walking Dead (la série télé, pas le comics) n'est pas la seule manière d'aborder le genre. On a attaqué un rattrapage en grands maitres pomos, avec du Delillo (End Zone et Underworld (pas encore terminé celui-là), et Richard Powers avec le génialissime Gain, que l'on espère très prochainement traduit. On a fait des découvertes, comme Patrick Deville avec Pura Vida, qui retrace quelques unes des épopées révolutionnaires foirées en Amérique latine, et portrait en creux de losers héroïques (pas tous, en réalité). On a repris le flambeau en se pâment devant Iain Sinclair (London Orbital) et Reinhard Jirgl (Les Inachevés),et enfin on a un peu baillé devant Le lièvre de Patagonie de Claude Lanzmann, même si la matière de cette egohistoire reste passionnante. En 2012, l'on continuera donc ce qui a été semé, se promettant une fois de plus de ne pas tenir ses promesses.
-T
