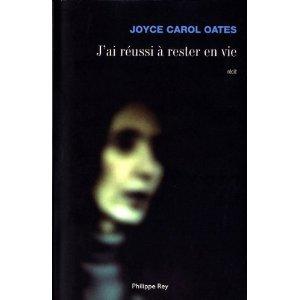 Avoir été jury du Grand prix des lectrices de ELLE et publier aussi régulièrement des chroniques littéraires me vaut de recevoir des livres avant parution en librairie. Ajoutez que je possède plusieurs cartes de bibliothèque et devinez l’éventail de lecture qui m’est offert.
Avoir été jury du Grand prix des lectrices de ELLE et publier aussi régulièrement des chroniques littéraires me vaut de recevoir des livres avant parution en librairie. Ajoutez que je possède plusieurs cartes de bibliothèque et devinez l’éventail de lecture qui m’est offert.Ayant la culpabilité facile quand mes yeux mesurent la hauteur de la pile des ouvrages en attente vous comprendrez que je n’en rajoute pas en allant en acheter. Pourtant si. J’ai spécialement choisi Pas d’inquiétude de Brigitte Giraud (dont je parlerai un autre jour) et J’ai réussi à rester en vie de Joyce Carol Oates à la mi-décembre alors que tout allait encore bien et que j’estimais la couverture d’une laideur repoussante.
Les livres vieillissent chez moi un peu comme des bouteilles ou des fromages le feraient en cave. Le temps d’affinage varie selon ... Les deux ouvrages ont donc rejoint l'étagère de réserve.
Nombre d’écrivains disent qu’il y a toujours un livre qui vous attend quelque part. Et c’est vrai. L’occasion ne tarda pas. Quelques jours après l’enterrement, sonnée bien sûr, j’ai ouvert le récit de Joyce, avec la certitude d’accomplir un acte qui aurait valeur d'apaisement.
Aujourd'hui professeur honoraire de l'université de Princeton, où elle a longtemps enseigné et réside toujours, cet auteur prolifique a publié près de soixante-dix livres - romans, essais, nouvelles, théâtre, poésie - dont le célèbre Blonde, inspiré de la vie de Marilyn Monroe et qui a servi de trame à John Arnold pour Norma Jean, un spectacle que j’ai récemment chroniqué. Je n’avais néanmoins encore lu aucun Carol Oates. Petite soeur, grande soeur attend encore sur le même rayonnage.
J’ai réussi à rester en vie ne m’a pas bouleversée. Il m’a remise sur les rails.
Profondément ancré dans la culture américaine, le livre abonde de références qui le situe clairement outre-atlantique. Son auteur aborde des sujets qui nous sont étrangers, comme la désertion des quartiers dès qu’une famille de couleur s’y installe (page 386). Elle recense évidemment les us et coutumes pratiqués là-bas en matière de deuil. Mais, loin d’être anecdotique, la force du livre est d’être universelle. Chacun fait un jour ou l'autre l'expérience du chagrin.
Joyce Carol Oates explore ce qui se passe dans son cerveau et dans son coeur avant, et pendant la première année qui suit la mort de son mari, après « quarante-sept ans et vingt-sept jours » de bonheur paisible. Elle le fait sans aucun tabou, mais avec pudeur, avec réalisme mais avec distance, sans édulcorer les moments les plus noirs, ni rejeter les instants qui prêtes à sourire, jusqu’à cette boucle d’oreille adorée qu‘elle retrouve dans les détritus d’une poubelle renversée par des raton-laveurs.
Cela peut vous sembler curieux que je qualifie ce livre de lumineux. Joyce Carol Oates devient au fil des pages une personne attachante. Chacun de nous aura de l’intérêt à le lire. Il me semble être une oeuvre majeure dont je trouve qu’on n’a pas beaucoup parlé. Joyce Carol Oates est régulièrement annoncée parmi les nobélisables en littérature. Peut-être celui-ci lui apportera-t-il la consécration qu’elle mérite, et permettra du même coup d’élargir sa diffusion.
Pour vous qui voudriez des arguments avant de plonger dans ce récit j’ai fait une lecture attentive dont je vous livre l’essentiel. Les autres pourront arrêter ici leur lecture, quitte à y revenir un autre jour ... si besoin. Contrairement à la pratique habituelle je n’ai pas recopié les citations en italiques, mais j’ai choisi une couleur de caractères qui vous permettra de les distinguer. J’ai réservé l’emploi des italiques pour les termes que l’auteur elle-même a fait figurer sous cette forme dans son livre, car elle en fait un usage bien particulier.** *En exergue, quatre extraits de messages de condoléances reçus par l’auteur à la mort de son mari, Raymond Smith qui à eux seuls résument toutes les attitudes possibles. Gloria Vanderbilt, à sa manière, reprend l’idée de Saint Exupéry : Ce qui sauve, c'est de faire un pas. Encore un pas. C'est toujours le même pas que l'on recommence... (Terre des hommes, p.56, Livre de Poche n°68)
Cela n’a l’air de rien mais la recommandation est essentielle.
JC Oates nous prévient illico : «Mon mari est mort, ma vie s’est effondrée». Et pourtant le titre nous le dit, elle a réussi à rester en vie, ce qui ne signifie pas d’ailleurs qu’elle ait «surmonté» l’épreuve.
La mort frappe chacun, la célébrité ne fait rien à l’affaire. L’erreur médicale non plus. On pourrait aligner les exemples célèbres. Ce n’est jamais une consolation mais cela démontre que l’injustice est aveugle et que la colère est vaine.
L'auteur analyse finement la situation dégageant précieusement le particulier du général. J’ai reconnu mes propres réactions presque une page sur deux. Et je me disais que si elle avait réussi à tenir une autre le pourrait.
J’ai lu assez vite les quelques 500 pages, pressée chaque jour d’aller retrouver cette amie dont j’avais l’impression qu’elle me tenait la main. Car Joyce ne cache rien. Elle raconte tout, mais avec un talent d’écriture énorme.
Le plus surprenant est sa capacité à prendre suffisamment de recul, malgré la tornade, pour parvenir à nous amuser avec les détails sordides, comme l’achat de poubelles supplémentaires pour contenir les cadeaux de condoléances qui finissent par pourrir sur place. les américains offrent des corbeilles de fruits et de victuailles en plus des fleurs. Comme si se gaver de foie gras ou de jambon rôti allait consoler.
Elle n’hésite pas à pointer la stupidité des comportements de ses «amis» qui clament vouloir la voir bientôt parce qu’elle leur manque beaucoup et qui remettent à plus tard un dîner, de courriel en courriel, jusqu’à l’oublier. (chapitre 39)
Elle donne même des conseils. Comme de faire des copies du certificat de décès. Beaucoup ! (page 295) Et elle l’écrit en lettres capitales. Elle est aussi capable d’auto-dérision, confiant que Ray fut le premier et le dernier homme de sa vie, le seul ... En dépit de ma réputation d’écrivain, ma vie privée a été aussi mesurée et bienséante qu’un papier peint Laura Ashley (page 310).
Voilà un livre qui fait autant rire que pleurer. Il me semble qu’on en sort plus fort et plus serein. Mais je ne sais pas quel «effet» il aurait sur quelqu’un qui ne se sentirait pas (pas encore) concerné. Mon jugement est peut-être biaisé. J’en ai recommandé la lecture à beaucoup de monde. Personne ne s’est plaint, mais ce critère est-il valable ?
L’amour qui unissait Raymond à Joyce est magnifique, évident, assez rare à voir par les temps qui courent. Ce couple m’a fait penser à celui que formaient Catherine Ringer et Fred Chichin.
Le premier des sentiments que l’on ressent à la mort d’un être cher est empreint de culpabilité. Au moins celle d’avoir été impuissant. Dans les cas extrêmes, comme ce le fut pour elle, comme pour moi, elle s’apparente à la faute :
La Future Veuve assure la mort, la perte de son mari. Alors qu’elle croit sa décision intelligente, «avisée», «raisonnable», elle le conduit dans une boite de Pétri grouillante de bactéries mortelles où en l’espace d’une semaine il succombera à une infection à staphylocoque - une infection «nosocomiale» contractée alors qu’on le traitait pour une pneumonie.Alors qu’elle s’imagine qu’il sera rentré pour le dîner, elle le condamne à ne jamais rentrer chez lui. Qu’elles en savent peu, toutes les Futures Veuves qui s'imaginent faire ce qu’il faut, en toute innocence et toute ignorance ! (page 30)
Si j’avais su que mon mari avait moins d’une semaine à vivre ... comment me serais-je comportée ? Est-il préférable de ne pas savoir ?
Pendant toute la durée de son séjour il sera apprécié, un vrai gentleman, adorable, drôle ! - comme si cela devait le sauver.
(page 32)Joyce emploie cette expression Future Veuve, avec les majuscules, comme si c’était un rôle, une sorte de Parque moderne ... parlant d’elle à la troisième personne, comme si elle s’observait dans un miroir.
Elle restitue à la perfection la confusion provoquée par les questions anodines du personnel : au cas où son coeur s’arrêterait, souhaitez-vous que des mesures extraordinaires soient prises pour le maintenir en vie ? (page 33)
La question provoquera un évanouissement, le premier de sa vie. Qui installe un état d’angoisse à l’idée de perdre le contrôle, perdre sa place, perdre sa vie. (page 39). Philosophe de formation, elle sait interroger. Par exemple (page 52) Le moi est-il le corps, ou le corps n’est-il que le réceptacle du moi ?L’insertion d’italiques et de guillemets renforce le questionnement. Le livre tient à la fois du journal, et de l’essai.
Très longtemps j’ai cru que je ne supporterais pas de vivre sans mon père et ma mère -que je ne supporterais pas de leur «survivre»- (...) Aujourd’hui, je pense différemment. Aujourd’hui je n’ai pas le choix. (page 53)
Les aller retour hôpital-maison suscitent des comportements anormaux. Elle ne fait plus la part des choses entre ce qui est urgent et ce qui ne l’est pas, ou plus. Que faut-il faire en premier, écouter le téléphone, nourrir les chats, éplucher le courrier, allumer les lumières, faire le ménage ? Elle passe de l’un à l’autre pour finalement investir une énergie maniaque à passer l’aspirateur en pleine nuit.
Il s’agit de s’abrutir en accomplissant un acte qui a une petite utilité pour conjurer la litanie des et si ... Se préparer à ce qu’un jour que le «chez nous» devienne «chez moi».
Joyce nous donne à lire les courriels qu’elle envoie et reçoit, dont elle convient qu’ils ont pris une importance plus grande que du vivant de Ray. C’est plus facile, convient-elle de dialoguer avec ses amis et connaissances par ce media plutôt qu’avec le téléphone, sans doute trop intime, ou par courrier postal, cette fois trop conventionnel. Elle ne nous cache pas qu’elle pleure sans raison, enfin c’est ce qu’elle dit alors qu’elle pressent une catastrophe majeure, et qu’elle ne se trompe pas. Petit à petit la réalité s’impose : La veuve est quelqu’un qui a découvert qu’elle n’a pas le choix. (page 91)
Le téléphone est vite devenu un objet particulier. C’est par lui que la nouvelle effrayante lui est tombée dessus. Sa sonnerie lui écorche le coeur. Mais c’est aussi le fil qui la relie encore à Ray. Elle a besoin plusieurs fois par jour, de composer son propre numéro pour entendre la voix apaisante de son mari sur le message d'accueil du répondeur,
Joyce relate les vicissitudes des obsèques, prévenant le lecteur naïf : la mort n’est pas bon marché au cas où vous vous poseriez la question (p. 108). J’ai moi-même appris qu’il existe un seul moyen d’obtenir la gratuité, et qui plus est d’une façon assez «développement durable» puisqu’il concerne ceux qui donnent leur corps à la science. D’après ce qu’on m’a rapporté c’est un beau traumatisme pour la famille au moment où l’on emporte le corps dans une housse plastique bleue, très vite après le décès.
On se pose tous la question de savoir s’il est raisonnable de voir le corps. Souvent on pense qu’il est plus sage d’éviter la scène. C’est une erreur, parce que ce moment là est crucial pour accepter la chose, et surtout parce qu’on ne peut pas différer à plus tard, quand on se sentira plus fort. Les défunts sont, en général, préparés de manière à être regardables sans chagrin supplémentaire. Joyce a une réaction de répugnance qu’elle qualifie d’enfantine, et qu’elle regrettera beaucoup ensuite. Sans pouvoir bien sûr revenir en arrière.
Il faut avoir ressenti comme elle une forme de désarroi à la question «Comment allez-vous ?» pour apprécier l’avis qu’elle donne à ce sujet, page 148. Elle ne manque pas d’à propos à suggérer d’interroger à son tour d’un : vous me trouvez comment ? regrettant que ce ne soit une infraction au code de la bienséance que de forcer son interlocuteur à reconnaitre que franchement non on ne va pas bien du tout. Les gens vous témoigneront de la compassion dans un premier temps ... mais peut-être pas dans un second. Elle brûle pourtant de répondre : Je suis au bord du suicide. Et vous ? (page 343)
Elle prévient qu’on attend de la Veuve qu’elle ait le chagrin discret, muet et stoïque (page 161) alors qu’elle se sent comme une variante du vieux Lear fou (page 341)
Assez vite l’écrivain confie la tentation du suicide, qu’elle désigne sous le nom de chose reptilienne ou encore Basilic. Elle regrette en plusieurs endroits, comme page 243, de n’avoir pas le courage d’avaler une overdose de médicaments. Elle confesse une immense sympathie, nouvelle au demeurant, pour les drogués de toutes sortes, qu’elles surnomment les blessés ambulatoires de la vie (page 317) tout en restant forte : Ma vie a beau être en ruine ... je suis résolue à ne pas être une droguée.
Elle cite l’aphorisme de Nietzche page 245 : La pensée du suicide est une puissante consolation, elle aide à passer plus d’une mauvaise nuit. Tout en soulignant que malgré sa profonde solitude et le désespoir de sa folie finale il ne s’est pas suicidé.
Elle considère le chagrin comme une maladie. une maladie à vaincre (page 333).
Le sentiment de culpabilité a un peu évolué, mais reste profondément ancré. La veuve sent au fond d’elle-même qu’elle ne devrait pas être encore en vie. Elle est perdue, effrayée - elle se sent fautive. (page 318) la veuve fautive résonne presque comme une allitération.
Elle nous donne ses «trucs» pour survivre. Ainsi elle écrit page 115 : Les actes d’une Veuve peuvent se définir comme des échappatoires rationnelles/irrationnelles au suicide. Tout acte qu’elle accomplit ou envisage d’accomplir est une échappatoire au suicide et, de ce fait, souhaitable, si naïf, ridicule ou vain qu’il soit.
Il est si difficile de résister face aux tracas administratifs, juridiques et financiers que parfois le coté émotionnel lui-même passe au second plan. Approuvant la citation de son amie Gloria placée en exergue elle explique avoir fait la découverte que chaque jour est vivable à condition d’être divisé en segments.
Le premier acte de la journée, ouvrir les yeux, est à lui seul, un mouvement qu’elle qualifie d’épuisant. Ses confidences pourraient plomber notre humeur si on n’en percevait pas l’universalité, le fait que un jour ou l’autre, nous aussi connaitrons le même chemin. Sachant qu’un homme averti en vaut deux il me semble que ce livre est une forme de parcours initiatique qui peut être bénéfique au lecteur, même s’il se sent encore éloigné de ce type de situation.
On ne s’étonne pas que sa vie quotidienne ait changé. On ne vit pas seul comme à deux. Par contre ce qui est signifiant ce sont les modifications structurelles. Comme lire ou travailler au lit, qui lui paraissaient inconvenants autrefois, nécessaires aujourd’hui. Seul endroit où l’angoisse est tenue à distance sans avoir besoin de prendre le Lorazepam prescrit par le médecin.
L’auteur raconte son quotidien. Elle est d’une honnêteté sans faille. Allant jusqu’à savourer d’être libérée de la peur des avions, qui lui faisait craindre d’être privée de revoir son mari. Maintenant je me moque que les avions s’écrasent, çà ne me préoccupe plus le moins du monde (page 277).
Une «mauvaise» nouvelle -si on m’annonçait que j’avais un cancer, par exemple- serait un soulagement en ce que Ray n'aurait pas à l’apprendre. Mais une «bonne» nouvelle impossible à partager ... voilà qui est douloureux. (page 287)
Des cerfs sont entrés dans le jardin pendant la nuit (...) et dévoré les belles tulipes de Ray (... comme) des mauvaises herbes. Je pleurerais s’il me restait des larmes. Pour la première fois, je me dis : «C’est aussi bien que Ray ne soit pas là. Cela lui aurait fait tant de peine» (page 377), tout comme la mort de son chat Reynard cette même nuit.
Le plus émouvant est sans doute le courage qu’elle déploie pour que Ray puisse être fière d’elle s’il la voyait. Elle s’échine, il n’y a pas d’autre mot, à poursuivre son oeuvre. Il s’agit de terminer le dernier numéro l’Ontario Review qu’il dirigeait.
Il avait travaillé dans son lit d'hôpital, le dernier jour de sa vie. Il serait terriblement contrarié, aujourd’hui, de savoir que la publication du numéro de mai va être retardée ... je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, chéri ! (...) Il est ridicule de penser arriver à bon port quand ne pas sombrer est le mieux qu’on puisse espérer.
Il est probable que s’acquitter de cette mission est une des voies qui lui a permis de rester en vie. Car elle confie aussi : je pense avec horreur à un futur où Ray n’existera pas.
Mais elle sature aussi à tenter d’apparaitre autrement qu’une veuve à chacune de ses interventions dans les bibliothèques. Page 253 elle s’énerverait presque : j’envisage de faire imprimer sur un tee-shirt :OUI MON MARI EST MORTOUI JE SUIS TRES TRISTEOUI C’EST TRES GENTIL A VOUS DE ME PRESENTER VOS CONDOLEANCES.ET MAINTENANT SI ON CHANGEAIT DE SUJET ?
Pourtant la compassion de ses amis lui est essentielle. Elle leur rend hommage par d’affectueux surnoms. Edmund est le Mozart de l’amitié (page 257). La lettre de l’ami du Minnesota (retranscrite in extenso page 331) est un soutien précieux pour ne pas succomber elle-même au suicide.
Les mots paraissent vains. Face à une telle catastrophe ... qu’est la mort. Ce sont eux pourtant qui la secourent. Car ils sont tout ce que nous avons pour étayer nos ruines (page 356). Poursuivre son activité professionnelle universitaire permet à son cerveau d’échapper un temps au chaos. Relire de grandes oeuvres littéraires est une autre forme d’aide, comme le Village indien d’Hemingway. Elle se fait la réflexion que cet écrivain écrit exclusivement sur la mort, avec des premier-plan et arrière-plan délibérément flous, comme flous le passé de ses personnages et les contours de leur visage.
Les mots sont un secours. Ceux qu’on lit comme ceux qu’on écrit. L’ennui, c’est que le fait brutal est que, pour être écrivain, il faut être assez fort pour écrire. Il faut en avoir la force émotionnelle et la force physique.(page 261) Elle se plaint d’avoir des sortes d’inspirations hallucinatoires, fugitives, insuffisamment longues pour donner naissance à un roman.
Dans la mesure où cette force lui manque elle ne se sent plus le droit de répondre aux interrogations que les étudiants lui adressent en tant qu’écrivain. Ce qui frappe chez JCO c’est sa rigueur, son intégrité morale intense.
Regarder un film peut aussi être nécessaire. Leaving Las Vegas qui exerce sur elle un charme étrange (page 320) alors que son mari et elle avaient refusé de le voir, avant. Elle en comprend désormais le message : n’attendre rien de plus que ... ce qui est.
Elle explique les choses au filtre de la manière qu’ils avaient d’organiser leur vie. Nous avions, dit-elle page 143, pour habitude de ne pas partager tout ce qui était perturbant, déprimant, démoralisant, ennuyeux - à moins que ce ne fût inévitable. La vie d’un écrivain comportant quantité de contrariétés en puissance (...) protéger Ray autant que possible de cet aspect de ma vie me semblait une très bonne idée. Car à quoi sert de partager ses misères avec quelqu’un, sinon à le rendre misérable lui aussi ?
C’est ainsi que j’avais exclu mon mari de la partie de ma vie qui est «Joyce Carol Oates» - c’est-à-dire de ma carrière d’écrivain.
La réciproque semble vraie puisqu’elle perçoit : Il m’a très probablement épargné quantité de choses dont je n’avais et n’aurai jamais aucune idée. (...) S’il n’avait pas de vie «secrète» (mais peut-être en avait-il une), il y avait néanmoins une face cachée de sa personnalité dont je ne savais rien.Comme quoi on peut éprouver un amour immense et non fusionnel. Même s’il s’agit aussi d’une posture ou d’une éthique personnelle. En effet elle explique aussi (page 202) que sa personne n’entre jamais en jeu dans son enseignement, sa carrière encore moins; j’aime à penser que la plupart de mes étudiants n’ont pas lu mes livres.
Elle s’étonne pourtant page 155 d’avoir gardé très peu de souvenirs de toutes les soirées passées ensemble. C’est terrifiant ... tout ce qui se perd de nos vies.
C’est page 148 que l’on comprend le choix de l’illustration de couverture : mon «moi» est un tourbillon d’atomes ressemblant assez aux tableaux les plus désintégrés de J.M.W. Turner.
Plus loin, page 263, elle souligne qu’elle se cogne dans les meubles, qu’elle a le souffle court, des problèmes d’équilibre, voit son image brouillée dans le miroir. Moi aussi je m’efface. sans personne pour me regarder, pour me nommer et m’aimer, je m’efface rapidement.
On parle des morts comme de disparus, comme s’ils avaient intentionnellement quitté notre monde. Alors que finalement ceux qui restent se sentent parfois être les fantômes de ceux qui sont partis. En ce sens la photo choisie est très évocatrice de cet état. Et le titre français beaucoup plus positif que l'original, l'Histoire d'une Veuve.
J'attends maintenant le prochain JCO avec appétit.
J'ai réussi à rester en vie de Joyce Carol Oates, récit, titre original A Widow's Story, traduit de l'anglais par Claude Seban, chez Philippe Rey, octobre 2011
Un billet pour resituer le contexte là

