 Rude réveil, où j'apprends, avant le lever du jour, la mort, hier, de Catherine Lépront. Elle avait 61 ans, avait publié une trentaine d'ouvrages, romans et nouvelles surtout (elle avait reçu, en 1992, la bourse Goncourt de la nouvelle). Et j'étais sensible à une œuvre dans laquelle une humanité complexe était portée par une écriture pleine de grâce.Ma première réaction a été pour me traiter d'imbécile (ça réveille). Je n'ai pas lu L'anglaise, le roman qu'elle a publié en janvier et que j'ai pourtant longtemps gardé près de moi avec l'intention de m'y plonger, jusqu'au moment où la déferlante de la rentrée littéraire est devenue trop forte et où il avait fallu renoncer, il y a quelques jours seulement, avec dans l'idée la volonté d'y revenir au moment où le livre sortira au format de poche.Ma deuxième réaction a été de faire remonter de loin (probablement de la fin des années 80) le seul souvenir que j'ai d'avoir vu Catherine Lépront. C'était à Saint-Quentin où se tenait alors un très excitant Festival de la nouvelle et l'écrivaine s'y trouvait pour parler d'un de ses livres. Mais elle donnait surtout l'impression de vouloir se cacher très loin du public, apeurée par le monde qui l'attendait. Touché par son attitude, je l'avais laissée à une paix toute relative et j'avais renoncé à l'interroger. Il n'y a pas eu d'autres occasions ensuite.J'ai beaucoup lu Catherine Lépront. Un peu arbitrairement, je retiens trois des articles que j'ai écrits sur autant d'ouvrages, histoire de pousser encore quelques lecteurs vers son œuvre.
Rude réveil, où j'apprends, avant le lever du jour, la mort, hier, de Catherine Lépront. Elle avait 61 ans, avait publié une trentaine d'ouvrages, romans et nouvelles surtout (elle avait reçu, en 1992, la bourse Goncourt de la nouvelle). Et j'étais sensible à une œuvre dans laquelle une humanité complexe était portée par une écriture pleine de grâce.Ma première réaction a été pour me traiter d'imbécile (ça réveille). Je n'ai pas lu L'anglaise, le roman qu'elle a publié en janvier et que j'ai pourtant longtemps gardé près de moi avec l'intention de m'y plonger, jusqu'au moment où la déferlante de la rentrée littéraire est devenue trop forte et où il avait fallu renoncer, il y a quelques jours seulement, avec dans l'idée la volonté d'y revenir au moment où le livre sortira au format de poche.Ma deuxième réaction a été de faire remonter de loin (probablement de la fin des années 80) le seul souvenir que j'ai d'avoir vu Catherine Lépront. C'était à Saint-Quentin où se tenait alors un très excitant Festival de la nouvelle et l'écrivaine s'y trouvait pour parler d'un de ses livres. Mais elle donnait surtout l'impression de vouloir se cacher très loin du public, apeurée par le monde qui l'attendait. Touché par son attitude, je l'avais laissée à une paix toute relative et j'avais renoncé à l'interroger. Il n'y a pas eu d'autres occasions ensuite.J'ai beaucoup lu Catherine Lépront. Un peu arbitrairement, je retiens trois des articles que j'ai écrits sur autant d'ouvrages, histoire de pousser encore quelques lecteurs vers son œuvre.
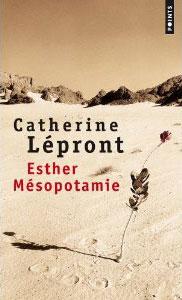 Esther Mésopotamie (2007)Partons du principe que la narratrice du nouveau roman de Catherine Lépront est l'intermédiaire entre l'auteur et le lecteur. Il faut bien que quelqu'un guide celui-ci dans l'univers qui s'installe dès les premières pages de Esther Mésopotamie. Et qu'elle se charge de présenter des personnages qu'elle connaît depuis vingt ans, depuis qu'elle travaille avec le professeur Osias Lorentz, expert en antiquités, appelé sans cesse aux quatre coins du monde pour donner son avis sur certaines pièces, quand il ne fait pas cours à l'université de Damas. Cela lui laisse peu de temps pour séjourner à Paris et il n'est, au début du livre, pas beaucoup plus qu'une silhouette élégante. Un homme cultivé et séduisant.En revanche, Anabella Santos João, «la Santos» comme on l'appelle familièrement, occupe toute la place. Il est vrai qu'elle a quatre vies, dont trois simultanées. La quatrième, chronologiquement la plus ancienne, s'est terminée il y a trente ans, quand elle est arrivée à Paris. Faisant du même coup une croix sur son enfance et son adolescence au Cap-Vert. Elle n'avait pas tout à fait l'âge indiqué sur son passeport, elle n'avait pas l'intention d'entamer les études qu'elle venait officiellement suivre en France. Et elle avait perdu ses valises. Osias Lorentz, attiré par le bruit qu'elle faisait dans l'aéroport, intrigué par l'énergie de ce petit bout de femme filiforme, l'a prise en charge et lui a offert ses trois autres vies. Pendant lesquelles Ana a pris un kilo par an - trente, donc - sans rien perdre de sa légèreté ni de sa vivacité. Mais sa présence en impose, dans tous ces rôles. Elle est d'abord la gardienne du bric-à-brac qui s'entasse chez son « Doktor », titre qui lui plaît depuis qu'elle l'a lu sur une enveloppe. Elle est aussi la secrétaire de Lorentz, tâche dont elle s'acquitte si consciencieusement qu'elle ouvre même avec discrétion le courrier personnel. Elle est, enfin, devenue la gardienne de l'immeuble. Sa personnalité massive, voire agressive tant elle semble surtout attachée à défendre son bienfaiteur contre toutes les intrusions, retient autant l'attention de la narratrice que la nôtre.La personnalité d'Osias Lorentz met un peu plus de temps à se dessiner. Très absent, nous l'avons dit, il se consacre presque tout entier à ses travaux. Mais garde aussi à l'esprit une mystérieuse Esther qui, dit-il, ne partage pas l'amour qu'il lui porte. De cette inconnue, Ana et la narratrice sont maladivement jalouses. Elles la détestent sans la connaître, tandis que les précédentes épouses de Lorentz, reléguées dans le passé, font partie d'un décor oublié depuis longtemps. Mais voir «leur» homme que, d'une certaine manière, elles se partagent, qu'elles aiment toutes les deux sans se l'avouer, attaché à une inconnue, est tout à fait insupportable!Savoir qui elle est, si nous la rencontrerons un jour - à supposer qu'elle existe, s'interroge la narratrice -, voilà toute l'énigme du roman. Entièrement bâti autour de cette figure à construire ou à découvrir. Catherine Lépront tourne autour d'Esther qui occupe d'autant plus les esprits que nous ne savons rien d'elle. La narratrice moins encore, peut-être, que n'importe qui. Car, pour avoir son histoire où tout n'est pas rose, cette femme a surtout besoin de comprendre quelle place elle occupe dans un environnement où elle se sent bien: la proximité d'Osias Lorentz et d'Anabella. Avez-vous vu le motif dans le tapis?
Esther Mésopotamie (2007)Partons du principe que la narratrice du nouveau roman de Catherine Lépront est l'intermédiaire entre l'auteur et le lecteur. Il faut bien que quelqu'un guide celui-ci dans l'univers qui s'installe dès les premières pages de Esther Mésopotamie. Et qu'elle se charge de présenter des personnages qu'elle connaît depuis vingt ans, depuis qu'elle travaille avec le professeur Osias Lorentz, expert en antiquités, appelé sans cesse aux quatre coins du monde pour donner son avis sur certaines pièces, quand il ne fait pas cours à l'université de Damas. Cela lui laisse peu de temps pour séjourner à Paris et il n'est, au début du livre, pas beaucoup plus qu'une silhouette élégante. Un homme cultivé et séduisant.En revanche, Anabella Santos João, «la Santos» comme on l'appelle familièrement, occupe toute la place. Il est vrai qu'elle a quatre vies, dont trois simultanées. La quatrième, chronologiquement la plus ancienne, s'est terminée il y a trente ans, quand elle est arrivée à Paris. Faisant du même coup une croix sur son enfance et son adolescence au Cap-Vert. Elle n'avait pas tout à fait l'âge indiqué sur son passeport, elle n'avait pas l'intention d'entamer les études qu'elle venait officiellement suivre en France. Et elle avait perdu ses valises. Osias Lorentz, attiré par le bruit qu'elle faisait dans l'aéroport, intrigué par l'énergie de ce petit bout de femme filiforme, l'a prise en charge et lui a offert ses trois autres vies. Pendant lesquelles Ana a pris un kilo par an - trente, donc - sans rien perdre de sa légèreté ni de sa vivacité. Mais sa présence en impose, dans tous ces rôles. Elle est d'abord la gardienne du bric-à-brac qui s'entasse chez son « Doktor », titre qui lui plaît depuis qu'elle l'a lu sur une enveloppe. Elle est aussi la secrétaire de Lorentz, tâche dont elle s'acquitte si consciencieusement qu'elle ouvre même avec discrétion le courrier personnel. Elle est, enfin, devenue la gardienne de l'immeuble. Sa personnalité massive, voire agressive tant elle semble surtout attachée à défendre son bienfaiteur contre toutes les intrusions, retient autant l'attention de la narratrice que la nôtre.La personnalité d'Osias Lorentz met un peu plus de temps à se dessiner. Très absent, nous l'avons dit, il se consacre presque tout entier à ses travaux. Mais garde aussi à l'esprit une mystérieuse Esther qui, dit-il, ne partage pas l'amour qu'il lui porte. De cette inconnue, Ana et la narratrice sont maladivement jalouses. Elles la détestent sans la connaître, tandis que les précédentes épouses de Lorentz, reléguées dans le passé, font partie d'un décor oublié depuis longtemps. Mais voir «leur» homme que, d'une certaine manière, elles se partagent, qu'elles aiment toutes les deux sans se l'avouer, attaché à une inconnue, est tout à fait insupportable!Savoir qui elle est, si nous la rencontrerons un jour - à supposer qu'elle existe, s'interroge la narratrice -, voilà toute l'énigme du roman. Entièrement bâti autour de cette figure à construire ou à découvrir. Catherine Lépront tourne autour d'Esther qui occupe d'autant plus les esprits que nous ne savons rien d'elle. La narratrice moins encore, peut-être, que n'importe qui. Car, pour avoir son histoire où tout n'est pas rose, cette femme a surtout besoin de comprendre quelle place elle occupe dans un environnement où elle se sent bien: la proximité d'Osias Lorentz et d'Anabella. Avez-vous vu le motif dans le tapis? Le beau visage de l'ennemi (2010)La jeune fille Ouhria, comme se la désigne Alexandre T., «bien qu’elle ait vingt-cinq ans et soit enceinte et médecin», est venue le trouver pour témoigner d’une haine nourrie par plusieurs générations de femmes algériennes. De quoi accusent-elles le vieil homme qui, à plus de 70 ans, travaille à des scénographies et se prépare à partir pour Prague pour installer le décor d’une nouvelle pièce? Ouhria porte sur elle une photographie prise un demi-siècle plus tôt, où son grand-père Driss se trouve à côté d’Alexandre. Driss est mort, on ne sait trop comment. Mais forcément, aux yeux des habitants du village, à ceux des femmes de sa famille, à cause de cet officier français qui passait pour son ami et a dû le trahir. Après tout, c’était la guerre, et pouvait-on faire confiance à un ennemi? Alors, depuis tout ce temps, les femmes ont été fidèles à leur haine. Et Ouhria, venue à la rencontre d’Alexandre, est leur digne représentante, avec son besoin de dire cette hargne en face. «Il dit en souriant à la jeune fille Ouhria […] qu’il a passé toute la guerre sans combattre, et il lui demande si elle croit vraiment qu’il va s’y mettre maintenant, cinquante ans après. Et seul contre quatre générations de femmes. Puis il rectifie – cinq générations –, parce qu’elle n’a pas parlé de sa trisaïeule Tidmi, la grand-mère de son grand-père Driss…» A la fureur, il oppose son sourire. A une version de l’histoire qui arrangeait tout le monde, parce qu’elle inscrivait la relation entre Driss et Alexandre dans une logique d’affrontement, il oppose sa vérité. Celle de l’amitié, toujours présente malgré les années passées, malgré la mort de Driss, malgré sa propre transformation – et cette haine brute qui a surgi un jour en lui, moment étrange et étranger de son existence, qui s’est échappée comme une poussée de mauvaise fièvre, oubliée… Alexandre T. ne raconte pas les choses en suivant une ligne narrative simple. Il revient sur une image surgie dans la mémoire, il creuse celle-ci pour réveiller les détails estompés. Il va chercher, aussi, les nombreux croquis qu’il a faits dans le village, notamment des portraits de Driss, dont il pensait partir pour peindre des tableaux à son retour en France. «A cette série il avait trouvé un titre: Le beau visage de l’ennemi. Elle devait inaugurer son œuvre peinte et il ne l’a jamais réalisée.» La vie n’a pas suivi une ligne simple non plus. La première fois qu’il a vu Driss, il s’est dit: «Ainsi, c’est cela, le visage de l’ennemi?» Et il est devenu son ami, contre toute attente. Sachant que Driss, futur avocat, futur politicien, n’était pas revenu par hasard au village de sa famille de femmes. Mais n’en disant rien à ses supérieurs, ne le dénonçant jamais, fidèle à l’amitié comme les femmes, plus tard, réécrivant l’histoire, seraient fidèles à la haine. Le roman de Catherine Lépront coule comme une eau tourmentée, s’insinue dans des failles, trouve une langue d’une infinie souplesse pour se plier au récit qui se dédouble. Un livre superbe sur l’amitié et le visage trompeur qu’elle prend face aux événements qui la dépassent sans la rompre.
Le beau visage de l'ennemi (2010)La jeune fille Ouhria, comme se la désigne Alexandre T., «bien qu’elle ait vingt-cinq ans et soit enceinte et médecin», est venue le trouver pour témoigner d’une haine nourrie par plusieurs générations de femmes algériennes. De quoi accusent-elles le vieil homme qui, à plus de 70 ans, travaille à des scénographies et se prépare à partir pour Prague pour installer le décor d’une nouvelle pièce? Ouhria porte sur elle une photographie prise un demi-siècle plus tôt, où son grand-père Driss se trouve à côté d’Alexandre. Driss est mort, on ne sait trop comment. Mais forcément, aux yeux des habitants du village, à ceux des femmes de sa famille, à cause de cet officier français qui passait pour son ami et a dû le trahir. Après tout, c’était la guerre, et pouvait-on faire confiance à un ennemi? Alors, depuis tout ce temps, les femmes ont été fidèles à leur haine. Et Ouhria, venue à la rencontre d’Alexandre, est leur digne représentante, avec son besoin de dire cette hargne en face. «Il dit en souriant à la jeune fille Ouhria […] qu’il a passé toute la guerre sans combattre, et il lui demande si elle croit vraiment qu’il va s’y mettre maintenant, cinquante ans après. Et seul contre quatre générations de femmes. Puis il rectifie – cinq générations –, parce qu’elle n’a pas parlé de sa trisaïeule Tidmi, la grand-mère de son grand-père Driss…» A la fureur, il oppose son sourire. A une version de l’histoire qui arrangeait tout le monde, parce qu’elle inscrivait la relation entre Driss et Alexandre dans une logique d’affrontement, il oppose sa vérité. Celle de l’amitié, toujours présente malgré les années passées, malgré la mort de Driss, malgré sa propre transformation – et cette haine brute qui a surgi un jour en lui, moment étrange et étranger de son existence, qui s’est échappée comme une poussée de mauvaise fièvre, oubliée… Alexandre T. ne raconte pas les choses en suivant une ligne narrative simple. Il revient sur une image surgie dans la mémoire, il creuse celle-ci pour réveiller les détails estompés. Il va chercher, aussi, les nombreux croquis qu’il a faits dans le village, notamment des portraits de Driss, dont il pensait partir pour peindre des tableaux à son retour en France. «A cette série il avait trouvé un titre: Le beau visage de l’ennemi. Elle devait inaugurer son œuvre peinte et il ne l’a jamais réalisée.» La vie n’a pas suivi une ligne simple non plus. La première fois qu’il a vu Driss, il s’est dit: «Ainsi, c’est cela, le visage de l’ennemi?» Et il est devenu son ami, contre toute attente. Sachant que Driss, futur avocat, futur politicien, n’était pas revenu par hasard au village de sa famille de femmes. Mais n’en disant rien à ses supérieurs, ne le dénonçant jamais, fidèle à l’amitié comme les femmes, plus tard, réécrivant l’histoire, seraient fidèles à la haine. Le roman de Catherine Lépront coule comme une eau tourmentée, s’insinue dans des failles, trouve une langue d’une infinie souplesse pour se plier au récit qui se dédouble. Un livre superbe sur l’amitié et le visage trompeur qu’elle prend face aux événements qui la dépassent sans la rompre.
