Mais où va Richard Millet ?Marc Villemain
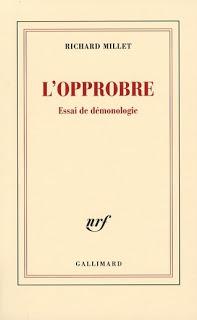
Éditions Gallimard
Tous aux abris : Richard Millet est « en guerre ». Fulminant, agité, s’échauffant à sa propre furie telle une pie-grièche, l’écrivain peste, tempête, invective, s’ébroue comme un chien fou, laissant s’égarer au passage ce qui fondait son intelligence tout autant que son style – pourtant à peu près unique, et souvent sublime, et qui faisait et continue de faire de lui, déjà, un classique de son vivant. C’est parce que je le pense et l’ai écrit en maintes occasions, et encore récemment à propos de L’Orient désert, deCorps en dessous et Désenchantement de la littérature (le livre dont la réception, paraît-il, justifiait celui-ci) que je me sens à mon aise pour manifester, peut-être pas undésenchantement, à tout le moins un dégrisement. Ainsi donc, l’écrivain n’aura pas supporté ce que d’aucuns auront pu dire ou écrire de Désenchantement de la littérature, cette longue et magnifique élégie à la mort des belles-lettres qu’éclaboussait hélas quelque saillie humorale et politique parfois très sotte. Tout comme j’ai aimé et défendu cet Orient Désert dont il se plaint que nul ne l’ait lu (cf. Le Magazine des Livres, n° 7), j’ai aimé et défendu Désenchantement, son amertume, l’irrécupérable de sa désolation, la magnificence de son écriture, bien qu’en déplorant certains partis pris, plus fantasmatiques d’ailleurs que foncièrement idéologiques, car conscient que c’est dans sa propre négativité que l’écrivain digne de ce nom doit écrire, et m’arrimant au devoir de ne pas le lire au pied de la lettre mais dans la seule et exclusive compréhension d’une ontologie et d’une affliction qui, chez lui, se parent toujours des plus remarquables atours.
Désenchantement fut il est vrai diversement apprécié. Mais il fut critiqué seulement pour sa part extra-littéraire – y compris, donc, par les plus sincères et fervents de ses lecteurs. Millet en prit ombrage, et s’enquit de répondre à ceux qu’ils nomment dans ce livre-ci des « ennemis » – quoique s’empressant de préciser, très vite et du très haut de sa superbe, qu’ils « ne méritent pas d’être traités en ennemis » puisque au fond ils ne sont rien, ou rien d’autre que les estafettes d’un « journalismedevenu le stade suprême de la pratique littéraire contemporaine – son horizon romanesque, ou ce que les géologues appellent un cône de déjection », et d’expliquer qu’il ne saurait être question de pardonner à des ennemis car « on ne pardonne pas à un masque, non plus qu’à un rôle ou à un chien », et que, au fond, en vérité, « mes ennemis n’ont que l’existence que je veux bien leur prêter. »
*
La terre entière lui reprocherait donc tout ce qu’il est, et davantage encore : jusqu’à son existence ; car n’en doutez pas, ce que ses contradicteurs visent n’est rien moins que son « élimination du champ symbolique. » Outre que l’écrivain, par ailleurs si dédaigneux de la presse littéraire et plus encore de ce qu’elle peut penser de lui, semble très bien informé de ce qui s’écrit sur son œuvre en tous lieux et jusqu’aux blogs les plus modestes, l’on regrettera d’abord qu’aucun point sur lesquels il fut attaqué ne trouve ici réponse. Pire – ou mieux, c’est selon : ce qui justifia notre réserve à la lecture deDésenchantement se trouve conforté dans L’opprobre, écrit sans doute un peu trop à la hâte pour pointer convenablement le viseur, si tant est, même, qu’il fût en mesure d’approcher sa cible. Il est d’ailleurs symptomatique que Millet use de la forme quasi-exclusive de l’aphorisme, laquelle, si elle n’est pas viscérale ou systémique comme chez Cioran, ne sert guère qu’à maquiller une pensée dont on se refuse ou dont on se sent impuissant à étayer le dévoilement. Très commode pour quiconque se suffit ou se nourrit de sentences, l’aphorisme court le risque de la suffisance sentencieuse ; d’un usage raisonné, il saisit le lecteur, l’agrippe, le bouscule et le confond jusqu’à devenir saillie d’intelligence ; mal employé, il n’est guère qu’une arme défensive bien impuissante à masquer le trouble de celui qui se sait acculé. En assénant, en tirant à vue sur tout ce qui bouge, en sombrant parfois dans une vulgarité un peu indigne d’une telle prose, Millet ne fait que desservir son propos et va jusqu’à le salir, sciemment ou pas, allez savoir, avachissant ce qui aurait peut-être pu constituer les filaments d’une sainte colère en une langue de fiel épaisse, lourde d’un mépris que, finalement, il porte si mal.
L’opprobre, opportunément sous-titré Essai de démonologie, est le livre de l’échec. Échec narcissique, bien sûr : Millet pensait blesser ses offenseurs ? le lecteur n’y verra autre chose que les rodomontades, un peu misérables il faut bien dire, et pour cette raison parfois attendrissantes, d’un auteur dont les coutures élégantes craquent sous l’effet de la vexation. Échec intellectuel et littéraire ensuite, et voilà qui est plus embêtant. A quoi bon tant de jolies phrases bien ciselées pour expliquer, par exemple, qu’il faut savoir « accueillir l’outrage comme un vinaigre à muer en eau pure », ou pour se convaincre soi-même qu’« aux caresses des amis je préfère les crachats », ou pour se consoler de « la laideur de mes ennemis », laquelle suffirait bien « à me venger » ? A quoi bon faire du ressentiment un principe générique extensible à tout ce qui vit ? : « Que pourrais-je aimer d’une France qui s’oublie elle-même comme une malade et dont je méprise le peuple », écrit celui qui, pourtant, tout au long de son œuvre, a su si bien montrer le désarroi, la maladresse fragile et délicate des petites gens. « Le Français est fidèle à son chien » : à quoi bon ces bons mots tant ils sont gratuits et n’obéissent à rien d’autre qu’au seul plaisir trouble de se croire, non pas seul, car nous le sommes tous, mais unique ? A quoi bon comparer « un de ces bons gros romans d’Outre-Atlantique » à « une blondasse américaine » avec laquelle on ne peut tout juste envisager que de « coucher » ? A quoi bon jouir et vouloir faire jouir de « l’hébétude satisfaite des lauréats des grands prix littéraires, qui ont tous l’air de vaches inséminées par le vétérinaire » ? A quoi bon pousser des cries d’orfraie devant le « multiculturalisme » dès lors qu’on se contente de le définir comme partie prenante de « l’antiracisme et [de] la pornographie » ? A quoi bon être écrivain, et gallimardien, excusez du peu, si c’est pour se satisfaire de calembours ou de syllogismes qui d’ordinaire s’entendent de préférence au café, juste après la poire : « la domination anglophone est à la littérature ce que l’Europe de Schengen est à l’immigration clandestine ». Et le vertueux « catholique, blanc, hétérosexuel, écrivain », d’enfoncer le clou : « Vient un moment où on ne peut que donner raison à Ben Laden, pour peu qu’il ne soit pas une fiction américaine ou islamiste » ; d’ailleurs, « il n’est pas impossible que les attentats du 11 septembre 2001 soient une mise en scène américaine à capitaux saoudiens, tout de même qu’on peut douter si les Américains sont réellement allés sur la lune. » Marion Cotillard ne saurait mieux dire (pour mémoire, voir ici).
*
J’ai toujours eu un petit faible pour les écrivains irascibles, les atrabilaires, les épidermiques et les eczémateux, pour les mauvais joueurs de mauvaise foi. Non pour ce qu’ils disent ou écrivent en raison, mais parce que ce qu’ils disent ou écrivent n’en finira jamais de n’être que la manifestation, douloureuse, inextinguible, frustrée, mythique, lyrique, de leur souffrance à être. Mais c’est toujours une désolation pour moi quand j’en surprends un en train de jouer au « réprouvé », à la victime perpétuelle d’une « loi du silence que le milieu littéraire partage avec les sociétés secrètes », alors même qu’il aurait accès à tout, et qu’il ne serait pas un livre de lui qui ne fût commenté, critiqué, décortiqué, publicité. Désolation de voir ce mystique pleurer la chrétienté des origines, on peut le comprendre, et s’envelopper dans la hautaine toge du supplicié, le manteau de disgrâce de celui qui aimerait tant croire qu’il « hante ceux qui voudraient que je n’existe pas », qui aimerait tant nous convaincre qu’il vit dans la quiétude d’une « forme supérieure de l’ironie ». « Privilège des martyrs et des saints, et aussi des écrivains, je suis vivant dans ma tombe », note-t-il comme pour façonner la statue ou le mausolée à venir, assuré que les derniers grands glorieux auxquels on puisse le mesurer ne sont plus de ce monde : « Ce n’est donc pas de trop écrire qu’on me reproche, mais de trop publier, comme on dit de trop parler ou d’écrire trop bien. Peut-on reprocher à Bach ou à Schubert d’avoir trop composé, ou à Monet d’avoir trop peint ? »
Étrangement, c’est dans un ressort psychologique, ou par une pirouette du même ordre, que Richard Millet croit pouvoir expliciter et mettre à jour la défiance qu’il suscite. Écoutez bien, c’est un monument de bravoure et de mauvaise foi : « Et si cette haine, cette violence, ce rejet étaient le signe d’un amour pervers pour ce que j’écris, mes ennemis n’osant m’aimer, leur perversion consistant à jouir sans se l’autoriser, et à vouloir dégrader mon travail en jetant l’opprobre sur ma personne ? » On appelle cela boucler une boucle : être l’auteur d’une œuvre telle que son pire ennemi n’aura d’autre choix que de l’adorer en son for intérieur et dans le secret silencieux de sa conscience hypocrite, acculé à la souffrance perverse de devoir jouir du pire, être soi-même enfin le Maudit tutélaire, la Figure tellement considérable et positive et enviée du Mal, régner du fin fond du pays de l’opprobre sur un empire de nains et de lutins corrompus qui, dans l’infime éclat de lumière qui, fût-ce par accident ou par éclair, continue de les rendre accessibles au Beau, ne peuvent que mettre genou à terre devant le Maître. Il ne viendra pas à l’esprit de l’écrivain que ladite défiance tient à de simples mots qu’il jeta lui-même dans ses pages, des mots bêtes, méprisants, ineptes, qui ternissent ce qu’il convient d’appeler une œuvre, une œuvre qui, de surcroît, n’a sans doute pas beaucoup d’équivalent aujourd’hui en France.
Faut-il y voir la cause d’un effet ou l’effet d’une cause, toujours est-il que L’opprobre est écrit dans une langue qui, pour la première fois, semble achopper, se condamner à la monomanie, au ressassement, à l’alourdissement du déjà connu, du déjà écrit, et se condamner, même, parce qu’on ne réécrit pas aussi bien ce que l’on écrivit déjà, à l’injure de ce que cette langue a été et sera encore assurément ; c’est bien écrit, bien sûr, c’est Richard Millet ; mais c’est comme si nous lisions là un Millet pour les Nuls, comme si nous tenions entre nos mains le manuel de base de la stylistique millettiste, le vade-mecum des techniques ordinaires de l’écrivain, dont on ne sent plus ici la sainte inspiration, et dont on pourrait croire qu’il s’essouffle sur sa propre musicalité, comme s’il se lassait lui-même de tourner autour de ses propres marottes. Les rares moments de ce livre où l’écrivain s’en retourne à lui-même attestent de la déperdition du sens et du beau dans l’humeur, et sauvent le livre. Jamais aussi élégant et digne que lorsqu’il consent à fermer les yeux et à ne pas travestir le monde en objet de fantasmes ou en exutoire à sa langueur, les mots de Millet retrouvent alors leur source exacte, l’origine même à laquelle il puisait pour donner les plus beaux livres qui soient. « Etre digne de l’échec : voilà la condition de l’écriture », écrit-il, nous donnant à espérer qu’il entrevoit ainsi le caractère vain et voué à l’oubli de toute polémique avec la galaxie, et que seul le rapport intime, donc privé, à l’écriture, justifie la littérature. « De quel infini sommes-nous, en écrivant, la dégradation ? » : voilà ce qu’il faut écrire. Ce qui n’est possible qu’à la condition d’oublier un peu ce que nous renvoient les ennemis que nous nous sommes fabriqués, et qu’il est un peu commode, n’est-ce pas, de comparer à des « insectes. » Nous autres, lecteurs, nous autres qui avons appris et continuons d’apprendre à lire et à écrire en lisant Richard Millet, attendons de lui qu’il tienne bon sur ses préceptes : « J’écris non pas pour être ignoré mais pour parfaire la nécessité qu’il y a à l’être en écrivant » : c’est, précisément, ce qu’il n’a pas fait avec L’opprobre. Il nous dira, et nous dit déjà, d’ailleurs, que ses lecteurs l’attendent au tournant du roman, et qu’il s’en moque, que le roman est mort, qu’il a besoin de l’oxygène de la guerre et de l’hybridation du récit, et nous, on pensera qu’il s’agit encore d’une argutie, d’un aveu déguisé en lapsus, d’un refoulement peut-être, et que ce qui l’excite surtout, ces derniers temps, c’est une petite guérilla littéraire qui ne vaut pas tripette, et qu’il trouve un bien triste plaisir à la posture sacrificielle et victimaire de l’écrivain maudit qu’il n’est pas. Si rien ne semble en mesure de pouvoir réenchanter Richard Millet, ce n’est pas grave : là naît aussi sa littérature ; pourtant, s’il continue, il faudra bientôt entreprendre de le désenvoûter. Avant qu’il ne soit trop tard.

