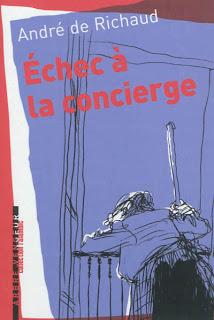Romain Verger

© Jack Hardwicke, Mapped Faces #4
André de Richaud est de ces grands auteurs méconnus et artistes maudits qui se consument aux braises de leur langue et des affres de la vie. Si en 1931, la parution de La Douleur lui assure le succès, il ne cessera plus comme il l’écrit lui-même de s’ «enfoncer doublement, avec un raffinement inouï, dans le silence et dans la mort.» Submergé par toutes sortes de difficultés, il entre en 1961 (il n’a que 52 ans) dans une maison de retraite de Vallauris où il finira ses jours comme un chien, oublié de presque tous. De cet auteur qui disait «n’aimer guère que la poésie et les bêtes», on compte des textes splendides comme La Barrette rouge, parmi d’autres où la fantaisie et l’humour acéré se mêlent au goût pour une étrangeté teintée d'inquiétude et de mélancolie. «Un destin d’artiste déveinard» résume Éric Dussert en préface à ce recueil qui lui rend un bel hommage en déclinant tous les tons de sa palette d’auteur. En ce sens, Échec à la concierge pourrait servir utilement d’introduction à son œuvre. S’y trouvent rassemblés des textes jusqu’alors éparpillés dans diverses revues : chroniques parisiennes, nouvelles rurales, provençales dont bon nombre relèvent d’une veine fantastique.Parmi les nouvelles se glissent des textes plus autobiographiques comme celui où Richaud évoque sa dépendance alcoolique : « Certains jours, j’en ai bu jusqu’à cent verres. Pas moyen d’être saoul. Il est malin, le Dieu ! Au contraire, il me semble que plus j’en bois et plus j’y vois clair... Alors, comme je ne tiens pas à y voir clair!... Ce vin est d’ailleurs ma seule nourriture depuis vingt ans. » S'y ajoutent des réflexions sur la littérature comme dans la section liminaire où l’auteur, prenant prétexte d’une réponse à un lecteur tatillon soucieux de vérisme, proclame les pleins pouvoirs à la folle du logis. On y trouve aussi des conseils, telle cette méthode préconisée aux insomniaques qui consiste à entreprendre la traversée pédestre de Paris sous la forme d’une promenade imaginaire. Un exercice de projection mentale comme les affectionne Michaux, pour aider les plus récalcitrants que la lecture de quelques pages de Sartre ne serait pas parvenue à assommer.
La première nouvelle éponyme est celle qui détonne peut-être le plus, tant le reste est presque uniformément marqué par le fantastique. Richaud y campe la mère Guillot, concierge de son état, 75 ans, « l’œil cerclé de fer », portée sur la bouteille et se piquant de beau langage. Fidèle aux caricatures dont on aime à se représenter la fonction, elle se repaît de commérages et de ragots, profitant de ses apéritifs sur le trottoir d’en face pour « dégorger sa bile » avec « une endurance extraordinaire », savourer ses victoires quotidiennes, comptant ceux de ses locataires qu’elle est parvenue à mater. C’est Joseph Valeureux tout particulièrement qui fait les frais de ses foudres, une bonne pâte d’étudiant qui a le malheur d’occuper la chambre de bonne où elle comptait installer son petit fils. D’autant qu’à la suite d’un accident, celui-ci se voit transfuser le sang du généreux donneur Valeureux... Infamie qui ne saurait demeurer impunie!
Les nouvelles fantastiques ont plus particulièrement retenu mon attention, de facture tantôt classique comme « La Dame blanche » ou « L’étui à cigarettes » dans laquelle ressurgit du passé, le temps d’une partie de bridge, un hôtel du Marais avec sa maîtresse de maison et ses domestiques réglés comme des automates, tantôt plus singulière : ainsi de « La Madregalla » qui met en scène une sorte de vaisseau fantôme figé au beau milieu de l’océan dont l’un des membres d’équipage (Erik le Danois) se pétrifie en statue de porcelaine. Tous défileront à son chevet car au contact de ce corps animé d’un tic-tac d’horloge, leur est donné d’entendre et voir ce que leurs proches restés à terre disent et vivent. Les fêlures qui menacent progressivement l’intégrité de l’homme-statue révèlent celles qui fissurent la vie familiale de ces marins. Tout aussi singulière, la nouvelle « Le miracle » suit l’envoûtement d’un adolescent qui a eu le malheur de porter un masque de diable en carton-pâte le jour de la Fête-Dieu, tant et si bien qu’il ne s’en débarrassera plus :
« Moi, inutile de vous dire que ça n’allait pas! Je ne pouvais plus me regarder dans la glace. Je sentais à des démangeaisons que le travail n’était pas fini et que, de jour en jour, le carton du masque se collait à ma chair, qu’il se produisait entre ma viande et le papier mâché une effrayante osmose. Mes joues sonnaient, quand je les frappais du doigt, comme du carton, mais je sentais par le nez horrible et énorme. Je me mouchais avec et une aiguille plantée dans mon menton me faisait mal. Je pouvais manger et parler, mais, au début, avec effort. Ce qui me faisait trembler surtout, c’est que j’étais sûr que les cornes se mettaient à pousser. »
Dans « La Bête », un pauvre prisonnier doit partager sa cellule avec une créature invisible dont la présence matérielle se limite à ses coulées d’urine. « Histoire de rire » montre combien d’anciens amis peuvent être envahissants une fois morts, jusqu’à se venger de tout ce que vous leur avez fait subir dans leur jeunesse.
Enfin, je ne résiste pas au plaisir de citer cet extrait poignant tiré de « La maison que j’habite » où Richaud s’y dévoile dans toute sa déréliction d’homme et d’écrivain :
« Ecris-je pour me plaindre de quelqu’un ? Je suis seul dans la vie et je n’ai jamais été aimé. La seule personne de qui j’ai à me plaindre, ce n’est pas quelqu’un : c’est Dieu lui-même. J’ai aussi quelques griefs contre ma personne propre, mais je n’aime pas penser aux dédoublements de la personnalité. Un moi-même me suffit amplement pour m’écorcher toutes les aspérités de la vie. Si j’écris pour raconter des aventures extraordinaires ? Celles que j’ai vécues ne le sont guère. Depuis vingt ans, je n’ai pas fait trois lieues plus loin que ma maison. Alors ? C’est sans doute pour voir frétiller sur le blanc du papier cette petite tête noire : la plume. Elle, au moins, ne se défend pas contre mon amitié, tandis que les oiseaux se taisent à mon approche ; que le lièvre, à moitié étranglé dans un dernier sursaut, parvient à s’échapper des collets que je lui tends si je me montre à lui à visage découvert. Depuis vingt ans, je n’ai saisi un papillon par les ailes. Ô poudre magique qui reste dans les doigts ! Il me semble que si je parvenais à saisir un papillon, je resterais longtemps la main haute, l’index et le pouce écartés. Je deviendrais infirme pour garder éternellement ce reflet de vie. Il n’y a pas de mouches ni d’araignées dans ma maison. Pas de chenilles sous mes feuilles. Pas d’escargots dans les trous de mes murs. Voilà ma vie. Tandis que la plume, elle, se laisse conduire comme un hanneton. Où sont ceux de mon enfance, que nous trempions dans l’encre avant de les faire se promener sur des pages blanches ? Et les arabesques qu’ils traçaient ?
Plume, petite compagne, prolongement de moi-même, qui vit de ma chaleur, que vas-tu raconter ? Nous sommes tous les deux seuls au milieu de cette montagne sans réalité. Les deux foyers voisins, mais non pas confondus, d’une immense ellipse. D’une ellipse sans vie. Que dis-tu, solitaire ? Parce que c’est l’hiver, tu crois que le monde est comme toi, mort. Tu veux mettre de la mort sur toutes choses. Sulfater de mort les vignes ; étamer de mort les pierres. Il est vrai que, de mes ténèbres, le monde t’apparaît comme vide et silencieux. Mais ce silence est fait des mille ronflements de la nature qui dort ; ce vide est plein de cubes, de cylindres, de sphères minérales et végétales qui ne demandent qu’à tourner, rouler, éclater dans l’allégresse du printemps qui viendra pour tout le monde, sauf pour moi.
Et cette rêverie sur la plume continuerait longtemps si je ne m’en arrachais pas bien vite. Oui, sous les pierres de la montagne, des serpents de cuir sont roulés. Les taupes sont, griffes serrées, enfouies dans la profondeur de la terre que, seuls, leurs yeux aveugles voient miroiter... »
Un recueil à ne pas manquer, superbement illustré par Frédéric Bézian.
André de Richaud, Échec à la concierge, L’Arbre vengeur, 2012. 13 €.