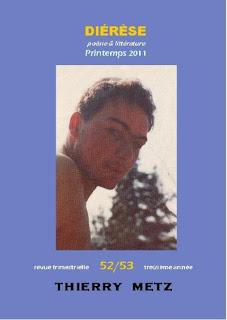Romain Verger

© Françoise Metz
Dans sa dernière livraison, la revue Diérèse clôt son hommage au poète Thierry Metz, initié par le double numéro qui lui était consacré l’année dernière. Une nouvelle fois, Daniel Martinez et Isabelle Lévesque (aidés de Françoise Metz, la veuve de Thierry) réunissent avec talent lettres, poèmes inédits, photographies, témoignages et confidences pour célébrer le souvenir de l’auteur du Journal d’un manœuvre, et faire émerger le portrait éclaté et émouvant d’un homme inconsolé par la mort de son second enfant renversé par une voiture en 1988, le grand absent dont le manque ne cessera plus de hanter l’écriture, jusqu'au 16 avril 1997 où Metz mettra fin à ses jours, à quarante et un ans. « Je n’ai que ce trajet à bâtir. // Retrouver la mère et l’enfant. // En mourir, peut-être », écrivait-il dans son Carnet d’Orphée, un an avant son suicide. Comme le dit justement Pierre Dhainaut : « Que peut désormais une écriture qui sait qu’elle ne ressuscitera personne, qu’elle ne consolera pas plus l’aimée à laquelle elle s’adresse que celui qui s’y livre encore ? »
Ce sont en tout quelques 600 pages qui nous aident à cerner cet homme comme son expérience poétique que Daniel Martinez décrit comme « tout entière faite de ces intermittences de moments de communion heureuse avec l’univers et de moments d’angoisse sourde, son versant d’ombre. » Une entreprise difficile tant ses poèmes inédits, nombreux, sont dispersés en revues, parmi lesquelles Résurrection (fondée en 1941 par Jean Cussat-Blanc) qui le publiait avec assiduité. À tous ces poèmes ici rassemblés s’ajoutent « D’un qui marchait — avec le petit bois », quatre poèmes écrits sur les toutes dernières pages banches de la Douzième poésie verticale de Roberto Juarrroz et le Carnet d’Orphée.
Entre autres extraits de sa correspondance figurent ses échanges avec Gérard Bourgadier, l’éditeur de l’Arpenteur chez Gallimard auquel Jean Grosjean avait recommandé la lecture du manuscrit du Journal d’un manœuvre, où Metz raconte 148 jours d’un chantier destiné à transformer une ancienne usine de chaussures en résidence de luxe. Bourgadier y évoque sa première rencontre avec Metz : « Il était assis, impassible, immobile. Il était costaud, fort, musclé, ses mains surtout, rudes, des mains de travailleur, de la terre, des mains de prolétaire, avec la pelle profonde. » C’est bien ce qui faisait la spécificité de Metz qui, après s’être adonné à l’haltérophilie, deviendra manœuvre, maçon et ouvrier agricole. Il n’envisageait pas la poésie en intellectuel et plutôt que de se regarder écrire, il préférait bâtir, s’inscrivant dans la lignée du poète menuisier de Guillevic ou du poète artisan de Tardieu. Dans Dolmen, il se compare à un potier, à un élagueur ou un coupeur de bois, thème qui traverse encore quelques-uns des poèmes inédits : « Flanqué d’oiseaux / j’entre dans le bois / c’est là qu’on travaille / avec de jeunes outils / à la taille à la coupe / on fait des feux / qui font peur aux arbres / puis chaque feuille s’abandonne. » « Je n’ai pas été maçon pour rien, écrit-il encore, et je n’y suis pas venu pour la seule nécessité. J’ai vite appris que les murs du livre et de la maison sont percés d’ouvertures. »
La poésie de Thierry Metz est faite d’éclats, de fragments nus et lumineux emprunts d’un « lyrisme sec et brutal comme le ciseau de pierre » écrit Frédéric Brandon. Il délaisse l’emphase pour la simplification ; il s’agissait pour lui d’entrer « dans la braise des mots / dans le presque rien d’écrire » :
« Le vrai travail — peut-être— est de simplifier »
« S’amincir / Émacier le texte le plus possible ».
« Tu vois où je suisderrière le chardonavec le bois la pierreavec presque rien »
Ce projet d'écrire à l'ossature du quotidien nous rend sa poésie proche et nécessaire, parce que dans son approbation totale du réel et son humilité, son œuvre embrasse « vie mort / dans le même instant. »
On ne pourra que souscrire à l’invitation de Christian Estèbe : « Lisons-le, relisons-le, faisons-le lire, relions-le à ce que sans doute il aimait plus que tout : la vie. »
Diérèse, N°52/53 et N°56, printemps 2011 et printemps 2012. 15 €.