À l'occasion de la sortie de son dernier roman, Beau parleur, Jesse Kellerman a très gentiment accepté de répondre à mes questions et à celles de Jacques Tessier du blog Un polar. Cet entretien est également repris sur le blog Un Polar collectif sur lequel nous sommes plusieurs à regrouper nos avis sur nos lectures noires.
Un immense merci à Carla Briner des Éditions des Deux Terres qui a permis ce contact avec Jesse Kellerman, dont je n'osais même pas rêver, ainsi qu'à la traductrice du roman, Julie Sibony qui a eu la gentillesse de s'atteler à la traduction. Et bien sûr, merci à vous, monsieur Kellerman, pour avoir répondu avec autant de verve à nos questions parfois un peu "piquantes" !

Photo : © Isabelle Boccon-Gibod
Interview de Jesse Kellerman pour Un polar-Collectif – traduction Julie Sibony
Bonjour Jesse ! Ce questionnaire a été établi par Liliba et Jacques, qui ont chacun de leur côté chroniqué Beau Parleur sur Un polar-Collectif. Jacques : Tout d’abord, merci Jesse d’avoir accepté de répondre à nos questions à l’occasion de la sortie en France de votre roman Beau parleur.
C’est moi qui vous remercie.
Jacques: Comment vous présenteriez-vous aux lecteurs français qui ne vous connaîtraient pas encore et qui vont découvrir votre univers romanesque ?
Mon but est d’écrire le genre de livres que j’aime lire. En tant que lecteur, je m’intéresse aux romans qui explorent les frontières entre la fiction littéraire et commerciale. Je veux une bonne histoire, et je veux que cette histoire me soit racontée d’une façon nouvelle et excitante, avec une langue neuve. J’ai aussi un penchant pour le bizarre et le noir, et un sens de l’humour assez épouvantable : ma réaction instinctive à l’horreur est d’abord d’en rire. C’est peut-être pour cette raison que j’ai rencontré plus de succès en Europe qu’aux États-Unis, où tout le monde s’attend à un happy end.
Jacques : En trois romans vous avez acquis une grande notoriété en France ou vous êtes considéré comme un des auteurs de polars/suspense contemporains les plus prometteurs. Vous attendiez-vous à un tel succès quand vous avez commencé l’écriture romanesque ?
J’ai commencé à dicter des histoires à mon père très jeune ; à l’âge de deux ans, avant de savoir écrire moi-même. Très clairement, j’obéissais à un instinct et non à un but défini (je doute qu’aucun enfant de deux ans ne réfléchisse à sa future carrière). C’est un instinct que j’ai continué à suivre depuis maintenant trente-deux ans, et c’est presque par accident que j’ai fini par en faire mon métier. Ce que je veux dire, c’est que la pulsion d’écrire, de raconter des histoires précède le désir d’être publié, ou en tout cas le devrait.
Pendant de très nombreuses années, j’ai écrit sans être publié, sans aucune attention si ce n’est de ma famille, sans autre gratification qu’une satisfaction personnelle. Alors, même si j’étais relativement jeune selon les normes habituelles quand j’ai vendu mon premier roman, en fait ça faisait déjà plus de vingt ans qu’on me disait non. J’avais un métier respectable en ligne de mire (je voulais faire des études de droit) et j’imaginais mon avenir comme celui d’un homme ordinaire dans un bureau, avec un hobby à côté. Ainsi en avait-il été de mon père, psychologue de profession, pendant quinze ans (et de Kafka toute sa vie !). Le fait que les choses aient tourné différemment pour moi est encore difficile à comprendre. D’ailleurs je ne tiens pas non plus ma chance pour acquise. À tout moment je m’attends à échouer et à devoir retrouver un boulot plus conventionnel. C’est pour ça que j’écris avec un sentiment d’urgence désespérée et de panique, en essayant juste de tenir pendant encore un livre.
Quand on écrit en étant convaincu de son succès, c’est ou bien qu’on se berce d’illusions, ou qu’on se prend pour je ne sais qui.
Jacques : Vos parents, Faye et Jonathan, sont des auteurs internationalement reconnus. Quelle a été leur influence sur votre choix de devenir romancier ? En avez-vous discuté avec eux ? Votre vocation était-elle ancienne, évidente, naturelle ?
(voir aussi plus haut)
Mes parents ne m’ont jamais ouvertement poussé à faire quoi que ce soit. Vraiment, c’est la vérité. Difficile à croire à notre époque, où les parents (en tout cas occidentaux) commencent à programmer leurs enfants dès qu’ils sortent du ventre. Évidemment, la marque de mes parents sur moi est indélébile, comme de n’importe quel parent sur n’importe quel enfant. C’est eux qui ont forgé mon sens moral, qui m’ont éduqué dans bien des domaines, petits ou grands. Chaque famille a son propre langage. Dans d’autres familles, ça peut être les mathématiques ou la politique. Chez nous, c’étaient les histoires et les personnages.
En ce qui concerne l’art de l’écriture, les leçons les plus marquantes que j’ai apprises d’eux ne m’ont pas été transmises explicitement, mais par l’exemple, et elles avaient plus à voir avec le dévouement quotidien qu’il faut pour être un écrivain professionnel qu’avec des considérations esthétiques. Écrire tous les jours, même si vous n’êtes pas d’humeur. Faire un premier jet, remanier, persévérer, remanier encore.
Liliba : Je ne sais pas ce qu’il en est aux Etats-Unis, mais en France, le mot « thriller » est très vendeur, accrocheur même. Cependant un peu réducteur à mon avis pour vos romans qui sont bien plus que cela, de la vraie littérature à mon goût, même s’il s’y mêle une part de suspense… Qu’en pensez-vous ?
Je n’aurais pas l’arrogance de me considérer comme un écrivain à part, ni la bêtise de vouloir me substituer aux spécialistes du marketing. Je me contenterai de dire que je ne me sens à ma place ni dans la sphère purement littéraire ni dans la littérature de genre, et que l’un de mes objectifs artistiques (si tant est que j’en aie un) serait d’abattre le mur qui sépare les deux.
Jacques : Dans Les Visages, vous nous montriez le monde secret et fermé des amateurs d’Art contemporain, dans Jusqu’à la folie, vous avez choisi comme toile de fond de votre histoire la vie d’un hôpital newyorkais, dans Beau parleur vous nous faites découvrir le milieu universitaire d’Harvard… Comment choisissez-vous la toile de fond de vos romans ?
Ma femme est médecin ; j’ai fait Harvard ; je suis un grand amateur d’art. Cela dit, c’est un peu trop simple. Plus souvent, je commence par le thème ou le noyau de l’histoire et je construis le reste à partir de là : le personnage principal m’inspire ensuite le cadre, parce que tout personnage a besoin d’un milieu, d’une profession, d’un passé, etc. Dans le cas de Beau parleur, par exemple, je voulais écrire sur un homme par nature incapable d’agir mais qui est finalement forcé d’agir de façon radicale. Le monde d’un philosophe est entièrement immergé dans les livres et les mots, alors ça m’a paru le bon milieu pour y plonger Joseph Geist. Pour Les visages, j’ai été inspiré par une œuvre particulière de l’artiste américain Henry Darger, qui peignait des scènes violentes et belles d’enfants à la guerre. Je me suis posé la question : et si je contemplais un tableau et que j’y reconnaissais un visage ? Le monde de l’art m’a semblé le contexte évident dans lequel situer l’histoire.
Je voudrais souligner que, même si mes livres sont des romans policiers, j’écris rarement du point de vue des forces de l’ordre (ça m’arrive parfois, mais ce ne sont jamais les personnages principaux, et presque toujours des gens un peu loufoques). C’est parce que je veux pouvoir explorer un nouvel univers à chaque livre. Sortir un polar du commissariat est une façon de regarder les stéréotypes traditionnels sous un nouvel angle. L’effet peut être saisissant.
Liliba : Dans Jusqu’à la folie, votre personnage principal, tout comme le Joseph de Beau parleur, n’était pas vraiment sympathique. Pourquoi ne pas créer des héros sympathiques ? Cela dit, votre talent fait qu’on a malgré tout terriblement envie de savoir ce qui va leur arriver, donc peut-être que cette question n’a pas de raison d’être ;-)
Il y a une vérité communément admise dans l’édition selon laquelle votre héros doit être sympathique et qu’on puisse s’y identifier. Je déteste cette idée. Je la trouve lamentablement réductrice et à côté de la plaque. Certains des personnages les plus fascinants de la littérature sont parfaitement déplaisants, voire repoussants. Humbert Humbert, Anna Karénine, Madame Bovary, Meursault… Pour ma part, je me suis donné pour mission de créer des personnages qui soient complexes, complets, et souvent exécrables. C’est ce qui les rend vrais. Les vrais gens ont des côtés exécrables. Moi, en tout cas, c’est sûr.
Mais il est intéressant de noter (fascinant, même) que tout le monde ne trouve pas Joseph antipathique. Un certain nombre de lecteurs m’ont dit qu’ils le trouvaient pitoyable et tragique. Bien sûr, le jugement qu’on a de lui dépend beaucoup de savoir si l’on considère son comportement comme le produit de ses choix ou l’expression du destin. C’est l’une des questions au cœur du livre, et pour cette raison il me semble qu’il doit être comme il est, avec tous ses défauts. Il nous oblige à le regarder et à le juger ; ce jugement nous révèle alors quelque chose de nous-mêmes.
Jacques : Comment est née l’idée de ce personnage philosophe de Joseph Geist ?
J’y ai déjà un peu répondu en expliquant pourquoi j’avais décidé de faire de lui un philosophe. J’ajouterais que son parcours (ou du moins le parcours qu’il choisit de nous faire partager) le rend particulièrement apte à susciter un débat sur le fait que son effondrement moral soit ou non de sa faute. Qu’est-ce qui est lui ? Qu’est-ce que l’éducation ? Qu’est-ce que le destin ? Joseph est un cobaye parfait pour explorer toutes ces questions.
Plus concrètement, j’avais un ami à Cambridge qui a vécu plusieurs années en louant une chambre dans une vieille maison avec une vieille dame. Leur relation était en vérité très douce et très belle, mais quelque part dans les méandres de mon cerveau je l’ai transfigurée en quelque chose de pervers et de symbiotique.
Liliba : Le chapitre dans lequel Joseph relate ce qu’il a commis dénote de tout le reste du roman puisqu’au lieu de parler en « je », il interpelle le lecteur : « vous », et cela de manière très forte puisque le « vous » est répété de nombreuses fois. Pourquoi cette distanciation ? Est-ce que les émotions sont trop fortes pour que Joseph les assume en continuant à narrer les évènements en son propre nom ?
Ah, c’est une excellente question. Je vous dirai que j’ai d’abord écrit ce chapitre dans le même style que le reste du livre, à la première personne. Mais ça ne collait pas. J’ai commencé à tester la deuxième personne, et j’ai découvert en relisant mes propres mots que je me sentais impliqué, coupable et très mal à l’aise. Avec la deuxième personne, le lecteur se retrouve entraîné de force dans l’histoire et donc obligé de se demander s’il aurait fait pareil. Si vous étiez seul, paniqué et frigorifié, que feriez-vous ? Feriez-vous mieux ? Pour ma part, j’aime à penser que oui, mais je ne peux pas le garantir. Et j’en suis encore moins sûr à présent, après avoir écrit ce chapitre.
Quant à savoir si c’est Joseph qui souhaite créer cette tension chez le lecteur, ou moi, l’auteur, je ne vous le dirai pas.
Jacques : Joseph termine sa vie en prison et il finit par trouver sa place dans celle-ci, bien mieux que dans le monde où il vivait « avant ». La prison peut-elle être, pour certains individus, une protection contre le monde extérieur ?
C’est très difficile à dire. Protection… C’est un mot délicat. Je dirais qu’à mon avis, certaines personnes ont du mal à vivre dans la société conventionnelle. Mais on s’aventure en terrain glissant, là. Je ne veux pas ouvrir un débat sur la prison ou l’internement forcé… Je n’ai pas le courage d’aborder ça maintenant, c’est trop de pression. Joker !
Liliba : Prendre son temps, laisser le lecteur s’imprégner des décors et des sentiments des protagonistes, poser les caractères, une marque de fabrique ?
J’aime laisser une histoire s’amonceler comme un orage au loin. Ça demande un peu plus de patience et de confiance de la part du lecteur, parce que dans mes romans vous n’allez pas forcément avoir un feu d’artifice dès la première page. Mais à mes yeux l’impact du crime est beaucoup plus fort quand on a eu le temps de faire connaissance avec les personnages dans leur vie quotidienne. En particulier, l’effet de la violence physique (qui est presque toujours au cœur d’un roman policier) devient bien plus choquant et effrayant.
Beaucoup de polars – et là c’est vraiment la faute d’Hollywood, où les méchants se font descendre et s’évaporent comme les personnages d’un jeu vidéo – traitent la violence comme quelque chose de rapide et facile, alors qu’en vérité le moindre épisode de violence est, pour une personne normale, absolument terrifiant et psychologiquement destructeur. Un jour je me suis fait agresser dans un bus. Un homme assis derrière moi s’est penché en avant et s’est mis à m’étrangler. Je m’en suis sorti indemne, sans rien de grave. Mais les répercussions de ces dix secondes-là ont duré des semaines et des semaines.
Dans la première saison d’une de mes séries préférées, The Wire (Sur écoute), un personnage se fait tirer dessus lors d’une intervention. Ce qu’il y a de brillant dans cette série, c’est qu’elle passe réellement du temps à nous montrer les suites de cette blessure : on voit la victime boitiller sur un déambulateur pour faire sa rééducation, l’indignation extrême de ses collègues, etc. Se faire tirer dessus n’est pas une mince affaire. Un meurtre est une affaire colossale. Même une gifle n’est pas rien. Il est important, à mon avis, de prendre pleinement conscience de l’univers du personnage pour vraiment apprécier les effets de la violence. Plus vous avez passé de temps avec un personnage avant cet instant crucial, plus vous l’avez compris et vous êtes investi en lui, plus vous allez ressentir la véritable horreur d’un acte de violence physique.
Liliba : Une constante également dans les personnages : leur capacité d’autodérision. Une qualité que vous possédez ?
Nan, je suis complètement narcissique.
Liliba. Trois remarques soulevées par le blogueur Daniel Fattore : Alma est une vieille dame assez extraordinaire. Mais il semble que son passé soit un peu trouble. Vous suggérez un passé nazi et y revenez rapidement à la fin du roman, mais cette piste semble non exploitée...Pourquoi ?
Alma était une jeune femme pendant la guerre, et bien qu’elle-même ne soit jamais directement identifiée comme nazie, son père oui (du moins à ce que dit Eric). Je ne voulais pas entrer trop en détail dans la guerre, parce que si vous faites ça, vous ne vous en sortez plus, ça devient un livre sur la guerre. Je pense aussi que lorsqu’un écrivain juif (et je suis un écrivain juif, même si mes livres ne sont pas – jusque-là – explicitement imprégnés de judaïsme) évoque le nazisme, il prend le risque d’introduire des éléments narratifs et émotionnels qui n’ont pas forcément de rapport avec l’histoire. Je veux dire qu’un écrivain juif parlant de l’holocauste a forcément quelque chose à dire, ou en tout cas devrait. Il ne doit pas s’en servir comme d’une métaphore facile du mal.
Cela étant, comme c’est un livre sur le destin, la famille et le choix, j’ai cherché à créer des résonnances similaires dans le passé de tous les personnages. On comprend que l’argent d’Alma est sale, et de la pire des façons imaginables. Il est frappé de malédiction. Bien sûr, une personne aussi rationnelle que Joseph ne croirait jamais à un truc pareil. Mais il y a beaucoup de choses qu’il échoue à comprendre, et à la fin sa chute est due à son appât du lucre pour cette montagne de fric révoltante et faustienne.
Liliba : De même, vous appâtez le lecteur avec quelques scènes amusantes et affriolantes (les trois locataires), mais le laissez sur sa faim… Pourquoi avoir abandonné ces personnages qui auraient pu prendre part à l’histoire d’une façon peut-être amusante ?
Un des plaisirs majeurs de la fiction est qu’elle me permet de faire des digressions et ce genre de petit numéro de claquettes sur le bord de la scène avant de revenir à mes moutons. J’essaye quand même que ça reste toujours un minimum pertinent, de les utiliser pour éclairer quelque chose chez les personnages principaux ou les thèmes du livre. Les trois colocataires de Joseph, par exemple, illustrent à quel point il est en décalage par rapport aux gens de son âge, et donc le rapprochent encore un peu plus d’Alma.
En tout cas, si ce sont les numéros de claquettes qui vous amusent, mon prochain roman, Bestseller, devrait vous ravir (voir plus bas).
Liliba : Libre arbitre et liberté. Quelle est votre opinion sur ce sujet ? (vaste !). Chaque personnage du roman semble en effet lié à un autre (je cite Daniel) «personne n'agit vraiment comme il le souhaite. Du point de vue le plus léger, Alma est sous la coupe d'Eric, son parasite de neveu. Plus gênant, quoique ponctuel, Yasmina, l'ex-copine de Joseph, devient folle en préparant un mariage dont elle ne sait pas si elle en veut vraiment et croule sous les pressions familiales; quant à Joseph, embarqué dans une affaire qui le dépasse, il est condamné à réfléchir et à décider à (très) court terme - et c'est son histoire qui conduit le lecteur. Quant à ses parents, enfin, eux aussi se sont mariés sans vraiment le vouloir... »
Oui, c’est une vaste question à laquelle il est impossible de répondre, et j’ai écrit ce livre pour me mettre aux prises avec elle parce que je la trouve obsédante. Je crois que mon opinion sur le sujet varie comme ça m’arrange. C’est-à-dire que, quand je suis dans une phase de réussite, heureux, je me sens maître de ma vie et j’attribue ma condition à ma propre volonté. Mais il y a quelque chose d’extrêmement réconfortant, n’est-ce pas, à renoncer à ce contrôle. À pouvoir se dire qu’en fait on n’a pas le choix, que notre processus de prise de décision est une illusion de la biologie et de la physique. Quel soulagement, surtout lorsqu’on se sent débordé et pas à la hauteur. Quand je me sens jaloux d’autres écrivains, quand je suis frustré ou angoissé par le fait que la durée de mon passage sur terre s’amenuise, je me rappelle qu’au fond je ne suis guère plus qu’un sac d’eau, qui disparaîtra de ce monde sans que – presque – personne ne s’en rende compte. J’ai un ami qui aime à répéter : « Souviens-toi : tu as beau te trouver nul ou formidable, il y a un milliard de Chinois qui s’en tapent complètement. » Et une autre citation, cette fois de Nabokov : « Le berceau balance au-dessus d’un abîme, et le sens commun nous apprend que notre existence n’est que la brève lumière d’une fente entre deux éternités de ténèbres. »
La vraie question pour moi, c’est : qu’est-ce que je vais dire à mes enfants ? Vais-je leur offrir l’image d’un homme assuré dans ses choix, ou bien rongé de doute, ou bien encore passif, ballotté au gré de forces qui lui échappent ? Qu’est-ce qui est plus sain pour eux ? La vérité ? Un mensonge ? L’ambigüité ? Je n’en ai aucune idée. Ce sera un miracle s’ils finissent normaux.
Liliba : Pouvez-vous nous dire quand sortira votre prochain roman, et quel en sera le thème ?
Il aura pour titre Bestseller et sortira en France en octobre 2013.
Arthur Pfefferkorn est un écrivain raté. Son meilleur ami depuis quarante ans, William de Nerval (!), est quant à lui un auteur de polars immensément populaire. Pour ne rien arranger, William a épousé la femme dont ils étaient tous les deux amoureux. Le livre commence alors que William vient de mourir dans un accident de bateau et que Pfefferkorn se rend à son enterrement. Là, il retrouve sa veuve qui l’invite à passer la soirée chez elle. Errant dans la maison la nuit, il tombe sur un manuscrit inédit dans un tiroir et il ne peut s’empêcher de le voler pour le publier sous son nom. C’est un énorme best-seller. Mais alors les choses partent dans une spirale infernale qu’il me serait impossible de résumer ici. Je vous garantis que vous ne pourrez pas soupçonner ce qui arrive ensuite.
Je suis très impatient que ce livre sorte en France. Je pense qu’il y rencontrera un très grand public. C’est à la fois un polar et une parodie de polar, qui ne ressemble à rien de ce que j’ai pu faire avant. Ce qui m’enchante le plus, c’est de frôler sans cesse la catastrophe (et de reculer aussitôt), et je crois que ce livre y parvient. Il est extravagant, surréaliste, cérébral, puéril, c’est une explosion tout droit sortie de mon « ça ». J’espère que ça plaira aux gens.
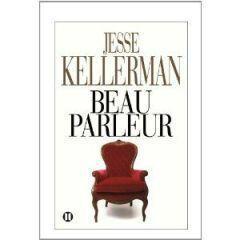
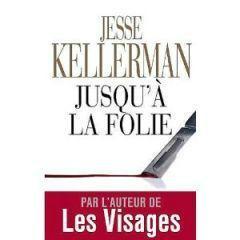
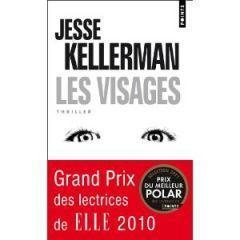
Pour les puristes, voici également l'entretien en anglais...
Hello Jesse! This questionnaire was written by Liliba and Jacques, who have both published articles on Beau Parleur for the Polar-Collectif website. Jacques: Firstly, a big thank you, Jesse, for accepting to answer our questions to mark the publication of Beau Parleur in France.
My pleasure—thank you.
Jacques: How would you introduce yourself to French readers who do not yet know you and are about to discover your novels?
I aim to write the kind of books that I enjoy reading. As a reader, I’m interested in novels that explore the boundaries between literary and commercial fiction. I want a good story, and I want that story to be told in a new and exciting way, with fresh language. I also have a taste for the bizarre and the dark, and my sense of humor is rather appalling—my instinctive response to horror is to laugh. It is perhaps for this reason that I’ve found greater success in Europe than in the United States, where everybody expects a happy ending.
Jacques: After three novels you are now a well-known author in France where you are considered to be one of the most promising contemporary thriller/suspense writers around. Did you expect such success when you started writing?
I started dictating stories to my father when I was very young—at the age of two, before I could write them down. Clearly, I was obeying an instinct, rather than pursuing a goal. (I doubt any two year-old thinks of his future career.) It is an instinct that I have continued to obey for the last thirty-two years, and it is almost incidental that I have come to make my living doing so. That is to say: the writing impulse, the storytelling impulse—they precede the desire to publish, or ought to.
For many, many years I wrote without publication, without attention from anyone save my family, without compensation save self-gratification. So while I was, by most people’s standards, quite young when I sold my first novel, at that point I had been getting rejected for over two decades. I had a respectable career lined up (I was bound for law school), and I imagined my future as an ordinary man in an office, with a peculiar hobby. Thus it was for my father, a psychologist, for fifteen years. (Thus it was for Kafka for his entire life!) That things have turned out differently for me is still hard to comprehend. Nor do I take my good fortune for granted. At any moment I expect to fail, and to be forced to find a more conventional job. Hence I write with a sense of desperation and panic, of trying to keep myself at it for just one more book.
Anyone who writes expecting success is either deluded or has a grotesque sense of entitlement.
Jacques: Your parents, Faye and Jonathan, are both internationally renowned authors. Did they influence your decision to become a novelist? Was writing always an obvious, “natural” vocation for you?
(See also above.)
My parents never overtly pushed me to do anything. Really, it’s true. Hard to believe in this day and age, when parents (Western parents, at least) start programming their children as soon as they’re yanked from the birth canal. Of course, my parents’ mark on me is indelible, as any parent’s is on any child. They crafted my moral sense; they schooled me in matters large and small. Every family speaks its own language. For another family, it might be mathematics or politics; for us, it was stories and characters.
With respect to the craft of writing, their most powerful lessons were taught not explicitly, but by example, and they had more to do with the daily devotion required to write professionally than anything aesthetic. Write every day, even if you’re not in the mood; outline; rewrite; persevere; rewrite again.
Liliba: I cannot speak for the US, but in France the term “thriller” is extremely marketable and attention-grabbing. However, in my opinion, this categorization is too narrow for your novels, which could be considered mainstream literature even if they contain a certain element of suspense. What is your view?
I would not be so arrogant as to set myself apart from other writers, nor so foolish as to second-guess the marketing department. Suffice it to say that I feel uncomfortable in either the literary world or the genre world, and that one of my artistic aims (if I may claim to have any) is to smash the wall that divides them.
Jacques: In Les Visages you reveal the secretive modern art world, in Jusqu’à la folie the inside of a New York hospital and in Beau Parleur we enter the campus of Harvard university. How do you choose the backdrop for your novels?
My wife is a doctor; I went to Harvard; I am an art fanatic. However, this is too simple. More often I begin with the theme or the nugget of story, and I build out from there; the protagonist then suggests the setting, because every protagonist needs a milieu, a profession, a history, and so forth. In the case of Beau Parleur, for example, I wanted to write about a man by his nature incapable of action, who is then forced to take extreme action. The world of the philosopher is bound up in books and words, and it seemed the right medium for Joseph Geist to be paddling in. For Les Visages, I was inspired by a particular painting, by the American artist Henry Darger, who depicted violent and beautiful scenes of children at war. The question occurred to me: what if I was looking at a painting, and saw a face that I recognized? The art world seemed the obvious place to set the story.
It’s worth noting that, although my books are suspense novels, I seldom write from the perspective of people in law enforcement. (Sometimes I do, but they’re not typically the protagonists, and they are almost always oddball characters.) This is because I want to open up a new world with every book. Moving a thriller out of the police station is a way to look at traditional tropes in new ways. The effect can be startling.
Liliba: In Jusqu’à la folie, your main character, like Joseph Geist in Beau Parleur, is not very likeable. Why do you choose to create unsympathetic protagonists?
That said, your talented writing compels us to want to discover what will happen to these characters, so perhaps I’ve found my own answer to this question ;-)
There’s an accepted truth in publishing that your protagonist must be relatable and likeable. I hate this idea. I think it’s miserably confining and utterly beside the point. Some of the most fascinating characters in literature are in distasteful, or even repellent. Humbert Humbert, Anna Karenina, Madame Bovary, Meursault… So I’ve set out to create characters who are complex, and complete, and often ugly. To me they’re real. Real people have ugly sides. I know I do.
It’s worth noting (fascinating, I think) that not everyone finds Joseph unsympathetic. Quite a few readers have told me that they find him piteous and tragic. Of course, your judgment of him depends largely on whether you consider his behavior the product of choices or the expression of fate. This is one of the questions at the heart of the book, and for this reason I think he must be the way he is, warts and all. He forces us to look at him and judge him; that judgment then reveals something about ourselves, to ourselves.
Jacques: What or who inspired you to create the character of the philosopher Joseph Geist?
I addressed this a little bit before, when I mentioned why I made him a philosopher. I’ll add that his background (or at least, the background that he chooses to share with us) makes him uniquely suited to provoke a debate about whether his moral collapse is his fault. What is him? What is upbringing? What is fate? Joseph is a lab rat to explore these questions.
More literally, I had a friend in Cambridge who lived for several years as a tenant in an old house with an old woman. Their relationship was actually very sweet and beautiful, but somewhere in the recesses of my mind it was transfigured into something perverse and symbiotic.
Liliba: The chapter in which Joseph relates the crime he has committed distinguishes itself from the rest of the novel because instead of speaking in the first person, he refers to the reader “you”. This is done in a very effective way as the “you” is repeated a number of times. Why did you choose to “distance” the character in this way? Are Joseph’s emotions too strong for him to acknowledge them and continue to narrate events in the first person?
Oh, that’s an excellent question. I’ll tell you that I first wrote the chapter in the same style as the rest of the book, in first person. But it felt wrong. I began to experiment with the second person, and what I discovered as I read my own words back was that I felt implicated, and culpable, and very uncomfortable. With the second person, the reader is shoved into the story and thereby forced to ask him or herself if he would do any differently. If you were panicked, and freezing, and alone—what would you do? Would you do any better? I’d like to think I would, but I can’t say for certain. I feel even less certain now, having written the chapter.
Whether it is Joseph who wants to create that tension in the reader, or me, the author, I won’t say.
Jacques: Joseph finishes his life in prison and manages to settle down and find his way much better than in the outside world in which he lived “before”. For certain individuals can prison actually provide “protection” from the outside world?
That’s extremely difficult to say. Protection… That’s a tricky word. I’ll say that I think some individuals have a difficult time living in conventional society. This is getting dangerous, here. I don’t want to open up a debate about prison or about forced institutionalization… I can’t stomach it right now; it’s too much pressure. Pass.
Liliba: Taking your time, letting the reader absorb the décor and emotions of the characters, developing and building their personalities; do you consider this to be your trademark?
I like to let a story gather like a distant storm. It requires a little more patience and faith on the part of a reader, because in my novels you’re not necessarily going to see fireworks on the first page. But to me the impact of crime is far more powerful when you’ve had some time to get to know the characters in the daily lives. In particular, the effect of physical violence (which is almost always at the center of a crime novel) is made more shocking and more horrifying.
So many thrillers—and this is really the fault of Hollywood, where bad guys get shot and evaporate, like characters in a video game—treat violence as something easy and quick, when in fact the smallest episode of violence is, for a normal person, utterly terrifying and psychologically destructive. I was once assaulted on a bus. A man sitting behind me leaned over and began choking me. I was fine. Nothing lasting happened to me. But the reverberations of those ten seconds continued for weeks and weeks.
In the first season of one of my favorite shows, The Wire, a character is shot during an undercover operation. The brilliance of that show is that it actually spends time showing what happens in the aftermath of the shooting: it shows the victim hobbling on a walker to do her rehabilitation, the extreme outrage of her colleagues, and so forth. Getting shot is a very big deal. Murder is a very, very big deal. Even a slap is not a small deal. It’s important, in my mind, to fully realize the world of the character, so that the effects of violence can be appreciated. The more time you spend with a character prior to that disruptive moment, the more you understand and invest in them, and the more you’re going to feel the true horror of an act of physical violence.
Liliba: Another recurring theme for your characters is their capacity for self-deprecating humour or self-derision. Do you yourself possess this quality?
Nah, I’m an egomaniac.
Liliba: I quote a fellow blogger, Daniel Fattore: “Alma is a pretty extraordinary old woman. But she seems to have had a troubled past. The author suggests that she was involved with the Nazis and refers to this briefly again at the end of the novel, but otherwise he does not elaborate on this narrative strand.” Why?
Alma is a young woman during the war, and while she herself is never directly implicated as a Nazi, her father is. (Or so Eric says.) I didn’t want get deeply into the war, because once you do, you can’t escape: it’s a book about the war. I also think that when a Jewish writer (and I am a Jewish writer, even if my books are not [so far] explicitly Jewish in nature) mentions Nazis, he runs the risk of introducing narrative and emotional elements that are not otherwise relevant to the story. That is to say, a Jewish writer talking about the Holocaust means something, or ought to. It should not provide a cheap metaphor for evil.
That said, because this is a book about fate and family and choice, I sought to create similar resonances in all the characters’ backgrounds. We understand that Alma’s money is tainted, in the severst way imaginable. It carries a curse. Of course, nobody as rational as Joseph would ever believe such a thing. But there is much that he fails to understand, and in the end his downfall is linked to his greed for this revolting, Faustian pile of lucre.
Liliba: Similarly, you lure the reader with several amusing and titillating scenes (the three housemates) but leave us hungry for more! Why did you choose to abandon these characters, who could have added an amusing element to the story?
One of the chief pleasures of fiction is that it allows me to digress and do these little tap-dances at the side of the stage for a moment before returning to the matter at hand. I do try to keep them at least marginally relevant; I want to use them to illuminate something about the primary characters or the themes. Joseph’s three roommates, for example, illustrate the extent to which he’s totally out of touch with people his own age, and drive him deeper into Alma’s bosom.
At any rate, if it’s the tap-dances that amuse you, my next novel, Bestseller (see below) will make your day.
Liliba: Free will and freedom. What is your opinion on this (vast!) topic? Each character in the novel seems bound to another (I quote Daniel Fattore again): “No one really acts as they would like. At the most innocuous level, Alma is wrapped around Eric’s (her parasitic nephew’s) little finger. More disturbingly, although less present in the novel, Yasmina, Joseph’s ex-girlfriend, goes mad preparing for a wedding she is not sure she wants to go ahead with and breaks under the pressure exerted by her family. As for Joseph, caught up in an affair which is beyond him, he is forced to reflect and choose his actions in the (very) short term. And finally his parents get married without really wanting to…”
Yes, it’s a vast, unanswerable question, and I wrote the book to wrestle with it, because I find it so upsetting and impossible. I think my opinion varies as I need it to. That is, when I am successful, and happy, I feel in control of my world, and I attribute my state of being to my own will. But there’s something enormously consoling, isn’t there, about yielding that control. To be able to tell yourself that you in fact have no choice, that your decision-making process is an illusion of biology and physics—how comforting, especially when you feel overwhelmed and unequal to the task. When I feel envious of other writers, when I am frustrated or anxious about my time on earth slipping away, I remember that I am ultimately little more than a sack of water, one that will pass from this earth largely unnoticed. A friend of mine is fond of saying: “Remember: no matter how great or terrible you think you are, a billion Chinese people couldn’t care less.” And another quote, this time from Nabokov: “The cradle rocks above an abyss, and common sense tells us that our existence is but a brief crack of light between two eternities of darkness.”
The real question for me is: what am I going to tell my children? Am I going to present to them the picture of a man confident in his choices, or one riddled with doubt, or a passive man, buffeted by forces beyond his control? What is healthier for them? The truth? A lie? Ambiguity? I have no idea. It’ll be a miracle if they turn out normal.
Liliba: Can you tell us about your new novel, Bestseller (publication October 2013)?
Arthur Pfefferkorn is a failed literary writer. His best friend of forty years, William de Nerval (!), is a hugely successful thriller writer. To make matters worse, William married the woman they both loved. The book opens after William dies in a boating accident and Pfefferkorn travels to attend his funeral. There he meets up with the widow, who invites him to spend an evening at her house. Wandering the halls late at night, he finds an unpublished manuscript in a drawer, and, overcome with need, he steals it—publishing it as his own. It’s a massive success. And then things spiral out of control, in a way that I cannot begin to describe. I guarantee that you won’t guess what’s coming next.
I simply can’t wait for this book to get to France. I think it’s going to find a tremendous audience there. A thriller and a parody of a thriller at the same time, it’s utterly unlike my previous books. I feel happiest teetering on the edge of the disaster (and pulling back), and I believe that this book manages to do it. It’s wild, it’s surreal, it’s cerebral, it’s childish, it’s an explosion straight from my id. I hope people enjoy it.
THANKS A LOT !!!

