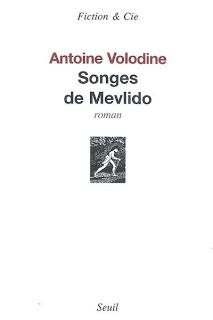
Éditions du Seuil - Fiction & Cie
Oubliez ce que vous vivez, ce que vous croyez vivre, voir, connaître. Oubliez que dehors il fait beau, ou même qu’il pleut. Oubliez qu’il vous semble naturel de distinguer entre le jour et nuit, entre le rêve et le réel. Oubliez ce que la science vous apporte comme confort, oubliez jusqu’à la nature qui bourgeonne au printemps, et jusqu’à la joie d’une caresse, et jusqu’à ces projets que vous formiez, pour l’avenir, pour demain. Oubliez vos rêves de grande Histoire, vos fantasmes de Révolution et vos prières ardentes afin que le monde connaisse de nouveaux enchantements. Et ne vous fiez pas trop aux autres, ni aux animaux qui leur ressemblent. Ici, à quelques années de nous, tout n’est plus que cloaque, pénombre, barbarie boues et bribes humaines – c’est à peine si l’on trouve trace de souvenirs. Ici, aucun principe de précaution n’a cours, car seuls les mondes non encore désertés par l’espoir peuvent se payer le luxe de prendre des précautions. Vous êtes dans le monde de l’après : d’après la guerre du tous contre tous, qui nous guette, ou dont l’hypothèse au moins n’est pas absolument invraisemblable. Et dans le camp des vaincus, bien sûr, puisque c’est le camp de tous. Désormais, « la guerre noire généralisée est l’unique perspective concrète pour une communauté dont les comportements sont aberrants dans pratiquement tous les domaines ». Quant aux hommes, « en dépit de la révolution mondiale, ils sont descendus à un niveau de barbarie et d’idiotie qui étonne même les spécialistes. » N’allez pas penser pourtant qu’Antoine Volodine prend sa partition dans le chœur du déclin. Son chant est trop froid pour être funèbre, trop distant pour que s’y mêle autre chose qu’un humour sous tension, trop mélancolique pour croire encore à un quelconque pouvoir de la parole en ce monde. En résumé, l’après-monde n’est autre que notre monde, celui des camps et des ghettos, celui des grands récits qui ont chu et des enthousiasmes qui ont sombré, celui de la nudité de l’homme face au deuil. Tout cela est bien moins irréel qu’il y paraît.
« En tout cas, même si je rêve, je suis dans la réalité », pense Mevlido, un perdant, comme tous les autres, policier affecté à la surveillance des anciens révolutionnaires, le plus souvent de très vieilles bolcheviques ressassant les mêmes slogans incompréhensibles (« MAINTIENS-TOI AU MILIEU DES VISAGES ! », « ASSASSINE LA MORT EN TOI ! », « MÊME EN CAS DE DECES, CHANGE D’ITINERAIRE ! »). Mevlido vit à cheval sur les zones de l’ancien monde, à « Oulang-Oulane », dans le quartier « Poulailler Quatre ». Sa femme, Verena Becker, fut naguère torturée par des enfants-soldats, « redoutables, capables d’avoir un rire de bébé au moment où ils cherchaient à atteindre vos organes vitaux ». Il a refait sa vie avec Maleeya, sur qui il veille avec tendresse mais qui le confond avec Yasar, son époux mort à la guerre. Car aucun deuil n’est possible, ni pour l’un, ni pour l’autre, ni pour personne de toute façon. Chez Volodine (quasi-anagramme, involontaire, semble-t-il, de Mevlido), tout se rappelle toujours à nous sous la forme d’un éternel retour de détresse. Aussi Mevlido éprouve-t-il de la sympathie pour ces révolutionnaires isolés, sans bande ni chef, sans consignes ni doctrine, et il vit sa vie dans la porosité des mondes, ceux qui, jusqu’à présent, officiellement, départageaient les morts et les vivants, le réel et l’irénique.
Volodine a coutume de dire qu’il écrit en français une littérature étrangère. C’est une voix comme on en trouve assez peu dans la littérature contemporaine, où l’on distinguera quelques échos du pessimisme orwellien et de l’inquiétude kafkaïenne, pour ne rien dire des insectes : les oiseaux bien sûr, familiers de l’univers de Volodine, mais aussi les araignées, qui « à présent administrent les ruines de la planète. Elles se réclament elles aussi de l’humanisme, et, s’il est exact qu’elles mangent leur partenaire sexuel dès que leurs œufs ont été fécondés, on ne compte pas parmi elles, alors que les millénaires s’égrènent, la moindre théoricienne du génocide, de la guerre préventive ou de l’inégalité sociale. » On dit Volodine difficile à lire. Je ne crois pas. Seulement faut-il se défaire de ce que l’on croit voir du monde, y regarder d’un peu près, à bonne distance, chercher la mécanique à l’œuvre dans ce que l’on croit être la condition humaine et accepter d’envisager que quelque chose se trame derrière, qui échappe à notre contrôle, quelque chose de physiologique, de mécanique, de destinal : « Les attentats contre la lune ne nous apaisaient pas, ils ne contrariaient pas notre tendance à sombrer fous. Mais à nous, qui n’avions plus de ressort, plus de rigueur idéologique, plus d’intelligence et plus d’espoir, ils donnaient l’impression qu’à l’envers du décor, peut-être, l’existence avait gardé une ébauche de sens ». Songes de Mevlidone ressemble à aucun autre livre, presque à aucun autre genre. On pourrait dire qu’il s’agit de science-fiction, mais alors débarrassée de toute fascination technoïde. Peut-être qu'Enki Bilal pourrait dessiner ce monde redevenu vierge d’hommes, ou plein d’hominidés balbutiant, mais il devrait alors le faire sans super-héros, ni métal, ni rien de ce qui constitue d’ordinaire le futurisme technologique. Un Lynch, plutôt, devrait s’y intéresser : il sait montrer combien le réel est aussi le produit de nos esprits, il saurait retranscrire en images ce qui peut subsister de sensuel dans cet inframonde sans espérance ni lumière, barbare pour ainsi dire, et comme esquissant une inversion de l’évolution, un retour à notre condition d’avant. Mevlido a de vieux restes, de bons vieux restes, de ce qu’il fut et de ce qu’il désespère de ne plus pouvoir être vraiment : « Sous la douche misérable, il se réjouit de ne pas être une simple brute, d’avoir tout de même des traces dans l’esprit, de ne pas mugir sans fin et sans passé comme un idiot dans l’absence de jour. Il se réjouit de durer encore et de pouvoir, quand il y pense, en avoir conscience. » C’est le bord du gouffre, et on ne sait pas vraiment si les choses basculeront ou pas, si Mevlido, qui a « pour tâche de s’immerger dans la barbarie afin de discerner quelques pistes pour le futur », y parviendra. On présume que non, mais c’est peut-être aller plus loin que ce qu’en sait l’auteur lui-même.
Article paru dans Le Magazine des Livres - N° 7, novembre/décembre 2007

