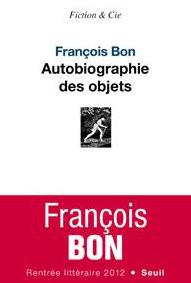Romain Verger

Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point, 1970.
En prenant ici le parti pris des choses, François Bon fait sienne l’une des pistes proposées dans Tous les mots sont adultes (Fayard, 2000), une méthode les ateliers d’écriture que l’écrivain affectionne et dont il est depuis longtemps familier. Dans cet ouvrage, il portait déjà son attention aux objets, replaçant ces propositions littéraires en perspective des inventaires du plasticien Luc Boltanski, de l’œuvre de Ponge, véritable collection de poèmes-objets, comme de L’espace antérieur de Jean-Loup Trassard (un recueil qui fait la part belle aux objets de l’enfance «dont on retrouve l’image et l’existence, en s’immergeant dans ce qui n’est plus, du temps d’abord, des objets ensuite»).
Mais s’attacher aux objets, ce n’est pas seulement s’immerger en eux, au risque de disparaître, c’est interroger son statut de sujet, puisque nous sommes travaillés par ces objets dont nous sommes entourés, que nous accumulons et qui rythment nos vies. C’est à la lumière de ces références qu’il convient d’éclairer le dernier livre de François Bon, en le situant plus encore au croisement de ce motif et de l’autobiographie (explicitement revendiquée dans le titre), genre lui-même fortement balisé. Autobiographie des objets accomplit cette figure acrobatique qui consiste à se rejoindre par le biais de ce qui semble à première vue le plus éloigné de sa subjectivité : l’objet. Une contradiction apparente qui vole en éclats dès que se trouvent prises en compte les notions d’usage, de manipulation, de regard, de possession ou de désir. Ce cheminement intérieur vise à «retrouver l’objet dans son propre emplacement du temps» :
«On arpente les maisons qu’on n’habite plus, on retrouve les visages qu’on ne voit plus. Des objets sont là, dans la pénombre, qu’on ne se souvenait plus y être. On ne se saisit pas de tous, sous le seul prétexte qu’ils sont là. C’est vers soi-même qu’on tisse les questions, et tous n’ont pas, de par la mémoire qu’ils portent, la même capacité à ouvrir cette trappe sombre qu’ils recouvrent.»
L’exercice consiste bien à parler de soi, à remonter le fil de son existence au gré des objets qui l’ont jalonnée et marquée ; une existence vendéenne scindée géographiquement en deux pôles : «mes deux côtés à moi sont Saint-Michel-en-l’Herm et Damvix, aux deux extrémités en diagonale du marais, et deux pôles d’ancrage de l’enfance à jamais symétriques». Le livre se focalise souvent sur la figure du grand-père ; il se clôt d’ailleurs sur le souvenir de sa mort en 1974, une scène fondatrice qui se confond étrangement avec le secret des livres, relégués au grenier par manque de place, dans une armoire vitrée. Sans doute y a-t-il là matière à une mythologie personnelle faite d’anxiété et de curiosité pour ce héros qui a fait la Grande Guerre et en a perpétué les traces, palpables dans les masques à gaz dont les petits-fils s’équipent pour jouer, ou dans l’exemple de cette baïonnette «qui fascine l’enfant parce que reliée à son anxiété, à l’inquiétude native, et que certains jours cela remonte plus lourdement sous la peau : tout dépend du désordre et de l’incertitude du monde, et ces derniers temps il craque et se fissure. La baïonnette est l’anxiété secrète de mon enfance.»

Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point, 1970.
Le constat est sans appel : «les objets étaient des mondes» et «le temps des objets a fini». Notre société contemporaine a fait son deuil de la permanence («cette masse de temps accordée à l’enfant solitaire» qu’il était) et ne produit plus que des objets périssables, «à obsolescence programmée». Les objets duraient, on réparait les appareils, on les décortiquait, on les ranimait ou bien l’on récupérait leurs composants électroniques, leurs transistors et leurs alimentations électriques pour en fabriquer d’autres. Et il est touchant d’entendre cette nostalgie de la voix-même de François Bon, l’un des défenseurs les plus acharnés de la cause numérique et de la dématérialisation des supports, à commencer par le livre. Or, c’est dans ce regard rétrospectif, sensible et empreint de mélancolie que la démarche de l’écrivain est particulièrement juste, dans cette tentative par l’écriture (c’est le principe même de toute autobiographie, à ceci près qu’elle se matérialise ici dans les objets) de ressusciter un monde évanoui, celui de l’enfance et de l’adolescence, à travers ces objets perdus :«J’appartiens à un monde disparu — et je vis et me conduis au-delà de cette appartenance. C’est probablement le cas pour tout un chacun. La question, c’est l’importance et la rémanence matérielle d’un tel objet, parfaitement incongru, parfaitement inutile, dans le parcours personnel.»
Il y a d’abord pour l’enfant ces objets sans utilité, choses de pure gratuité dans lesquelles s’incarne le geste poétique, qui préfigurent son engagement artistique ultérieur. C’est le cas du nylon qui n’existe d’abord qu’en tant que pure materia et qui, se voyant assigner un usage par la mère, perd aussitôt son pouvoir attractif. Tel encore le miroir qui pour l’enfant devient un instrument singulier de dépaysement, de déplacement :
«Je me servais du miroir dans la maison, en suivant mon chemin au plafond. C’était fantastique et merveilleux. Pour passer d’une pièce à l’autre on sautait des abîmes. Je ne me souviens de ce miroir qu’à le tenir pour regarder le plafond en marchant. Dehors, c’était encore bien plus inquiétant : c’est le ciel qui surgissait sous vous.»

Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point, 1970.
Ce parcours à travers les inventaires d’objets est d’abord celui d’un écrivain qui remonte aux origines de sa vocation. Ce sont les retraites dans le garage familial ou le grenier, dans ces véhicules dont l’enfant fait son repaire de lecteur et de rêveur, la découverte des poètes — Verlaine ou Hugo — recopiés par le grand-père aux grandes heures de 14-18, dans son carnet noir de Verdun, «pour repousser la totalité obscurcie du ciel et de la terre». François Bon se remémore ses premières collections (Bibliothèque verte, Club des cinq, les Jules Verne...) dont les souvenirs sont d’abord matériels : «les motifs or sur fond rouge des Rouge & Or ou des Spirales, les incrustations mi-reliefs, mimant les vieux livres reliés, de la Bibliothèque de l’amitié, sont définitivement associés à leur lecture. Comment retrouver cela dans les usages d’aujourd’hui?» Les registres de comptabilité du garage quant à eux servent de support aux premiers écrits. Aujourd’hui, nos ordinateurs font tout pour se faire oublier, pour s’effacer derrière leurs applications, mais auparavant, la création était indissolublement associée à ces outils, qu’il s’agisse des machines à écrire, de la lettreuse Dymo et autres Lettraset qui apparaissent comme autant de prototypes des pratiques éditoriales contemporaines.Autobiographie des objets est aussi une photographie de la France consumériste des années soixante, des prestiges de la radio bientôt détrônée par la télévision qui s’imposera durablement, de l’aérogare d’Orly (il faut revoir le magnifique Playtime de Jacques Tati) vers lequel on converge en famille le week-end pour voir décoller et atterrir les avions. C’est la France désuète du calendrier des postes, du Guide Michelin, de l’annuaire et du télécran, des boîtes à chaussures où l’on collectionne les cartes postales comme autant de fragments géographiques à portée de main.
Ce livre dit aussi combien l’objet est capable de conjurer l’oubli, l’évanescence des traits de ceux qu’on a aimés : en revenir aux objets, c’est contre toute attente ressusciter des pans incarnés du passé : «Ce qui est sûr, pour moi, c’est la disparition des silhouettes, de lui, d’elle, tandis que l’intérieur du hangar quasi vide, sa lumière assombrie, restent aussi précis que le vélo et sa remorque.»
Un livre à savourer comme une madeleine de Proust, qui ne manquera pas d’exhumer de la mémoire des lecteurs de quarante ans et plus d’émouvants souvenirs d'objets aimés, aujourd'hui disparus de notre quotidien, et de suggérer à la conscience des plus jeunes les contours d'un monde inconnu d'eux.
François Bon, Autobiographie des objets, Seuil, 2012. 18€