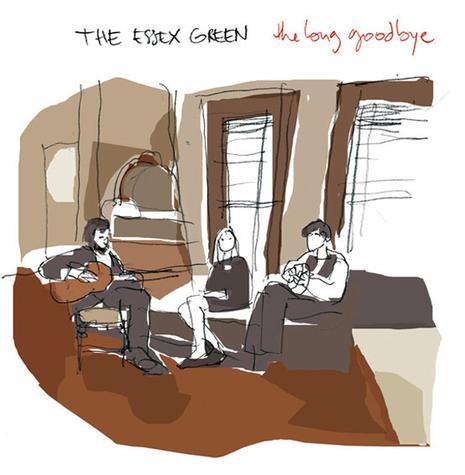 The Long Goodbye vu par François Matton (blog ici) Un. Je suis à Amsterdam, chez Henk Hofstede, des Nits. Le thé noir aux épices de Henk est encore chaud et nous soufflons-grimaçons en portant le mug fumant à nos lèvres. Par moments, Henk sourit en direction de la fenêtre tout en se caressant l'avant-bras. Entre nous, sur la table de la cuisine, un petit système audio portatif, qui se déplie : j'ai amené l'album The Long Goodbye de The Essex Green, afin de lui faire écouter Lazy May. Aux premières mesures de la chanson (batterie un peu enroulée, gentille, guitare « ligne claire » répartissant dans l'espace le strict nécessaire à la recomposition d'une courbe), le coin très dessiné des yeux de Henk m'impressionne, alors qu'il porte sur moi un regard indécidable. Je me demande même un instant si je n'ai pas commis un impair. A l'apparition de la voix, troisième élément « nitséen », enfin l'homme sourit, quelque chose en lui vient de céder. OK, on dirait une chanson à moi. Sur le live de 1989 elle aurait eu de la gueule. D'accord. Il se pianote un bout de rythme, presque trop rapide, sur l'avant-bras. C'est réglé dans son esprit. Pourtant, la tension en moi est intacte ; j'attends le refrain. Arrive le refrain. And I - I love you And I - I love you Oh-oh my lazy May C'est triomphant et retenu à la fois. Le sentiment ne doit pas s'être ancré depuis très longtemps dans le cœur de celui qui le chante ainsi. Peut-être même l'homme le chante-t-il en même temps qu'il le découvre en lui. Ou bien ses souvenirs sont intacts. Ou bien l'écriture lui a rendu ses souvenirs. Et cela change tout dans la cuisine. Henk va chialer, je me dis, à un moment. Oh, des chansons, il en a eu de plus belles, il n'est pas question de compétition ou d'ego quand on a écrit Apple Orchard. C'est juste que celle-ci, il la cherche depuis des années pour terminer ses concerts. En effet, sur scène, depuis toujours, Henk semble s'excuser d'avoir consacré sa vie à l'écriture. Il veut prouver qu'on s'amuse, que c'est populaire, son côté chanson de marin se réveille. Avec Lazy May, il aurait tenu les deux : la lumière intérieure et le sentiment du groupe ; l'impartageable et le commun. Deux. J'écris avec des rires et des bruits de jeux dans la chambre d'à côté : ma fille de quatre ans reçoit une petite copine. Sur le site Web de The Essex Green, ils annoncent une naissance : « Voici le nouveau membre de The Essex Green. » C'est très bête. Mais cela fait sens. Tout monte d'un cran dans l'intime : les fans sont traités en amis, à qui l'on se doit d'annoncer la nouvelle ; les amis musiciens deviennent famille. Le nœud de vipères des liens du sang dont parlait Crevel est ici tout de suite dénoué, au profit d'un rapport électif, fondé sur le partage, la musique, la culture, le projet de vivre en intelligence. The Essex Green, c'est de la pop de la vie quotidienne. Ce fabuleux non-événement : une naissance, s'inscrit tout de suite dans le plan collectif. Et le lieu où elle survient n'est pas sans importance : Brooklyn, où trois des quatre membres du groupe Guppyboy sont venus s'installer, en 1997, depuis Burlington (Vermont) - le trio d'amis se renommant alors The Essex Green, et deux d'entre eux s'investissant parallèlement avec The Ladybug Transistor. A Brooklyn, on ne compte plus les groupes : Ladybug donc, Beirut jusqu'à récemment, Grizzly Bear, Les Savy Fav... Avant de s'installer à Paris, Zach Condon, de Beirut, a réalisé là une série de vidéos (une par chanson de son dernier album, The Flying Club Cup) où la musique investit sans distinction des espaces publics et privés. L'on y voit le groupe en petite fanfare, voyager de rue en rue, d'appartement en loft, d'escalier commun à cour d'immeubles en brique, sous un soleil égal. Le chanteur de Grizzly Bear participe en voisin. Ou bien ce sont les autres qui sont venus chez lui. Trois. Voyager du Vermont à Brooklyn : cela suffirait à expliquer le titre de cet album de 2003, The Long Goodbye. Voyager d'un point de Brooklyn à un autre : cela aurait suffi aussi. Voyager d'une seconde à la seconde suivante : ça marche encore. Robert Altman a bien réalisé tout un film sur un type qui arrête de fumer, alors... Il y a des morts, son meilleur ami disparaît, un écrivain meurt, le meilleur ami n'est peut-être pas mort, tout le monde trahit tout le monde : Philip Marlowe traverse les épreuves comme autant d'étapes vers son arrêt de la clope. Le dernier plan du film est donc aussi le premier où il ne fume pas. Il marche, libéré de tous ceux qui l'ont trahi. Il a voyagé, il est passé par toutes les transformations nécessaires, exactement comme Zach Condon termine son périple vidéo à l'église, parmi les chants. Dans le film d'Altman (Le Privé, en VF), ce que j'appelle ici le « voyage » est symbolisé par la musique : une seule chanson compose la bande (très) originale du film. Théorie de la pop à elle seule, elle se décline sur tous les modes, selon tous les genres musicaux : air fredonné, mélodie de piano-bar, chant langoureux, mariachis d'un enterrement mexicain (le bout d'un voyage). C'est le voyage du thème. C'est le voyage du même. Bien sûr, en VO, ce film de Robert Altman s'intitule The Long Goodbye. Quatre. François Matton me disait le 31 août 2006, dans un e-mail, n'avoir jamais oublié une parole du poète Joseph Mouton, à propos de la création artistique, qu'il résumait ainsi : « "Il faut que ça déconne un peu" (>lâcher-prise) et : "Il n'y a pas d'oeuvre sans une très forte politique de présentation" (>maîtrise et conscience des moyens mis en oeuvre). Ces deux réflexions forment une sorte de koan. » Dans The Long Goodbye (le disque pop), la forte politique de présentation tient à l'inscription dans un quartier, redoublée par une géographie imaginaire (le groupe appartient au collectif Elephant Six). Examinons plutôt le lâcher-prise. On ne le trouvera guère sur scène - les vidéos attestent d'un groupe sans grande dimension visuelle -, mais en amont, dans la pré-écriture, pendant le sommeil peut-être, quand ont surgi les mélodies. Il y a dans Old Dominion, par exemple, des accents d'improvisation enfantine, laissée en l'état, juste arrangée autour pour que cela fonctionne en tant que chanson. Tout le talent tient dans le fait de n'avoir retravaillé que le contexte, sans toucher au corps originel (mais sans se contenter de celui-ci non plus). Un jet d'inconscient, maintenu tel quel au cœur même d'un processus d'écriture, donc de réécriture : le programme du « voyage » est de rester intact. De l'autre côté de la vitre, le paysage change, les voix (féminin / masculin), comme l'instrument-vedette (un seul à la fois, et les autres accompagnent). Le disque prend bientôt la belle unité d'une mosaïque. Un jeu sur le vide et le plein procure ces micro-vertiges qu'on éprouve à passer, à pleine vitesse, à ski par exemple, sur quelque chose de mal défini ; le temps de se poser la question, et l'inconnu est déjà derrière soi. Cinq. The Essex Green ignore l'histoire de la musique après 1969, lit-on partout. C'est bien sûr faux. Leur façon de faire s'apparente plutôt à la seconde vague pop, celle des années 80, des Go-Betweens. Et encore, dans un contexte tellement différent, que l'ensemble du message s'en trouve modifié. Mieux vaut parler de troisième vague, une tous les vingt ans. Certes, lorsqu'ils citent la pop originelle, ils le font sans déguisement apparent du son, sans traitement, et parfois même à l'identique, encourant ainsi le soupçon d'absence d'originalité. Un fragment du passé, un bout de solo, un gimmick, une lubie qu'a eue George Harrison à un moment de sa vie, se retrouve à voyager jusqu'à nous. Mais The Essex Green n'est pas Goldfrapp : l'originalité n'est pas son argument de vente, plutôt sa vérité cachée ; un saupoudrage d'électronique ne vient pas masquer un emprunt mélodique, non : c'est la mélodie même, au cœur même d'un vrai-faux processus de citation, qui à un moment donné, un moment fou, va se décoller légèrement du modèle. Un gouffre s'ouvre. Un vertige, sans commune mesure avec le caractère infime du décalage, nous saisit.
The Long Goodbye vu par François Matton (blog ici) Un. Je suis à Amsterdam, chez Henk Hofstede, des Nits. Le thé noir aux épices de Henk est encore chaud et nous soufflons-grimaçons en portant le mug fumant à nos lèvres. Par moments, Henk sourit en direction de la fenêtre tout en se caressant l'avant-bras. Entre nous, sur la table de la cuisine, un petit système audio portatif, qui se déplie : j'ai amené l'album The Long Goodbye de The Essex Green, afin de lui faire écouter Lazy May. Aux premières mesures de la chanson (batterie un peu enroulée, gentille, guitare « ligne claire » répartissant dans l'espace le strict nécessaire à la recomposition d'une courbe), le coin très dessiné des yeux de Henk m'impressionne, alors qu'il porte sur moi un regard indécidable. Je me demande même un instant si je n'ai pas commis un impair. A l'apparition de la voix, troisième élément « nitséen », enfin l'homme sourit, quelque chose en lui vient de céder. OK, on dirait une chanson à moi. Sur le live de 1989 elle aurait eu de la gueule. D'accord. Il se pianote un bout de rythme, presque trop rapide, sur l'avant-bras. C'est réglé dans son esprit. Pourtant, la tension en moi est intacte ; j'attends le refrain. Arrive le refrain. And I - I love you And I - I love you Oh-oh my lazy May C'est triomphant et retenu à la fois. Le sentiment ne doit pas s'être ancré depuis très longtemps dans le cœur de celui qui le chante ainsi. Peut-être même l'homme le chante-t-il en même temps qu'il le découvre en lui. Ou bien ses souvenirs sont intacts. Ou bien l'écriture lui a rendu ses souvenirs. Et cela change tout dans la cuisine. Henk va chialer, je me dis, à un moment. Oh, des chansons, il en a eu de plus belles, il n'est pas question de compétition ou d'ego quand on a écrit Apple Orchard. C'est juste que celle-ci, il la cherche depuis des années pour terminer ses concerts. En effet, sur scène, depuis toujours, Henk semble s'excuser d'avoir consacré sa vie à l'écriture. Il veut prouver qu'on s'amuse, que c'est populaire, son côté chanson de marin se réveille. Avec Lazy May, il aurait tenu les deux : la lumière intérieure et le sentiment du groupe ; l'impartageable et le commun. Deux. J'écris avec des rires et des bruits de jeux dans la chambre d'à côté : ma fille de quatre ans reçoit une petite copine. Sur le site Web de The Essex Green, ils annoncent une naissance : « Voici le nouveau membre de The Essex Green. » C'est très bête. Mais cela fait sens. Tout monte d'un cran dans l'intime : les fans sont traités en amis, à qui l'on se doit d'annoncer la nouvelle ; les amis musiciens deviennent famille. Le nœud de vipères des liens du sang dont parlait Crevel est ici tout de suite dénoué, au profit d'un rapport électif, fondé sur le partage, la musique, la culture, le projet de vivre en intelligence. The Essex Green, c'est de la pop de la vie quotidienne. Ce fabuleux non-événement : une naissance, s'inscrit tout de suite dans le plan collectif. Et le lieu où elle survient n'est pas sans importance : Brooklyn, où trois des quatre membres du groupe Guppyboy sont venus s'installer, en 1997, depuis Burlington (Vermont) - le trio d'amis se renommant alors The Essex Green, et deux d'entre eux s'investissant parallèlement avec The Ladybug Transistor. A Brooklyn, on ne compte plus les groupes : Ladybug donc, Beirut jusqu'à récemment, Grizzly Bear, Les Savy Fav... Avant de s'installer à Paris, Zach Condon, de Beirut, a réalisé là une série de vidéos (une par chanson de son dernier album, The Flying Club Cup) où la musique investit sans distinction des espaces publics et privés. L'on y voit le groupe en petite fanfare, voyager de rue en rue, d'appartement en loft, d'escalier commun à cour d'immeubles en brique, sous un soleil égal. Le chanteur de Grizzly Bear participe en voisin. Ou bien ce sont les autres qui sont venus chez lui. Trois. Voyager du Vermont à Brooklyn : cela suffirait à expliquer le titre de cet album de 2003, The Long Goodbye. Voyager d'un point de Brooklyn à un autre : cela aurait suffi aussi. Voyager d'une seconde à la seconde suivante : ça marche encore. Robert Altman a bien réalisé tout un film sur un type qui arrête de fumer, alors... Il y a des morts, son meilleur ami disparaît, un écrivain meurt, le meilleur ami n'est peut-être pas mort, tout le monde trahit tout le monde : Philip Marlowe traverse les épreuves comme autant d'étapes vers son arrêt de la clope. Le dernier plan du film est donc aussi le premier où il ne fume pas. Il marche, libéré de tous ceux qui l'ont trahi. Il a voyagé, il est passé par toutes les transformations nécessaires, exactement comme Zach Condon termine son périple vidéo à l'église, parmi les chants. Dans le film d'Altman (Le Privé, en VF), ce que j'appelle ici le « voyage » est symbolisé par la musique : une seule chanson compose la bande (très) originale du film. Théorie de la pop à elle seule, elle se décline sur tous les modes, selon tous les genres musicaux : air fredonné, mélodie de piano-bar, chant langoureux, mariachis d'un enterrement mexicain (le bout d'un voyage). C'est le voyage du thème. C'est le voyage du même. Bien sûr, en VO, ce film de Robert Altman s'intitule The Long Goodbye. Quatre. François Matton me disait le 31 août 2006, dans un e-mail, n'avoir jamais oublié une parole du poète Joseph Mouton, à propos de la création artistique, qu'il résumait ainsi : « "Il faut que ça déconne un peu" (>lâcher-prise) et : "Il n'y a pas d'oeuvre sans une très forte politique de présentation" (>maîtrise et conscience des moyens mis en oeuvre). Ces deux réflexions forment une sorte de koan. » Dans The Long Goodbye (le disque pop), la forte politique de présentation tient à l'inscription dans un quartier, redoublée par une géographie imaginaire (le groupe appartient au collectif Elephant Six). Examinons plutôt le lâcher-prise. On ne le trouvera guère sur scène - les vidéos attestent d'un groupe sans grande dimension visuelle -, mais en amont, dans la pré-écriture, pendant le sommeil peut-être, quand ont surgi les mélodies. Il y a dans Old Dominion, par exemple, des accents d'improvisation enfantine, laissée en l'état, juste arrangée autour pour que cela fonctionne en tant que chanson. Tout le talent tient dans le fait de n'avoir retravaillé que le contexte, sans toucher au corps originel (mais sans se contenter de celui-ci non plus). Un jet d'inconscient, maintenu tel quel au cœur même d'un processus d'écriture, donc de réécriture : le programme du « voyage » est de rester intact. De l'autre côté de la vitre, le paysage change, les voix (féminin / masculin), comme l'instrument-vedette (un seul à la fois, et les autres accompagnent). Le disque prend bientôt la belle unité d'une mosaïque. Un jeu sur le vide et le plein procure ces micro-vertiges qu'on éprouve à passer, à pleine vitesse, à ski par exemple, sur quelque chose de mal défini ; le temps de se poser la question, et l'inconnu est déjà derrière soi. Cinq. The Essex Green ignore l'histoire de la musique après 1969, lit-on partout. C'est bien sûr faux. Leur façon de faire s'apparente plutôt à la seconde vague pop, celle des années 80, des Go-Betweens. Et encore, dans un contexte tellement différent, que l'ensemble du message s'en trouve modifié. Mieux vaut parler de troisième vague, une tous les vingt ans. Certes, lorsqu'ils citent la pop originelle, ils le font sans déguisement apparent du son, sans traitement, et parfois même à l'identique, encourant ainsi le soupçon d'absence d'originalité. Un fragment du passé, un bout de solo, un gimmick, une lubie qu'a eue George Harrison à un moment de sa vie, se retrouve à voyager jusqu'à nous. Mais The Essex Green n'est pas Goldfrapp : l'originalité n'est pas son argument de vente, plutôt sa vérité cachée ; un saupoudrage d'électronique ne vient pas masquer un emprunt mélodique, non : c'est la mélodie même, au cœur même d'un vrai-faux processus de citation, qui à un moment donné, un moment fou, va se décoller légèrement du modèle. Un gouffre s'ouvre. Un vertige, sans commune mesure avec le caractère infime du décalage, nous saisit.
Magazine Culture
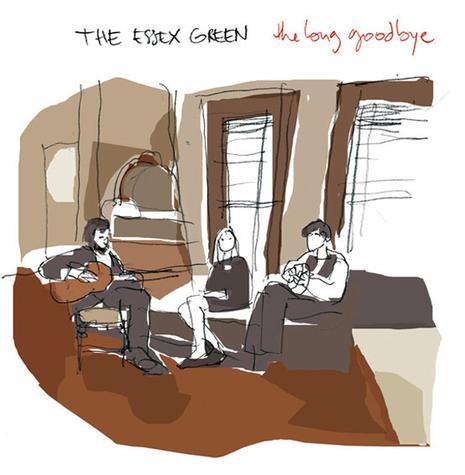 The Long Goodbye vu par François Matton (blog ici) Un. Je suis à Amsterdam, chez Henk Hofstede, des Nits. Le thé noir aux épices de Henk est encore chaud et nous soufflons-grimaçons en portant le mug fumant à nos lèvres. Par moments, Henk sourit en direction de la fenêtre tout en se caressant l'avant-bras. Entre nous, sur la table de la cuisine, un petit système audio portatif, qui se déplie : j'ai amené l'album The Long Goodbye de The Essex Green, afin de lui faire écouter Lazy May. Aux premières mesures de la chanson (batterie un peu enroulée, gentille, guitare « ligne claire » répartissant dans l'espace le strict nécessaire à la recomposition d'une courbe), le coin très dessiné des yeux de Henk m'impressionne, alors qu'il porte sur moi un regard indécidable. Je me demande même un instant si je n'ai pas commis un impair. A l'apparition de la voix, troisième élément « nitséen », enfin l'homme sourit, quelque chose en lui vient de céder. OK, on dirait une chanson à moi. Sur le live de 1989 elle aurait eu de la gueule. D'accord. Il se pianote un bout de rythme, presque trop rapide, sur l'avant-bras. C'est réglé dans son esprit. Pourtant, la tension en moi est intacte ; j'attends le refrain. Arrive le refrain. And I - I love you And I - I love you Oh-oh my lazy May C'est triomphant et retenu à la fois. Le sentiment ne doit pas s'être ancré depuis très longtemps dans le cœur de celui qui le chante ainsi. Peut-être même l'homme le chante-t-il en même temps qu'il le découvre en lui. Ou bien ses souvenirs sont intacts. Ou bien l'écriture lui a rendu ses souvenirs. Et cela change tout dans la cuisine. Henk va chialer, je me dis, à un moment. Oh, des chansons, il en a eu de plus belles, il n'est pas question de compétition ou d'ego quand on a écrit Apple Orchard. C'est juste que celle-ci, il la cherche depuis des années pour terminer ses concerts. En effet, sur scène, depuis toujours, Henk semble s'excuser d'avoir consacré sa vie à l'écriture. Il veut prouver qu'on s'amuse, que c'est populaire, son côté chanson de marin se réveille. Avec Lazy May, il aurait tenu les deux : la lumière intérieure et le sentiment du groupe ; l'impartageable et le commun. Deux. J'écris avec des rires et des bruits de jeux dans la chambre d'à côté : ma fille de quatre ans reçoit une petite copine. Sur le site Web de The Essex Green, ils annoncent une naissance : « Voici le nouveau membre de The Essex Green. » C'est très bête. Mais cela fait sens. Tout monte d'un cran dans l'intime : les fans sont traités en amis, à qui l'on se doit d'annoncer la nouvelle ; les amis musiciens deviennent famille. Le nœud de vipères des liens du sang dont parlait Crevel est ici tout de suite dénoué, au profit d'un rapport électif, fondé sur le partage, la musique, la culture, le projet de vivre en intelligence. The Essex Green, c'est de la pop de la vie quotidienne. Ce fabuleux non-événement : une naissance, s'inscrit tout de suite dans le plan collectif. Et le lieu où elle survient n'est pas sans importance : Brooklyn, où trois des quatre membres du groupe Guppyboy sont venus s'installer, en 1997, depuis Burlington (Vermont) - le trio d'amis se renommant alors The Essex Green, et deux d'entre eux s'investissant parallèlement avec The Ladybug Transistor. A Brooklyn, on ne compte plus les groupes : Ladybug donc, Beirut jusqu'à récemment, Grizzly Bear, Les Savy Fav... Avant de s'installer à Paris, Zach Condon, de Beirut, a réalisé là une série de vidéos (une par chanson de son dernier album, The Flying Club Cup) où la musique investit sans distinction des espaces publics et privés. L'on y voit le groupe en petite fanfare, voyager de rue en rue, d'appartement en loft, d'escalier commun à cour d'immeubles en brique, sous un soleil égal. Le chanteur de Grizzly Bear participe en voisin. Ou bien ce sont les autres qui sont venus chez lui. Trois. Voyager du Vermont à Brooklyn : cela suffirait à expliquer le titre de cet album de 2003, The Long Goodbye. Voyager d'un point de Brooklyn à un autre : cela aurait suffi aussi. Voyager d'une seconde à la seconde suivante : ça marche encore. Robert Altman a bien réalisé tout un film sur un type qui arrête de fumer, alors... Il y a des morts, son meilleur ami disparaît, un écrivain meurt, le meilleur ami n'est peut-être pas mort, tout le monde trahit tout le monde : Philip Marlowe traverse les épreuves comme autant d'étapes vers son arrêt de la clope. Le dernier plan du film est donc aussi le premier où il ne fume pas. Il marche, libéré de tous ceux qui l'ont trahi. Il a voyagé, il est passé par toutes les transformations nécessaires, exactement comme Zach Condon termine son périple vidéo à l'église, parmi les chants. Dans le film d'Altman (Le Privé, en VF), ce que j'appelle ici le « voyage » est symbolisé par la musique : une seule chanson compose la bande (très) originale du film. Théorie de la pop à elle seule, elle se décline sur tous les modes, selon tous les genres musicaux : air fredonné, mélodie de piano-bar, chant langoureux, mariachis d'un enterrement mexicain (le bout d'un voyage). C'est le voyage du thème. C'est le voyage du même. Bien sûr, en VO, ce film de Robert Altman s'intitule The Long Goodbye. Quatre. François Matton me disait le 31 août 2006, dans un e-mail, n'avoir jamais oublié une parole du poète Joseph Mouton, à propos de la création artistique, qu'il résumait ainsi : « "Il faut que ça déconne un peu" (>lâcher-prise) et : "Il n'y a pas d'oeuvre sans une très forte politique de présentation" (>maîtrise et conscience des moyens mis en oeuvre). Ces deux réflexions forment une sorte de koan. » Dans The Long Goodbye (le disque pop), la forte politique de présentation tient à l'inscription dans un quartier, redoublée par une géographie imaginaire (le groupe appartient au collectif Elephant Six). Examinons plutôt le lâcher-prise. On ne le trouvera guère sur scène - les vidéos attestent d'un groupe sans grande dimension visuelle -, mais en amont, dans la pré-écriture, pendant le sommeil peut-être, quand ont surgi les mélodies. Il y a dans Old Dominion, par exemple, des accents d'improvisation enfantine, laissée en l'état, juste arrangée autour pour que cela fonctionne en tant que chanson. Tout le talent tient dans le fait de n'avoir retravaillé que le contexte, sans toucher au corps originel (mais sans se contenter de celui-ci non plus). Un jet d'inconscient, maintenu tel quel au cœur même d'un processus d'écriture, donc de réécriture : le programme du « voyage » est de rester intact. De l'autre côté de la vitre, le paysage change, les voix (féminin / masculin), comme l'instrument-vedette (un seul à la fois, et les autres accompagnent). Le disque prend bientôt la belle unité d'une mosaïque. Un jeu sur le vide et le plein procure ces micro-vertiges qu'on éprouve à passer, à pleine vitesse, à ski par exemple, sur quelque chose de mal défini ; le temps de se poser la question, et l'inconnu est déjà derrière soi. Cinq. The Essex Green ignore l'histoire de la musique après 1969, lit-on partout. C'est bien sûr faux. Leur façon de faire s'apparente plutôt à la seconde vague pop, celle des années 80, des Go-Betweens. Et encore, dans un contexte tellement différent, que l'ensemble du message s'en trouve modifié. Mieux vaut parler de troisième vague, une tous les vingt ans. Certes, lorsqu'ils citent la pop originelle, ils le font sans déguisement apparent du son, sans traitement, et parfois même à l'identique, encourant ainsi le soupçon d'absence d'originalité. Un fragment du passé, un bout de solo, un gimmick, une lubie qu'a eue George Harrison à un moment de sa vie, se retrouve à voyager jusqu'à nous. Mais The Essex Green n'est pas Goldfrapp : l'originalité n'est pas son argument de vente, plutôt sa vérité cachée ; un saupoudrage d'électronique ne vient pas masquer un emprunt mélodique, non : c'est la mélodie même, au cœur même d'un vrai-faux processus de citation, qui à un moment donné, un moment fou, va se décoller légèrement du modèle. Un gouffre s'ouvre. Un vertige, sans commune mesure avec le caractère infime du décalage, nous saisit.
The Long Goodbye vu par François Matton (blog ici) Un. Je suis à Amsterdam, chez Henk Hofstede, des Nits. Le thé noir aux épices de Henk est encore chaud et nous soufflons-grimaçons en portant le mug fumant à nos lèvres. Par moments, Henk sourit en direction de la fenêtre tout en se caressant l'avant-bras. Entre nous, sur la table de la cuisine, un petit système audio portatif, qui se déplie : j'ai amené l'album The Long Goodbye de The Essex Green, afin de lui faire écouter Lazy May. Aux premières mesures de la chanson (batterie un peu enroulée, gentille, guitare « ligne claire » répartissant dans l'espace le strict nécessaire à la recomposition d'une courbe), le coin très dessiné des yeux de Henk m'impressionne, alors qu'il porte sur moi un regard indécidable. Je me demande même un instant si je n'ai pas commis un impair. A l'apparition de la voix, troisième élément « nitséen », enfin l'homme sourit, quelque chose en lui vient de céder. OK, on dirait une chanson à moi. Sur le live de 1989 elle aurait eu de la gueule. D'accord. Il se pianote un bout de rythme, presque trop rapide, sur l'avant-bras. C'est réglé dans son esprit. Pourtant, la tension en moi est intacte ; j'attends le refrain. Arrive le refrain. And I - I love you And I - I love you Oh-oh my lazy May C'est triomphant et retenu à la fois. Le sentiment ne doit pas s'être ancré depuis très longtemps dans le cœur de celui qui le chante ainsi. Peut-être même l'homme le chante-t-il en même temps qu'il le découvre en lui. Ou bien ses souvenirs sont intacts. Ou bien l'écriture lui a rendu ses souvenirs. Et cela change tout dans la cuisine. Henk va chialer, je me dis, à un moment. Oh, des chansons, il en a eu de plus belles, il n'est pas question de compétition ou d'ego quand on a écrit Apple Orchard. C'est juste que celle-ci, il la cherche depuis des années pour terminer ses concerts. En effet, sur scène, depuis toujours, Henk semble s'excuser d'avoir consacré sa vie à l'écriture. Il veut prouver qu'on s'amuse, que c'est populaire, son côté chanson de marin se réveille. Avec Lazy May, il aurait tenu les deux : la lumière intérieure et le sentiment du groupe ; l'impartageable et le commun. Deux. J'écris avec des rires et des bruits de jeux dans la chambre d'à côté : ma fille de quatre ans reçoit une petite copine. Sur le site Web de The Essex Green, ils annoncent une naissance : « Voici le nouveau membre de The Essex Green. » C'est très bête. Mais cela fait sens. Tout monte d'un cran dans l'intime : les fans sont traités en amis, à qui l'on se doit d'annoncer la nouvelle ; les amis musiciens deviennent famille. Le nœud de vipères des liens du sang dont parlait Crevel est ici tout de suite dénoué, au profit d'un rapport électif, fondé sur le partage, la musique, la culture, le projet de vivre en intelligence. The Essex Green, c'est de la pop de la vie quotidienne. Ce fabuleux non-événement : une naissance, s'inscrit tout de suite dans le plan collectif. Et le lieu où elle survient n'est pas sans importance : Brooklyn, où trois des quatre membres du groupe Guppyboy sont venus s'installer, en 1997, depuis Burlington (Vermont) - le trio d'amis se renommant alors The Essex Green, et deux d'entre eux s'investissant parallèlement avec The Ladybug Transistor. A Brooklyn, on ne compte plus les groupes : Ladybug donc, Beirut jusqu'à récemment, Grizzly Bear, Les Savy Fav... Avant de s'installer à Paris, Zach Condon, de Beirut, a réalisé là une série de vidéos (une par chanson de son dernier album, The Flying Club Cup) où la musique investit sans distinction des espaces publics et privés. L'on y voit le groupe en petite fanfare, voyager de rue en rue, d'appartement en loft, d'escalier commun à cour d'immeubles en brique, sous un soleil égal. Le chanteur de Grizzly Bear participe en voisin. Ou bien ce sont les autres qui sont venus chez lui. Trois. Voyager du Vermont à Brooklyn : cela suffirait à expliquer le titre de cet album de 2003, The Long Goodbye. Voyager d'un point de Brooklyn à un autre : cela aurait suffi aussi. Voyager d'une seconde à la seconde suivante : ça marche encore. Robert Altman a bien réalisé tout un film sur un type qui arrête de fumer, alors... Il y a des morts, son meilleur ami disparaît, un écrivain meurt, le meilleur ami n'est peut-être pas mort, tout le monde trahit tout le monde : Philip Marlowe traverse les épreuves comme autant d'étapes vers son arrêt de la clope. Le dernier plan du film est donc aussi le premier où il ne fume pas. Il marche, libéré de tous ceux qui l'ont trahi. Il a voyagé, il est passé par toutes les transformations nécessaires, exactement comme Zach Condon termine son périple vidéo à l'église, parmi les chants. Dans le film d'Altman (Le Privé, en VF), ce que j'appelle ici le « voyage » est symbolisé par la musique : une seule chanson compose la bande (très) originale du film. Théorie de la pop à elle seule, elle se décline sur tous les modes, selon tous les genres musicaux : air fredonné, mélodie de piano-bar, chant langoureux, mariachis d'un enterrement mexicain (le bout d'un voyage). C'est le voyage du thème. C'est le voyage du même. Bien sûr, en VO, ce film de Robert Altman s'intitule The Long Goodbye. Quatre. François Matton me disait le 31 août 2006, dans un e-mail, n'avoir jamais oublié une parole du poète Joseph Mouton, à propos de la création artistique, qu'il résumait ainsi : « "Il faut que ça déconne un peu" (>lâcher-prise) et : "Il n'y a pas d'oeuvre sans une très forte politique de présentation" (>maîtrise et conscience des moyens mis en oeuvre). Ces deux réflexions forment une sorte de koan. » Dans The Long Goodbye (le disque pop), la forte politique de présentation tient à l'inscription dans un quartier, redoublée par une géographie imaginaire (le groupe appartient au collectif Elephant Six). Examinons plutôt le lâcher-prise. On ne le trouvera guère sur scène - les vidéos attestent d'un groupe sans grande dimension visuelle -, mais en amont, dans la pré-écriture, pendant le sommeil peut-être, quand ont surgi les mélodies. Il y a dans Old Dominion, par exemple, des accents d'improvisation enfantine, laissée en l'état, juste arrangée autour pour que cela fonctionne en tant que chanson. Tout le talent tient dans le fait de n'avoir retravaillé que le contexte, sans toucher au corps originel (mais sans se contenter de celui-ci non plus). Un jet d'inconscient, maintenu tel quel au cœur même d'un processus d'écriture, donc de réécriture : le programme du « voyage » est de rester intact. De l'autre côté de la vitre, le paysage change, les voix (féminin / masculin), comme l'instrument-vedette (un seul à la fois, et les autres accompagnent). Le disque prend bientôt la belle unité d'une mosaïque. Un jeu sur le vide et le plein procure ces micro-vertiges qu'on éprouve à passer, à pleine vitesse, à ski par exemple, sur quelque chose de mal défini ; le temps de se poser la question, et l'inconnu est déjà derrière soi. Cinq. The Essex Green ignore l'histoire de la musique après 1969, lit-on partout. C'est bien sûr faux. Leur façon de faire s'apparente plutôt à la seconde vague pop, celle des années 80, des Go-Betweens. Et encore, dans un contexte tellement différent, que l'ensemble du message s'en trouve modifié. Mieux vaut parler de troisième vague, une tous les vingt ans. Certes, lorsqu'ils citent la pop originelle, ils le font sans déguisement apparent du son, sans traitement, et parfois même à l'identique, encourant ainsi le soupçon d'absence d'originalité. Un fragment du passé, un bout de solo, un gimmick, une lubie qu'a eue George Harrison à un moment de sa vie, se retrouve à voyager jusqu'à nous. Mais The Essex Green n'est pas Goldfrapp : l'originalité n'est pas son argument de vente, plutôt sa vérité cachée ; un saupoudrage d'électronique ne vient pas masquer un emprunt mélodique, non : c'est la mélodie même, au cœur même d'un vrai-faux processus de citation, qui à un moment donné, un moment fou, va se décoller légèrement du modèle. Un gouffre s'ouvre. Un vertige, sans commune mesure avec le caractère infime du décalage, nous saisit.
