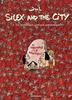Très vite, la nuit s’était épaissie au-dessus de la verrière.
Il semble que Jacques Ferrandez ait évité de donner une couleur au ciel. Tout a pris naissance depuis le sol. La rudesse des bâtiments et des arcades érigés, le vide d’une plage, d’une plaine. Et des voitures rouges, jaunes et vertes, traversant des ponts jusqu’à la mer. Se formant depuis le sol, aussi, quelques visages humides et simples, qui parfois se parlent puis se répondent. Mais du ciel, aucun mouvement, pas même une once de pâleur, comme si le soleil l’avait depuis longtemps éteint, effacé et tenu à l’écart. De côté.
À distance de soi. Étranger pour soi. Pas même un prénom rendu, au fil des pages, au fil d’une marche tournant en rond. Alors Jacques Ferrandez a dessiné une ville, un décor, et a placé dans ses cadres la figure d’un homme de côté, qui longerait une plage, tournant le dos à son ombre et scrutant l’absence d’un ciel. C’est le dessin d’un homme qui s’endort dans un bus, qui s’endort indifféremment, partout comme nulle part.
Il y a bien sûr cet incipit, ces minces phrases que l’on croit connaître par cœur, cette parole scandée, englobée ici dans la puissance d’un rêve, et ses cases qui défilent aussi vite que le flot des mots. Aujourd’hui, maman est morte… Ou peut-être hier, je ne sais pas. Ferrandez ajoute au texte de Camus une suspension, car il représente l’homme en train de se remémorer. Avec des yeux fermés sur ce qui est à peine prononcé, comme si tout en les disant, il venait asséner le langage et l’évocation. L’homme s’introduit comme venant de loin. Et on le sait également loin de lui-même.
Peu après, le ciel s’est assombri et j’ai cru que nous allions avoir un orage d’été. Il s’est découvert peu à peu cependant. Mais le passage des nuées avait laissé sur la rue comme une promesse de pluie qui l’a rendue plus sombre.
Alger est peinte comme une phrase écrite, en écho au performatif implacable du texte d’Albert Camus, qui fuit le mensonge comme son personnage principal. Sur cette scène baignée d’un trop plein de soleil, il y va d’un aveuglement plus que d’un éblouissement. Partout, elle tient Meursault à distance, en spectateur. Sur la plage, sur les épais trottoirs, à l’enterrement, suivant le cortège, au procès, dans les bras d’une femme, dans l’obscurité d’une salle de cinéma : il est face aux autres, à ces figures tantôt claires tantôt grisées – lui et les perles à son front. Lui qui avance claudiquant, l’insensibilité dans une paume trop fermée et chacun de ses pas prenant le risque de l’insolation.
Ferrandez accompagne chaque ligne du roman mais prend le soin de ne pas y ajouter un mot de plus – qui serait alors un mot de trop. Aussi l’incernable du personnage est-il respecté, comme ce lendemain des retrouvailles avec Marie, lorsque Meursault sent l’oreiller pour y détecter une présence féminine, puis s’ennuie, cigarettes après cigarettes, de dix heures à midi, se prépare à manger sans faim, sans même s’encombrer d’une assiette, avant de scruter la capitale depuis sa fenêtre.
L’auteur offre une illustration à la lettre près, avec ci-et-là des touches personnelles – le magasin de chaussures Roig que Meursault aperçoit depuis son appartement appartient au souvenir familial de Ferrand et, plus loin, un homme aux traits de Faulkner, et encore un autre au profil de Sartre – comme autant de clins d’œil de Ferrand à Camus.
De relief, il n’en est pas non plus question : l’album a le charme du linéaire, dans la première partie surtout, offrant à certaines planches toute l’étendue du corps de la mer, les longs chemins des rails de tramways, le regard surplombant la ville qui s’étale secondant un horizon. Aucun relief, ni dans les cases, ni dans l’action. L’acmé promise, en plein cœur du récit, annule tout dialogue, et a la brièveté et l’éclat d’un coup de fusil. Mais le drame arrive néanmoins, et chez Camus également, où la scène flirterait avec le non-événement, si ce n’était les dernières phrases avant le procès, qui sont parmi les seules à accueillir quelques pointes de lyrisme, et des métaphores.
Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jailli du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C’est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m’a semblé que le ciel s’ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. (…) c’était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur.
À cet instant précis, dans l’album, en lieu et place de la métaphore, Jacques Ferrandez accable le visage de Meursault du feu du soleil, jusqu’à les confondre tout à fait, liquéfiant le personnage, accueillant l’aveuglement ultime, immédiatement réduit au decrescendo d’une intonation de balles qui s’épuise.
Il s’est tu, m’a regardé et s’est redressé brusquement pour me dire très vite : « Ce qui m’intéresse, c’est vous. » Je n’ai pas bien compris ce qu’il entendait par là et je n’ai rien répondu.
La suite, c’est la nuit qui tombe et le règne de l’impersonnel, à l’image de ce chiasme destructeur mettant le pronom « ce » et le pronom « vous » en miroir. Le contraignant à l’enfermement, dans une geôle à la fenêtre barrée ou dans la salle du procès. On demande à Meursault de parler ; mais pour celui qui dans l’indifférence prononce « Je ne t’aime pas » comme il dirait « J’ai faim » ou « Tu es jolie », rien n’a d’importance. On lui demande de s’interroger, de fournir une raison à son geste ; mais pour celui qui prône l’averbal et la négation, l’explication, par la phrase déliée, demeure impossible.
Il lui faut alors tuer le temps, et dormir, plus que jamais, durant des mois reclus dans une nouvelle vie cellulaire – qui ressemble tant à la première vie, paraissant même l’actualiser. Ferrandez fait le choix de l’ombre, et de la respiration dans l’ombre : au procès, qui se déroule dans toute la seconde partie, il farde Meursault de traits expressionnistes – comme s’il trouvait là le seul moyen de le faire parler enfin – et laisse parfois quelques rayons pénétrer la grande pièce, apportant un peu de lumière sur le crâne de cet Antéchrist, faisant briller le bois de l’auditoire.
Mais, peu à peu, l’aquarelle vient noyer les visages et les décors. Hors des murs de la prison, le port d’Alger ne se dessine plus qu’en traits, qu’en impressions, et, entre les murs, les contours du parterre s’effacent. Jusqu’à des cases noires, jusqu’à l’apparition fantomatique de la mère, jusqu’à la préfiguration de l’outil de la mort. Et c’est à cet instant, seulement celui-là, que Jacques Ferrandez a enfin donné une couleur au ciel.