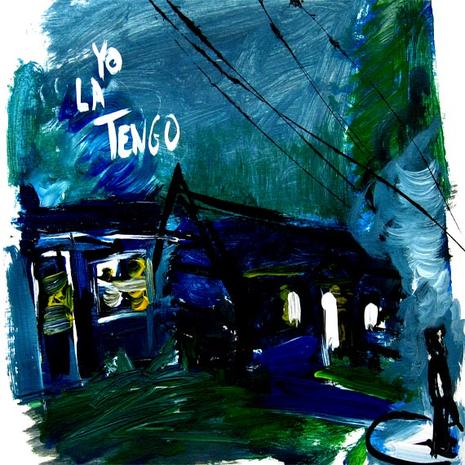 And Then Nothing Turned Itself Inside-Out, vu par Youri Gralak
C'est un disque qui commence par la fin, enfin par une possible fin. Une longue introduction lente, répétitive comme un mantra, laisse poindre sous l'apparente routine un truc qui fait
masse. Everyday donc, la première chanson, donne l'illusion d'une machine bien rodée mais viciée, que l'usure du quotidien aurait finit par rendre un peu folle, au point de dessiner
des cercles concentriques, comme cet homme et sa tondeuse sur la photographie intérieure de la pochette. Sans souci autobiographique ni chronologique, le trio Yo La Tengo (qui n'a d'exotique
que le nom) va évoquer ici, dans le désordre, quelques fragments de la vie amoureuse : lassitude, approche, désir, distance.
La nuit tombe sur Hoboken indique le titre final, long à l'infini, à l'épuisement. Voilà où nous sommes, à Hoboken, dans le New Jersey, sur la West Bank de l'Hudson River, et
sur la rive d'en face, c'est Manhattan. Ce n'est donc pas tout à fait New York, mais une ville où subsiste sûrement encore l'image d'Épinal d'une Amérique blanche middle class vivant
dans des banlieues pavillonnaires, où les gens ont tout le loisir d'arroser leur voiture, garer leur poubelle, tondre leur chien.
Mari et femme. Ira Kaplan, aux chant-guitare-claviers, et Georgia Hubley, qui chante elle aussi et joue de la batterie (essentiellement aux balais sur ce disque), sont ensemble dans la
vie. James McNew, le bassiste nounours et poupon, a le profil type du bon copain jovial qui viendrait partager notre repas le dimanche, et nos scènes de ménages, nos confidences. La complicité
du couple Kaplan/Hubley bruisse tout du long. Leurs voix susurrées s'alternent, se répondent, se confondent parfois même dans leur tessiture. Comme deux visages auxquels le nombre d'années
passées ensemble aurait fini par donner un air de famille asexué, en en brouillant les polarités. Depuis ma découverte d'une possible complémentarité du couple dans l'art au travers des films
documentaires de Johan van der Keuken et de sa femme Noshka, qui en poursuivait l'œuvre par le montage, l'idée me fascine. Je la retrouve ici.
Un disque pour faire l'amour. C'est idiot je sais, mais je suis un adepte des questions triviales, et j'aimerais bien qu'on me pose celle-là un jour, et ton disque à toi alors ?
Pendant longtemps, je n'aurais pas su quoi répondre, possiblement du fait d'une vie sexuelle un peu pauvre, pas assez entraînée musicalement pour m'accorder comme tout le monde sur The Very
Best of Marvin Gaye. Healing is not something good for me je suppose. Aujourd'hui moi-même redevenu torride comme l'autre Tellier, j'ai récemment pris le risque de glisser ce disque.
Le moment de la jouissance est tout relatif, selon que l'on pratique ou non le tantrisme, comme le chanteur Sting et son épouse Trudie. En tout cas, And then nothing turned itself
inside-out de Yo La Tengo serait pour l'heure ma réponse à la question.
Our Way To Fall. L'orgue Farfisa est beau à pleurer sur le deuxième morceau de l'album. Il dit l'ambivalence du titre : notre façon de tomber amoureux, notre
chemin vers la chute. Dans les deux cas, on tombe, on dégringole, on regarde nos pieds, on se remémore nos premiers émois dans la tranquillité.
I remember a summer's day
I remember walking up to you
I remember my face turned red
And I remember staring at my feet
L'orgue joué par effet de glissando, soit un glissement continu d'une note à une autre, est l'exacte antithèse de la technicité exhibée par les jazzmen ou les métalleux. Ainsi, malgré une
virtuosité au ras des pâquerettes, cet orgue traduit l'émotion à ciel ouvert.
From Black to Blue. Ce sont les couleurs du disque et ce sont ses humeurs. La nuit tombe infiniment sur Hoboken et à force de noir, on finit par y voir du bleu. Bleu nuit. C'est la
teinte ouverte à toutes les audaces, la porte entrebâillée sur l'extérieur au dos de la jaquette.
Paris, Square Berlioz - dimanche 20 avril, 15h38. Tandis que je planche sur le présent texte, je fais glisser mes sunglasses sur mon nez pour y regarder à deux, trois
fois, mais non, malgré ma nuit blanche et mon manque de sommeil je ne rêve pas, c'est bien la grande silhouette dégingandée de Jarvis Cocker (ndlr chanteur du célèbre groupe pop anglais
Pulp) que j'aperçois là-bas à, quoi , quinze, vingt mètres de moi, j'en suis certain, je reconnais bien sa touche british, veste en velours avec coudières, étriquée juste ce
qu'il faut, pantalon feu de plancher, lunettes de vue aux verres fumés, chaussures que l'on jurerait taillées pour le bowling et le cheveu, comme à son habitude, pop et un peu gras. Puis le
maillot de football de son fiston ne trompe pas : un numéro 10 coiffé du nom Cocker - je suis à l'instant où j'écris interrompu par le ballon qui m'arrive dessus, et moi de le stopper
net et de me lever machinalement comme un zombi dans un film de George A. Romero pour le shooter avec une adresse que je ne me connaissais pas, pile dans la direction de Jarvis qui me remercie
d'un signe de main. Je me dis qu'après tout j'ai bien fait de sortir de chez moi, des idoles pop gravitent en bas dans le jardin. Et le square ne cesse de se remplir de poussettes, des
enfants en pagaille s'agitent en tout sens, un vrai baby-boom bobo en fait. Et si tous ces couples avaient finalement un peu trop écouté l'album de YLT au début du nouveau millénaire ?
And Then Nothing Turned Itself Inside-Out, vu par Youri Gralak
C'est un disque qui commence par la fin, enfin par une possible fin. Une longue introduction lente, répétitive comme un mantra, laisse poindre sous l'apparente routine un truc qui fait
masse. Everyday donc, la première chanson, donne l'illusion d'une machine bien rodée mais viciée, que l'usure du quotidien aurait finit par rendre un peu folle, au point de dessiner
des cercles concentriques, comme cet homme et sa tondeuse sur la photographie intérieure de la pochette. Sans souci autobiographique ni chronologique, le trio Yo La Tengo (qui n'a d'exotique
que le nom) va évoquer ici, dans le désordre, quelques fragments de la vie amoureuse : lassitude, approche, désir, distance.
La nuit tombe sur Hoboken indique le titre final, long à l'infini, à l'épuisement. Voilà où nous sommes, à Hoboken, dans le New Jersey, sur la West Bank de l'Hudson River, et
sur la rive d'en face, c'est Manhattan. Ce n'est donc pas tout à fait New York, mais une ville où subsiste sûrement encore l'image d'Épinal d'une Amérique blanche middle class vivant
dans des banlieues pavillonnaires, où les gens ont tout le loisir d'arroser leur voiture, garer leur poubelle, tondre leur chien.
Mari et femme. Ira Kaplan, aux chant-guitare-claviers, et Georgia Hubley, qui chante elle aussi et joue de la batterie (essentiellement aux balais sur ce disque), sont ensemble dans la
vie. James McNew, le bassiste nounours et poupon, a le profil type du bon copain jovial qui viendrait partager notre repas le dimanche, et nos scènes de ménages, nos confidences. La complicité
du couple Kaplan/Hubley bruisse tout du long. Leurs voix susurrées s'alternent, se répondent, se confondent parfois même dans leur tessiture. Comme deux visages auxquels le nombre d'années
passées ensemble aurait fini par donner un air de famille asexué, en en brouillant les polarités. Depuis ma découverte d'une possible complémentarité du couple dans l'art au travers des films
documentaires de Johan van der Keuken et de sa femme Noshka, qui en poursuivait l'œuvre par le montage, l'idée me fascine. Je la retrouve ici.
Un disque pour faire l'amour. C'est idiot je sais, mais je suis un adepte des questions triviales, et j'aimerais bien qu'on me pose celle-là un jour, et ton disque à toi alors ?
Pendant longtemps, je n'aurais pas su quoi répondre, possiblement du fait d'une vie sexuelle un peu pauvre, pas assez entraînée musicalement pour m'accorder comme tout le monde sur The Very
Best of Marvin Gaye. Healing is not something good for me je suppose. Aujourd'hui moi-même redevenu torride comme l'autre Tellier, j'ai récemment pris le risque de glisser ce disque.
Le moment de la jouissance est tout relatif, selon que l'on pratique ou non le tantrisme, comme le chanteur Sting et son épouse Trudie. En tout cas, And then nothing turned itself
inside-out de Yo La Tengo serait pour l'heure ma réponse à la question.
Our Way To Fall. L'orgue Farfisa est beau à pleurer sur le deuxième morceau de l'album. Il dit l'ambivalence du titre : notre façon de tomber amoureux, notre
chemin vers la chute. Dans les deux cas, on tombe, on dégringole, on regarde nos pieds, on se remémore nos premiers émois dans la tranquillité.
I remember a summer's day
I remember walking up to you
I remember my face turned red
And I remember staring at my feet
L'orgue joué par effet de glissando, soit un glissement continu d'une note à une autre, est l'exacte antithèse de la technicité exhibée par les jazzmen ou les métalleux. Ainsi, malgré une
virtuosité au ras des pâquerettes, cet orgue traduit l'émotion à ciel ouvert.
From Black to Blue. Ce sont les couleurs du disque et ce sont ses humeurs. La nuit tombe infiniment sur Hoboken et à force de noir, on finit par y voir du bleu. Bleu nuit. C'est la
teinte ouverte à toutes les audaces, la porte entrebâillée sur l'extérieur au dos de la jaquette.
Paris, Square Berlioz - dimanche 20 avril, 15h38. Tandis que je planche sur le présent texte, je fais glisser mes sunglasses sur mon nez pour y regarder à deux, trois
fois, mais non, malgré ma nuit blanche et mon manque de sommeil je ne rêve pas, c'est bien la grande silhouette dégingandée de Jarvis Cocker (ndlr chanteur du célèbre groupe pop anglais
Pulp) que j'aperçois là-bas à, quoi , quinze, vingt mètres de moi, j'en suis certain, je reconnais bien sa touche british, veste en velours avec coudières, étriquée juste ce
qu'il faut, pantalon feu de plancher, lunettes de vue aux verres fumés, chaussures que l'on jurerait taillées pour le bowling et le cheveu, comme à son habitude, pop et un peu gras. Puis le
maillot de football de son fiston ne trompe pas : un numéro 10 coiffé du nom Cocker - je suis à l'instant où j'écris interrompu par le ballon qui m'arrive dessus, et moi de le stopper
net et de me lever machinalement comme un zombi dans un film de George A. Romero pour le shooter avec une adresse que je ne me connaissais pas, pile dans la direction de Jarvis qui me remercie
d'un signe de main. Je me dis qu'après tout j'ai bien fait de sortir de chez moi, des idoles pop gravitent en bas dans le jardin. Et le square ne cesse de se remplir de poussettes, des
enfants en pagaille s'agitent en tout sens, un vrai baby-boom bobo en fait. Et si tous ces couples avaient finalement un peu trop écouté l'album de YLT au début du nouveau millénaire ?
Magazine Culture
Jour 24, Guillaume : YO LA TENGO, And then nothing turned itself inside-out (2000)
Publié le 21 avril 2008 par Oagd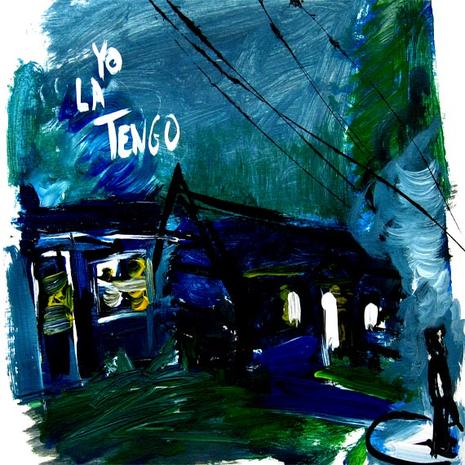 And Then Nothing Turned Itself Inside-Out, vu par Youri Gralak
C'est un disque qui commence par la fin, enfin par une possible fin. Une longue introduction lente, répétitive comme un mantra, laisse poindre sous l'apparente routine un truc qui fait
masse. Everyday donc, la première chanson, donne l'illusion d'une machine bien rodée mais viciée, que l'usure du quotidien aurait finit par rendre un peu folle, au point de dessiner
des cercles concentriques, comme cet homme et sa tondeuse sur la photographie intérieure de la pochette. Sans souci autobiographique ni chronologique, le trio Yo La Tengo (qui n'a d'exotique
que le nom) va évoquer ici, dans le désordre, quelques fragments de la vie amoureuse : lassitude, approche, désir, distance.
La nuit tombe sur Hoboken indique le titre final, long à l'infini, à l'épuisement. Voilà où nous sommes, à Hoboken, dans le New Jersey, sur la West Bank de l'Hudson River, et
sur la rive d'en face, c'est Manhattan. Ce n'est donc pas tout à fait New York, mais une ville où subsiste sûrement encore l'image d'Épinal d'une Amérique blanche middle class vivant
dans des banlieues pavillonnaires, où les gens ont tout le loisir d'arroser leur voiture, garer leur poubelle, tondre leur chien.
Mari et femme. Ira Kaplan, aux chant-guitare-claviers, et Georgia Hubley, qui chante elle aussi et joue de la batterie (essentiellement aux balais sur ce disque), sont ensemble dans la
vie. James McNew, le bassiste nounours et poupon, a le profil type du bon copain jovial qui viendrait partager notre repas le dimanche, et nos scènes de ménages, nos confidences. La complicité
du couple Kaplan/Hubley bruisse tout du long. Leurs voix susurrées s'alternent, se répondent, se confondent parfois même dans leur tessiture. Comme deux visages auxquels le nombre d'années
passées ensemble aurait fini par donner un air de famille asexué, en en brouillant les polarités. Depuis ma découverte d'une possible complémentarité du couple dans l'art au travers des films
documentaires de Johan van der Keuken et de sa femme Noshka, qui en poursuivait l'œuvre par le montage, l'idée me fascine. Je la retrouve ici.
Un disque pour faire l'amour. C'est idiot je sais, mais je suis un adepte des questions triviales, et j'aimerais bien qu'on me pose celle-là un jour, et ton disque à toi alors ?
Pendant longtemps, je n'aurais pas su quoi répondre, possiblement du fait d'une vie sexuelle un peu pauvre, pas assez entraînée musicalement pour m'accorder comme tout le monde sur The Very
Best of Marvin Gaye. Healing is not something good for me je suppose. Aujourd'hui moi-même redevenu torride comme l'autre Tellier, j'ai récemment pris le risque de glisser ce disque.
Le moment de la jouissance est tout relatif, selon que l'on pratique ou non le tantrisme, comme le chanteur Sting et son épouse Trudie. En tout cas, And then nothing turned itself
inside-out de Yo La Tengo serait pour l'heure ma réponse à la question.
Our Way To Fall. L'orgue Farfisa est beau à pleurer sur le deuxième morceau de l'album. Il dit l'ambivalence du titre : notre façon de tomber amoureux, notre
chemin vers la chute. Dans les deux cas, on tombe, on dégringole, on regarde nos pieds, on se remémore nos premiers émois dans la tranquillité.
I remember a summer's day
I remember walking up to you
I remember my face turned red
And I remember staring at my feet
L'orgue joué par effet de glissando, soit un glissement continu d'une note à une autre, est l'exacte antithèse de la technicité exhibée par les jazzmen ou les métalleux. Ainsi, malgré une
virtuosité au ras des pâquerettes, cet orgue traduit l'émotion à ciel ouvert.
From Black to Blue. Ce sont les couleurs du disque et ce sont ses humeurs. La nuit tombe infiniment sur Hoboken et à force de noir, on finit par y voir du bleu. Bleu nuit. C'est la
teinte ouverte à toutes les audaces, la porte entrebâillée sur l'extérieur au dos de la jaquette.
Paris, Square Berlioz - dimanche 20 avril, 15h38. Tandis que je planche sur le présent texte, je fais glisser mes sunglasses sur mon nez pour y regarder à deux, trois
fois, mais non, malgré ma nuit blanche et mon manque de sommeil je ne rêve pas, c'est bien la grande silhouette dégingandée de Jarvis Cocker (ndlr chanteur du célèbre groupe pop anglais
Pulp) que j'aperçois là-bas à, quoi , quinze, vingt mètres de moi, j'en suis certain, je reconnais bien sa touche british, veste en velours avec coudières, étriquée juste ce
qu'il faut, pantalon feu de plancher, lunettes de vue aux verres fumés, chaussures que l'on jurerait taillées pour le bowling et le cheveu, comme à son habitude, pop et un peu gras. Puis le
maillot de football de son fiston ne trompe pas : un numéro 10 coiffé du nom Cocker - je suis à l'instant où j'écris interrompu par le ballon qui m'arrive dessus, et moi de le stopper
net et de me lever machinalement comme un zombi dans un film de George A. Romero pour le shooter avec une adresse que je ne me connaissais pas, pile dans la direction de Jarvis qui me remercie
d'un signe de main. Je me dis qu'après tout j'ai bien fait de sortir de chez moi, des idoles pop gravitent en bas dans le jardin. Et le square ne cesse de se remplir de poussettes, des
enfants en pagaille s'agitent en tout sens, un vrai baby-boom bobo en fait. Et si tous ces couples avaient finalement un peu trop écouté l'album de YLT au début du nouveau millénaire ?
And Then Nothing Turned Itself Inside-Out, vu par Youri Gralak
C'est un disque qui commence par la fin, enfin par une possible fin. Une longue introduction lente, répétitive comme un mantra, laisse poindre sous l'apparente routine un truc qui fait
masse. Everyday donc, la première chanson, donne l'illusion d'une machine bien rodée mais viciée, que l'usure du quotidien aurait finit par rendre un peu folle, au point de dessiner
des cercles concentriques, comme cet homme et sa tondeuse sur la photographie intérieure de la pochette. Sans souci autobiographique ni chronologique, le trio Yo La Tengo (qui n'a d'exotique
que le nom) va évoquer ici, dans le désordre, quelques fragments de la vie amoureuse : lassitude, approche, désir, distance.
La nuit tombe sur Hoboken indique le titre final, long à l'infini, à l'épuisement. Voilà où nous sommes, à Hoboken, dans le New Jersey, sur la West Bank de l'Hudson River, et
sur la rive d'en face, c'est Manhattan. Ce n'est donc pas tout à fait New York, mais une ville où subsiste sûrement encore l'image d'Épinal d'une Amérique blanche middle class vivant
dans des banlieues pavillonnaires, où les gens ont tout le loisir d'arroser leur voiture, garer leur poubelle, tondre leur chien.
Mari et femme. Ira Kaplan, aux chant-guitare-claviers, et Georgia Hubley, qui chante elle aussi et joue de la batterie (essentiellement aux balais sur ce disque), sont ensemble dans la
vie. James McNew, le bassiste nounours et poupon, a le profil type du bon copain jovial qui viendrait partager notre repas le dimanche, et nos scènes de ménages, nos confidences. La complicité
du couple Kaplan/Hubley bruisse tout du long. Leurs voix susurrées s'alternent, se répondent, se confondent parfois même dans leur tessiture. Comme deux visages auxquels le nombre d'années
passées ensemble aurait fini par donner un air de famille asexué, en en brouillant les polarités. Depuis ma découverte d'une possible complémentarité du couple dans l'art au travers des films
documentaires de Johan van der Keuken et de sa femme Noshka, qui en poursuivait l'œuvre par le montage, l'idée me fascine. Je la retrouve ici.
Un disque pour faire l'amour. C'est idiot je sais, mais je suis un adepte des questions triviales, et j'aimerais bien qu'on me pose celle-là un jour, et ton disque à toi alors ?
Pendant longtemps, je n'aurais pas su quoi répondre, possiblement du fait d'une vie sexuelle un peu pauvre, pas assez entraînée musicalement pour m'accorder comme tout le monde sur The Very
Best of Marvin Gaye. Healing is not something good for me je suppose. Aujourd'hui moi-même redevenu torride comme l'autre Tellier, j'ai récemment pris le risque de glisser ce disque.
Le moment de la jouissance est tout relatif, selon que l'on pratique ou non le tantrisme, comme le chanteur Sting et son épouse Trudie. En tout cas, And then nothing turned itself
inside-out de Yo La Tengo serait pour l'heure ma réponse à la question.
Our Way To Fall. L'orgue Farfisa est beau à pleurer sur le deuxième morceau de l'album. Il dit l'ambivalence du titre : notre façon de tomber amoureux, notre
chemin vers la chute. Dans les deux cas, on tombe, on dégringole, on regarde nos pieds, on se remémore nos premiers émois dans la tranquillité.
I remember a summer's day
I remember walking up to you
I remember my face turned red
And I remember staring at my feet
L'orgue joué par effet de glissando, soit un glissement continu d'une note à une autre, est l'exacte antithèse de la technicité exhibée par les jazzmen ou les métalleux. Ainsi, malgré une
virtuosité au ras des pâquerettes, cet orgue traduit l'émotion à ciel ouvert.
From Black to Blue. Ce sont les couleurs du disque et ce sont ses humeurs. La nuit tombe infiniment sur Hoboken et à force de noir, on finit par y voir du bleu. Bleu nuit. C'est la
teinte ouverte à toutes les audaces, la porte entrebâillée sur l'extérieur au dos de la jaquette.
Paris, Square Berlioz - dimanche 20 avril, 15h38. Tandis que je planche sur le présent texte, je fais glisser mes sunglasses sur mon nez pour y regarder à deux, trois
fois, mais non, malgré ma nuit blanche et mon manque de sommeil je ne rêve pas, c'est bien la grande silhouette dégingandée de Jarvis Cocker (ndlr chanteur du célèbre groupe pop anglais
Pulp) que j'aperçois là-bas à, quoi , quinze, vingt mètres de moi, j'en suis certain, je reconnais bien sa touche british, veste en velours avec coudières, étriquée juste ce
qu'il faut, pantalon feu de plancher, lunettes de vue aux verres fumés, chaussures que l'on jurerait taillées pour le bowling et le cheveu, comme à son habitude, pop et un peu gras. Puis le
maillot de football de son fiston ne trompe pas : un numéro 10 coiffé du nom Cocker - je suis à l'instant où j'écris interrompu par le ballon qui m'arrive dessus, et moi de le stopper
net et de me lever machinalement comme un zombi dans un film de George A. Romero pour le shooter avec une adresse que je ne me connaissais pas, pile dans la direction de Jarvis qui me remercie
d'un signe de main. Je me dis qu'après tout j'ai bien fait de sortir de chez moi, des idoles pop gravitent en bas dans le jardin. Et le square ne cesse de se remplir de poussettes, des
enfants en pagaille s'agitent en tout sens, un vrai baby-boom bobo en fait. Et si tous ces couples avaient finalement un peu trop écouté l'album de YLT au début du nouveau millénaire ?
